Le CEA: sa raison d'être, la bombe son
alibi, la recherche
A propos de la reprise des essais nucléaires
français il y a eu dans la presse de nombreuses libertés
vis à vis des faits historiques concernant les places respectives
de la recherche militaire et civile au Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA): l'erreur la plus commune est d'inverser
les rôles respectifs du militaire et du civil dans les motivations
du CEA.
 Inauguration
de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné
aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du
fait qu'ils étaient constitués par un empilement
de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du
modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est
une copie à la même échelle de la pile canadienne
ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août
1944 et qui était entrée en service le 5 septembre
1945 moins de 13 mois plus tard).
Inauguration
de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné
aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du
fait qu'ils étaient constitués par un empilement
de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du
modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est
une copie à la même échelle de la pile canadienne
ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août
1944 et qui était entrée en service le 5 septembre
1945 moins de 13 mois plus tard).
Le CEA est généralement présenté
comme un organisme ayant été créé
en octobre 1945 pour développer tous les aspects pacifiques
de l'énergie nucléaire (à l'époque
on disait énergie atomique). Sa création était
en fin de compte l'accomplissement administratif des déclarations
enthousiastes des scientifiques français : l'avenir
ne pouvait être que radieux avec cette énergie "inépuisable",
"quasi-gratuite", sans danger, déclarations qui
suivirent la destruction totale d'Hiroshima et Nagasaki les 6
et 9 août 1945. L'orientation militaire du CEA ouvertement
affirmée dans les années 50 est apparue alors comme
une dérive perverse des buts assignés au CEA à
sa création. Cela donna lieu à de vives protestations
pour exiger le retour vers "l'atome pour la paix".
La réalité est très différente:
la mise
en service en 1956 à Marcoule de G-1, premier réacteur
électrogène français, montrait bien l'orientation
fondamentale du CEA vers les applications militaires même
si le Département des Applications Militaires (DAM) ne
fut créé que plus tard, fin 1958. L'aspect électrogène
de G-1 masquait en fait sa finalité réelle. Le réacteur
G-1 était un piètre producteur d'électricité:
sa puissance électrique était de 2 mégawatts.
Il n'a été exploité que par le CEA même
après son couplage au réseau.
 Vue générale du Centre de production
de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et
G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite
le réacteur G1.
Vue générale du Centre de production
de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et
G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite
le réacteur G1.
Les réacteurs suivants, G-2 et G-3, plus puissants, (38 Mwe) furent
eux aussi exploités par le CEA et non pas par EDF. La raison
en est que la production de plutonium impose un mode de fonctionnement
très différent du mode optimum nécessaire
à la production d'électricité.
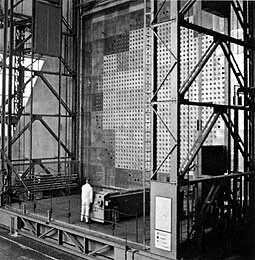 G-1
à Marcoule.
G-1
à Marcoule. 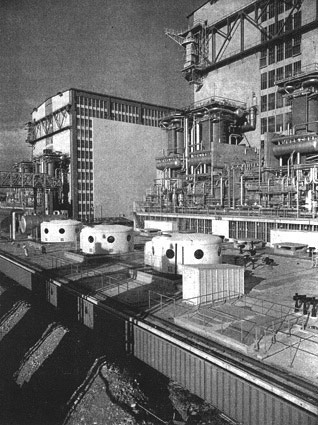 Vue
arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.
Vue
arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.
La gestion par le CEA des réacteurs
de Marcoule est la marque de leur objectif plutonigène.
Pour ces réacteurs la priorité n'était pas
la production d'énergie électrique mais leur utilisation
pour la production de plutonium par le CEA.


La cheminée d'évacuation
de l'air de refroidissement du bloc pile G-1. Cet air, radioactif,
est ainsi plus facilement dilué dans la masse de l'air
ambiant. La collerette évite les tourbillons descendants.
Il faudra attendre 1963 pour qu'EDF
prenne en exploitation un réacteur nucléaire, le
réacteur Chinon A-1, d'une puissance électrique
de 70 mégawatts.
Cependant il y a beaucoup plus fondamental.
Dès l'origine les acteurs de l'énergie nucléaire
ont donné la priorité au militaire. Ceci est
évident aux États-Unis avec le projet Manhattan
aboutissant avec "succès" à Hiroshima
et Nagasaki. Mais cela est vrai aussi pour la France. Voici
quelques faits généralement passés sous silence
(et ce n'est certainement pas un hasard) :
1 - La
mise en évidence de la fission de l'uranium laissait voir
le futur énergétique de cet élément
et la question qui était posée concernait la possibilité
d'une réaction en chaine si la fission de l'uranium produisait
plus d'un neutron. C'est l'aspect explosif de l'énergie
nucléaire qui intéresse alors les physiciens et
qui inquiète certains d'entre eux (très très
peu et aucun en France).
2 - Lorsque
Joliot met en évidence la possibilité d'une réaction
en chaine il s'empresse de prendre 5 brevets entre le 30 avril
et le 4 mai 1939. Quatre d'entre eux concernaient la production
civile d'énergie, le
cinquième, déposé le 4 mai 1939 à
15h 35 avait pour titre: "Perfectionnement aux charges
explosives".
3 - Joliot
et son équipe envisagent alors la première expérience
de grande ampleur avec l'énergie nucléaire. Joliot
met à son programme l'explosion d'une bombe à uranium.
Comme les effets peuvent être importants le site projeté
était au centre du Sahara ! Cet essai était désigné
sous le nom: "La Grande Expérience".
4 - Dès
cette époque l'essentiel des préoccupations de Joliot
et de son équipe est orienté vers la bombe. Le 11
août 1945 Raoul Dautry, ancien ministre, révélait
:
"Peu après le début de
la guerre, le gouvernement dut demander à M. Joliot-Curie
de pousser ses études, moins vers l'utilisation des radioéléments
pour la production d'énergie intéressant l'industrie
du temps de paix (domaine où cependant, des perspectives
extraordinaires pouvaient déjà être entrevues),
que vers la mise au point d'un processus de libération
brutale de l'énergie atomique avec des effets dépassant
infiniment ceux des explosifs puissants.
C'est à ce moment que j'eus à
intervenir comme ministre de l'Armement pour mettre à la
disposition de M. Joliot-Curie tous les moyens dont il pouvait
avoir besoin". (Ce texte est cité
dans le livre de Géraud Jouve, "Voici l'âge atomique",
publié en 1946 aux éditions Franc-Tireur).
 Raoul Dautry, Frédéric
joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile
Zoé.
Raoul Dautry, Frédéric
joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile
Zoé.
Ainsi les premiers travaux français
un peu importants visant l'énergie nucléaire ont
été financés en 1939 par l'armée.
Cela ne souleva aucune polémique dans les milieux scientifiques
français.
C'est donc à juste titre que Joliot
pouvait déclarer après la destruction d'Hiroshima :
"L'emploi de l'énergie atomique et de la bombe
a son origine dans les découvertes et les travaux effectués
au Collège de France par MM. Joliot-Curie, Halban et Kowarski,
en 1939 et 1940. Des communications ont été faites
et des brevets pris à cette époque" (dépêche
AFP publiée par le Figaro du 9 août 1945).
En somme la France, d'après Joliot,
était en droit de réclamer aux américains
des royalties* sur Hiroshima et Nagasaki puisque les bombes utilisées
pour ces destructions étaient couvertes par des brevets
français !
Dans le n°1 de la revue scientifique "Atomes"
(mars 1946), Joliot, qui dirigeait le CEA en tant que Haut Commissaire
à l'Energie Atomique, écrivait à propos du
projet Manhattan: "Nous ne pouvons nous empêcher
d'admirer l'effort de recherche et de construction qui a été
fait par les Américains, ainsi que la valeur des savants
et techniciens réalisateurs". Ce projet Manhattan
avait eu pour but la mise au point d'une puissance destructrice
infiniment plus grande que celle dont rêvaient les militaires.
Évidemment l'effort financier de l'armée
française en 1939 pour développer les travaux de
Joliot-Curie était loin d'être suffisant pour assurer
à la France la primeur des destructions par l'arme atomique.
5 - Le plutonium a été dès l'origine
une préoccupation majeure du CEA. Le 15 décembre
1948 le premier réacteur atomique français ("Zoé")
divergeait. Il contribua au programme nucléaire français
en fournissant du combustible irradié d'où fut extrait
en septembre 1949 le premier plutonium français (quelques
milligrammes) dans l'usine
du Bouchet où une cellule avait été spécialement
construite à cet effet.
 Il
est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand
il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium :
Il
est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand
il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium :
"Pour la première fois je voyais
cet élément dont j'avais tant entendu parler ; ce
fut une très grande émotion pour un vieux chimiste
et physicien qui avait fait de la radioactivité avec des
substances naturelles, mais n'avait jamais vu de substance radioactive
artificielle en quantité pondérable" (cité par B. Goldschmidt dans "Les Pionniers de l'atome",
Stock, 1987). C'est à cet élément qu'on doit
la destruction de Nagasaki !
Rapidement après le succès de
Zoé, la décision fut prise par l'état-major
du CEA de construire à Marcoule le réacteur G-1
de 2 mégawatts pour la production de plutonium à
raison de 1 gramme par jour. On ne trouve, à cette époque,
aucune justification de ce programme plutonium pour une activité
civile du CEA. Personne en France ne s'étonna alors de
cet intérêt pour le plutonium. Il est bien évident
que c'était la bombe qui était l'objectif prioritaire
du CEA.
6 - Il
n'y a là rien d'étrange quand on se réfère
aux textes fondateurs du Commissariat à l'énergie
atomique. L'ordonnance n 45-2563 du 30 octobre 1945 institue un
Commissariat à l'énergie atomique (JO du 31 octobre
1945 p. 7065-7066). L'article 1er définit les objectifs
du CEA :
"Le Commissariat à l'énergie
atomique :
"poursuit les recherches scientifiques
et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique
dans les divers domaines de la science, de l'industrie et de la
défense nationale [souligné
par nous]".
L'article 2 définit la composition du
comité qui doit administrer le CEA. Il comprendra :
"Un haut commissaire à l'énergie
atomique [...]
Un administrateur général
délégué du Gouvernement ;
Trois personnalités qualifiées
par leurs travaux relatifs à l'énergie d'origine
atomique
Le président du comité
de coordination des recherches concernant la défense nationale" [souligné par nous].
Cette ordonnance fut rédigée
à partir des propositions de Frédéric Joliot
et de Raoul Dautry. (Ces deux personnalités avaient tenté
en 1939 de développer en France une bombe à uranium).
La signature de De Gaulle était suivie
par celles de 9 ministres. Les ministres des affaires étrangères,
de la guerre, de la marine et de l'air venaient en tête.
Le ministre des colonies n'était pas oublié. Cette
présentation montre assez bien la hiérarchisation
des motivations du gouvernement en créant le CEA.
Le
décret du 3 janvier 1946 "portant nomination du
haut commissaire à l'énergie atomique et de membres
du comité de l'énergie atomique" est significatif
de l'orientation militaire du CEA dès son origine. Ce décret
nomme Frédéric Joliot haut commissaire (Art. 2).
Dans l'article 1er on trouve: "Sont nommés membres
du comité de l'énergie atomique, en outre du
président du comité de coordination des recherches
scientifiques intéressant la défense nationale,
membre de droit [...]" [souligné par nous].
Suit la liste des savants nommés pour siéger avec
le représentant de l'armée: Irène Joliot-Curie,
Pierre Auger, Frédéric Joliot, Francis Perrin.
 Comité
scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:
Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric
Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand
Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.
Comité
scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:
Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric
Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand
Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.
La présence d'un représentant
militaire dans les organismes de direction du CEA ne semble pas
avoir géné les scientifiques de ces organismes.
La révocation de Joliot en 1950 pour
son refus d'accepter l'orientation du CEA vers des recherches
à fins militaires (la bombe et les sous-marins à
propulsion nucléaire) a pu laisser croire qu'à l'origine
le CEA n'avait que des missions civiles. Quelques jours après
la décision de révoquer Joliot, des scientifiques
de la direction du CEA signaient "une déclaration
rappelant que le Commissariat n'était pas un établissement
de défense nationale" (B. Goldschmidt, op. cité
p. 438). C'était oublier les textes fondateurs du CEA et
les activités prioritaires du CEA dès sa création.
Un des signataires de ce texte acceptait d'ailleurs de remplacer
Joliot et d'assumer ouvertement l'orientation militaire des programmes
du CEA.
Bertrand Goldschmidt signale dans son livre
qu'"en janvier 1949 Joliot fut l'invité de la presse
anglo-américaine [...]. La question du secret atomique
ayant été abordée, Joliot expliqua que tout
résultat de ses recherches susceptible de contribuer à
un programme militaire serait gardé secret tant que les
Nations unies ne se seraient pas mises d'accord sur un traité
d'interdiction de l'arme atomique" (p. 433). Ceci indique
bien que le haut commissaire à l'énergie atomique
n'excluait pas de ses recherches et de celles du CEA des recherches
concernant les bombes atomiques.
L'activité prioritaire du CEA pendant
les années qui suivirent sa création fut militaire.
Cependant le développement des recherches pendant cette
période pouvait laisser croire à une orientation
différente: la recherche des minerais d'uranium, la purification
de l'uranium et des matériaux nécessaires à
l'élaboration d'un combustible nucléaire, la fabrication
industrielle de graphite très pur, la mise au point de
techniques physico-chimique de contrôle des matériaux,
la neutronique etc. toutes ces activités pouvaient apparaître
comme orientées vers des applications pacifiques. Mais
le CEA menait, en parallèle, une activité plutonium:
études sur les propriétés physiques et chimiques
du plutonium afin de mettre au point son extraction à partir
des combustibles nucléaires irradiés. La construction
de réacteurs nucléaires à Marcoule avait
pour motif principal l'obtention rapide de plutonium pour réaliser
la bombe française et placer la France au rang des "grandes"
nations, des nations ayant un potentiel de destruction vraiment
moderne ! La production électrique de ces réacteurs
ne pouvait servir qu'à masquer l'orientation fondamentalement
militaire des activités majeures du CEA qui se concrétisa
le 13 février 1960 par l'explosion au Sahara (sélectionné
depuis 1939 comme le territoire "français" le
mieux approprié pour ce genre d'activité) de la
première bombe nucléaire française, une bombe
au plutonium. Les réacteurs de Marcoule prenaient là
tout leur sens.
 |
En 1958, le général
de Gaulle lance à Marcoule le réacteur G2, destiné
à la production de plutonium militaire. |
La France allait ainsi servir de modèle
pour tous les états qui plus tard désireront se
placer dans le club des grandes nations, de celles dont le potentiel
de destruction massive attesterait de leur modernité. La
France, le 13 février 1960 ouvrait la voie à la
prolifération nucléaire.
Le CEA a été créé
par De Gaulle en 1945 afin de produire des bombes atomiques. Il
a eu l'approbation unanime des divers partis politiques, (droite
et gauche confondues), et de l'ensemble de la communauté
scientifique, y compris de ceux, qui, comme Joliot, se manifestèrent
plus tard contre la bombe. L'activité civile française
pour la réalisation de réacteurs nucléaires
de puissance ne prit réellement place dans les programmes
du CEA que lorsque sa mission première fut remplie: la
bombe.
Roger Belbéoch, septembre
1995.
Nota: Certains points soulevés dans ce texte
ont été développés plus en détail
dans des interventions publiques dont :
- L'émission "Micro-Climat" sur Radio Libertaire,
8 août 1988 sur le thème "De Hiroshima à
Bikini".
- Le séminaire "Science/Technologie/Subjectivité".
Université européenne de la recherche, Dépt.
de Sciences Politiques, Université Paris VIII, sur le thème
"Pratiques de la science : le nucléaire", 1er
février 1993.
Voir également les références citées
dans "Tchernobyl,
une catastrophe" (B. et R. Belbéoch,
Éd. ALLIA, 1993) dans le chapître "De Hiroshima à Tchernobyl".
* EGE
(Ecole de Guerre Economique), 27 février 2012:
Les « brevets Joliot »
: Une bataille juridique de plus de vingt ans
La guerre des brevets fait rage. Et il est
bon de revenir sur quelques cas d'école. L'affaire des
« brevets Joliot » qui remonte au milieu du siècle
dernier illustre les difficultés à établir
et défendre ses droits dans un domaine aussi sensible et
stratégique que l'énergie nucléaire. Sur
fond de guerre et d'occupation du territoire national, on ne peut
pas à proprement parler évoquer un copiage de technologies,
mais les réactions des américains n'étaient
peut-être pas totalement dénuées d'arrières
pensées économiques dans le contexte du développement
du nucléaire civil aux États-Unis dans les années
50.
En mai 1939, Frédéric Joliot, prix Nobel de Physique
1935 avec sa femme Irène Curie (elle-même fille des
prix Nobel 1903 Pierre et Marie Curie), dépose conjointement
avec son équipe du Collège de France trois brevets
portant sur l'utilisation de l'énergie nucléaire.
Intitulés Dispositif de production d'énergie, Procédés
de stabilisation d'un dispositif de production d'énergie
et Perfectionnement aux charges explosives, ces brevets reposent
sur le mécanisme de fission nucléaire découvert
quelques mois auparavant par des chercheurs autrichiens.
En deux mots, le noyau d'un atome d'uranium est susceptible de
se briser en deux en dégageant une grande quantité
d'énergie et en libérant quelques neutrons capables
d'aller provoquer de nouvelles fissions des noyaux alentour. Le
contrôle (ou non) de cette « réaction en chaine
», dont l'équipe du Collège de France a l'intuition
la première, est le fondement des « brevets Joliot
» qui portent sur l'exploitation de cette énergie
d'origine nucléaire. Deux brevets supplémentaires
seront déposés début 1940, portant sur l'enrichissement
de l'uranium et sur la géométrie des « modérateurs
», matériaux permettant le contrôle des réactions
nucléaires.
Avec le début de la guerre, deux des collaborateurs de
F. Joliot, co-détenteurs des brevets fondamentaux, se réfugient
à Londres où ils prennent contacts avec les autorités
gérant la question nucléaire sur fond d'exploitation
offensive de la fission. Ils y déposent également
de nouveaux brevets 40 et 42, et négocient des accords
avec les autorités anglaises et un industriel de la chimie
(ICI), compliquant ainsi notablement la situation sur le plan
de la propriété intellectuelle.
Au sortir de la guerre, la propriété des brevets
initiaux est transférée au CEA créé
trois mois après Hiroshima et Nagasaki qui entreprend des
négociations avec les autorités nucléaires
anglaises. Si un accord partiel est rapidement (et courtoisement
!) conclu dès 1948, certains aspects ou prolongements des
accords traineront encore jusqu'en 1960.
Aux États-Unis, la question prend un autre tour : les brevets
originaux (les deux premiers du moins, le troisième n'avait
pas été déposé hors de France) sont
rejetés en novembre 1941 pour insuffisance de description
des dispositifs envisagés (la loi américaine brevète
des inventions exploitables, pas de simples idées). Dans
un contexte de communication déjà difficile avec
la France occupée, la mise au secret à partir de
1942 et jusqu'en 1949 de tout ce qui touche à l'énergie
nucléaire aux USA verrouille toute revendication française
sur ces brevets. Plus encore en 1946 l'Atomic Energy Act interdit
aux États-Unis tout brevet lié à des matières
fissiles, et même tout échange d'information sur
ce sujet.
Les démarches françaises ne reprennent qu'en 1954
avec l'assouplissement des règles américaines sur
le nucléaire et l'ouverture par le CEA de deux procédures
parallèles, potentiellement contradictoires, cherchant
en même temps à faire reconnaitre ses brevets et
à se faire indemniser de manière forfaitaire pour
leur utilisation pendant la guerre. Jusqu'au début des
années 60 la situation parait complètement bloquée,
mais les choses s'arrangent progressivement à partir de
1963.
En 1968, l'antériorité française des découvertes
fondamentales dans les technologies nucléaires est reconnue
officiellement lors d'une cérémonie à Washington,
et assortie d'un « dédommagement » de 35 000
$ (environ 300 000 Euros de 2022) pour
les inventeurs (dont deux sont décédés entretemps),
sans aucune commune mesure avec les frais de justice engagés.
A lire...
- Un extrait du livre "La babel
nucléaire" de Louis Puiseux, Editions Galilée,
1977:
" Quatrième grand, exclu du
partage du monde de Yalta en 1945, de Gaulle voulait sa bombe
(1). Par ordonnance du 18 octobre 1945,
il avait créé le Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA), placé directement sous l'autorité
du président du Conseil. Ses successeurs reprendront son
ambition à leur compte (1), limogeront
le 28 avril 1950 Frédéric Joliot-Curie, alors patron
du CEA (2), pour ses options communistes,
et à son retour au pouvoir, en 1958, de Gaulle retrouvera,
intact et grandi, cet outil majeur de l'indépendance nationale.
Pas question pour la France de jouer les gendarmes du monde: le
sous-marin à propulsion nucléaire n'est pas prioritaire.
Mais pas question non plus de dépendre des Etats-Unis pour
la fourniture des matières fissiles: l'enrichissement de
l'uranium est une technique trop complexe, trop lourde, pour l'instant
hors de sa portée. Il s'agit de produire du plutonium
par la voie la plus courte: d'où, comme les
Anglais, le choix de la filière à uranium naturel:
L'uranium 238 à partir duquel se produit
le plutonium étant en proportion plus faible dans l'uranium
enrichi, les réacteurs à uranium enrichi produisent
à puissance égale moins de plutonium que les réacteurs
à uranium naturel, et d'autant moins que leur teneur en
uranium 235 est plus élevée. Cette donnée
technique a une signification politique importante car il s'en
déduit que les réacteurs à uranium naturel
représentent un éventuel potentiel militaire plus
grand à cause de leur caractère plutonigène
accentué, et ce fait a joué un rôle certain
dans le développement de la technologie nucléaire.
(Bertrand Goldschmidt, 1962, pp. 107-108.)
Les Anglais font exploser leur première
bombe en
octobre 1952 à Montebello (Australie), et les Français
en février 1960 à Reggan (Sahara). "
1. « Le général
de Gaulle avait créé le CEA " d'abord
pour fabriquer la bombe " me répétait-il.
Il avait nommé Joliot Curie avec cette mission expresse.
Et Joliot avait accepté !. " Je vous la
ferai, mon général, votre bombe ! " »
Alain Peyrefitte, Le Mal Français, p. 83. (Paris,
Plon, 1976.)
2. Alain Peyrefitte cite le lancement du programme d'armes nucléaires
par Pierre Mendès-France en décembre 1954, et celui
de la construction de l'usine
d'enrichissement de Pierrelatte (pour faire la bombe H) en
mars 1957 par Guy Mollet, comme deux exemples de décisions
prises « sous hypnose »: les services spécialisés
avaient si bien préparé la décision que
le Premier ministre l'a signée sans en comprendre la portée,
et n'en a gardé aucun souvenir. (Le Mal Français,
pp. 288 à 291.)
 Inauguration
de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné
aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du
fait qu'ils étaient constitués par un empilement
de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du
modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est
une copie à la même échelle de la pile canadienne
ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août
1944 et qui était entrée en service le 5 septembre
1945 moins de 13 mois plus tard).
Inauguration
de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné
aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du
fait qu'ils étaient constitués par un empilement
de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du
modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est
une copie à la même échelle de la pile canadienne
ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août
1944 et qui était entrée en service le 5 septembre
1945 moins de 13 mois plus tard). Vue générale du Centre de production
de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et
G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite
le réacteur G1.
Vue générale du Centre de production
de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et
G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite
le réacteur G1.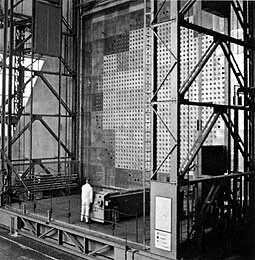 G-1
à Marcoule.
G-1
à Marcoule. 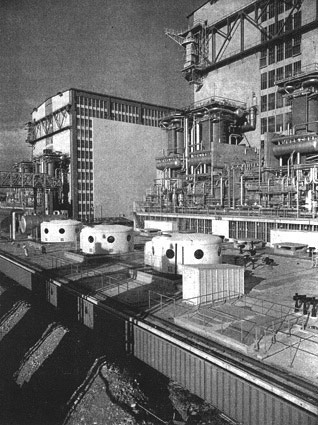 Vue
arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.
Vue
arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.

 Raoul Dautry, Frédéric
joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile
Zoé.
Raoul Dautry, Frédéric
joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile
Zoé. Il
est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand
il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium :
Il
est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand
il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium : Comité
scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:
Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric
Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand
Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.
Comité
scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:
Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric
Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand
Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.