
[Photos de la construction et de l'exploitation de la centrale rajoutées par Infonucléaire]

Irradiée et condamnée, la
journaliste soviétique avait prédit, un mois avant, l'explosion
de la centrale. Aujourd'hui la Cassandre de Tchernobyl écrit
des poèmes et témoigne sans relâche. Pour
que l'on n'oublie pas les victimes. Que les survivants soient
soignés. Et que jamais, nous ne vivions ce qu'elle-même
a vécu.
 Il aura
fallu la catastrophe de Tchernobyl pour faire de la communiste
croyante qu'était Lioubov Alexandrovna Kovalevskaïa une
« calomniatrice systématique de l'URSS »,
pour employer ses propres termes. Et pour faire d'un petit rouage
de la machinerie atomique de l'URSS, une militant, antinucléaire.
Certes, avant la nuit cataclysmique du 25 au 26 avril 1986 où
Tchernobyl a explosé, Lioubov avait déjà
de sérieux doutes. Mais l'accident la fera radicalement
diverger, comme on le dit d'un réacteur qui entre en action
et qui commence à libérer son énergie.
Il aura
fallu la catastrophe de Tchernobyl pour faire de la communiste
croyante qu'était Lioubov Alexandrovna Kovalevskaïa une
« calomniatrice systématique de l'URSS »,
pour employer ses propres termes. Et pour faire d'un petit rouage
de la machinerie atomique de l'URSS, une militant, antinucléaire.
Certes, avant la nuit cataclysmique du 25 au 26 avril 1986 où
Tchernobyl a explosé, Lioubov avait déjà
de sérieux doutes. Mais l'accident la fera radicalement
diverger, comme on le dit d'un réacteur qui entre en action
et qui commence à libérer son énergie.
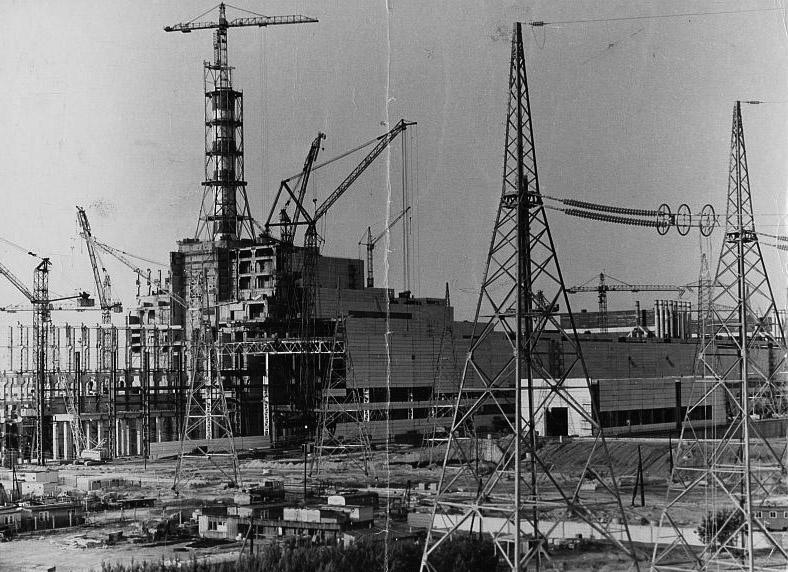
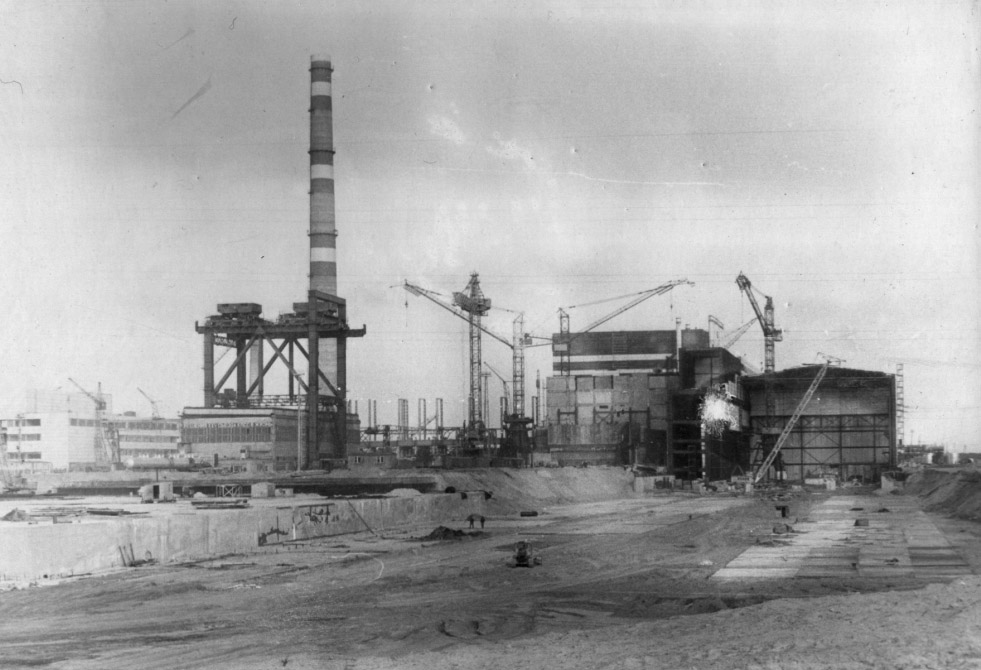 « Sa »
centrale, elle l'aimait d'amour. Depuis 1980. où elle est
devenue journaliste au quotidien du chantier, la Tribune de
l'énergéticien, elle l'a suivie jour après
jour. Elle a célébré l'apport de Tchernobyl
à l'édification du communisme. Elle a vibré
à ses succès. Mais elle s'est enragée de
découvrir les vices cachés de la centrale, dont
la censure lui interdisait de parler. Enragée de devoir,
à l'unisson du reste de la presse soviétique, ne
chanter que les louanges de cette installation la plus moderne
la plus efficace, la plus sûre et, bientôt la plus
grande du monde, avant de partir en fumée empoisonnée.
« Sa »
centrale, elle l'aimait d'amour. Depuis 1980. où elle est
devenue journaliste au quotidien du chantier, la Tribune de
l'énergéticien, elle l'a suivie jour après
jour. Elle a célébré l'apport de Tchernobyl
à l'édification du communisme. Elle a vibré
à ses succès. Mais elle s'est enragée de
découvrir les vices cachés de la centrale, dont
la censure lui interdisait de parler. Enragée de devoir,
à l'unisson du reste de la presse soviétique, ne
chanter que les louanges de cette installation la plus moderne
la plus efficace, la plus sûre et, bientôt la plus
grande du monde, avant de partir en fumée empoisonnée.
En décembre 1985. Kovalevskaïa claque la porte de la Tribune de l'énergéticien et rédige un article vengeur où elle oppose son démenti solitaire à tout ce qui a été dit et écrit sur Tchernobyl. L'article parait un mois avant l'explosion. Kovalevskaïa a droit à des félicitations de Gorbatchev pour son « courage civique » et son « professionnalisme sans concession ». Aujourd'hui journaliste libre, elle rend au numéro un du Kremlin la monnaie de sa pièce et l'accuse, lui et son administration, d'incompétence, d'hypocrisie et de cruauté.
Avec la catastrophe. sa vision du monde a basculé. Gravement irradiée et condamnée à terme, sa raison de vivre aujourd'hui est la dénonciation de ce système qui a fait Tchernobyl dans l'insouciance et, réduit à des demi-mesures et des faux fuyants, se trouve incapable de maîtriser les conséquenccs de l'accident. Dans ses livres et ses articles, Kovalevskaïa veut témoigner aussi de son expérience personnelle d'irradiée et de mère d'une petite fille, également irradiée, dont elle se demande si un jour elle n'enfantera pas un monstre.
Staline est mort l'année où naissait Lioubov mais son ombre l'a pour suivie. Ses deux grands pères sont partis dans les camps des années 30. D'où ils ne sont jamais revenus. Le grand père paternel parce qu'il était noble et le grand père maternel parce qui était un koulak, un paysan aisé. A peine son mari avait-il été déporté que la grand mère de Lioubov, enceinte, l'était à son tour : condamnée à cinq ans pour avoir glané une poignée d'épis dans un champ kolkhozien, C'est ainsi que la mère de la jeune femme a vu le jour dans un camp et y a vécu ses premières années d'enfant.
Paradoxe et perfection du système stalinien :
ce sont ses parents, rescapés des camps, qui ont fait de
Lioubov, de ses soeurs et de ses frères, des communistes
zélés. Ils n'ont pas voulu que leurs enfants sachent
qu'ils étaient des enfants d' « ennemis du peuple »
l'auraient-ils su, ils auraient risqué de se rebeller contre
le système, et gâché leurs vies.
Les parents de Lioubov ont donc mis toute leur énergie
à dispenser à leurs enfants l'art soviétique
du savoir vivre que l'on apprend dès le berceau dans une
famille normale : se plier à tous les caprices des
autorités, débiter du bout des lèvres les
discours qu'on attend d'eux en public, mais les oublier radicalement
dès qu'on n'est plus sous le regard des chefs.
Lioubov fut ainsi promise à faire partie de cette espèce
rare de « merles blancs » soviétiques,
citoyens modèles qui prennent à la lettre l'idéologie
officielle, aveugles volontaires devant les réalités
sordides de la « vraie vie », donc
promis aux meurtrissures et aux échecs dans une société
de cyniques. Elle avait trente ans lorsque, à la mort de
son père, sa mère lui révéla enfin
l'histoire vraie de la famille. C'était trop tard, le pli
était pris.
Cette distance d'avec la réalité est sans doute
la raison pour laquelle la première forme d'écriture
que Lioubov a pratiquée dès l'adolescence a été
la poésie. Et c'est encore la poésie qui reste aujourd'hui
son mode d'expression préféré. Elle se définit
elle-même comme une « éternelle enfant ».
Adolescente, « tu ignores tout de la vie »,
l'avertissait son père. Adulte, « tu ignores
tout de la vie ». lui répétait son
mari. « Je le sais et je t'em... »,
répondait-elle. Les livres, la solitude et l'écriture
étaient mes refuges. Ils m'ont épargné d'être
modelée par la « civilisation »
du socialisme réel et ont sauté mon âme. »
Elle a intitulé la Force et la Meurtrissure son
premier recueil de vers, publié en 1989. Tel est son choix
de vie : elle accepte, puisque c'est inévitable, d'être
meurtrie par la « vraie vie » à
laquelle elle s'obstine à rester étrangère.
Mais pourquoi « force » ? C'est
l'autre paradoxe du système stalinien. Pour les praticiens
du vrai savoir vivre soviétique, le maître mot est :
ne pas se révolter. Quant à Lioubov, c'est dans
son stalinisme idéal qu'elle a trouvé la source
de sa révolte. Et sa force. C'est là qu'elle a puisé
aussi, au début, les répliques qui ont laissé
bouche bée les apparatchiks pris au piège de leur
propre double langage. C'est ainsi qu'elle a remporté quelques
victoires et pris goût à la lutte.
Pour devenir écrivain elle fit des études de lettres
et devint en fait, une prof de littérature dont les horaires
démentiels excluaient toute possibilité d'écriture
personnelle.
« D'autres carrières étaient possibles
après mes etudes, raconte-t-elle, mais je me résignai
à l'enseignement. L'école est quand même un
refuge qui vous protège de la "vraie vie" que
je ne me sentais pas armée pour affronter. Je prenais mes
obligations d'enseignante au pied de la lettre, comme le reste.
Mes élèves devaient réussir et ils réussissaient.
Je devais leur faire aimer la littérature, fût ce
au prix d'heures supplémentaires et de rattrapages individuels,
et j'y arrivais. J'estimais attentatoires à mon "honneur
civique" les ficelles que pratiquaient mes collègues
pour se ménager du temps libre et mégoter sur le
travail à fournir.
C'était tant pis pour mes projets d'écriture que
je sentais se dissoudre. Ce n'est pas tellement pour sauver
ces projets que je démissionnai du lycée de Tchernobyl
en 1980. Si les élèves m'aimaient bien, mes
collègues me detestaient pour mon zèle qui n'était
à leurs veux que du "fayottage". Pour eux aussi,
"je ne savais rien de la vie". »
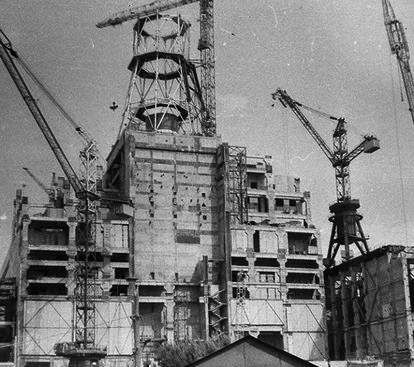
 En ce
temps-là, la centrale de Tchernobyl s'étoffait.
En 1980, le premier réacteur était déjà
en marche, le deuxième allait bientôt suivre, le
chantier du troisième et du quatrième démarrait.
Parallèlement, la Tribune de l'énergéticien
s'étoffait aussi et son rédacteur en chef cherchait
des plumes alertes. Lioubov accepta avec joie la proposition du
journal.
En ce
temps-là, la centrale de Tchernobyl s'étoffait.
En 1980, le premier réacteur était déjà
en marche, le deuxième allait bientôt suivre, le
chantier du troisième et du quatrième démarrait.
Parallèlement, la Tribune de l'énergéticien
s'étoffait aussi et son rédacteur en chef cherchait
des plumes alertes. Lioubov accepta avec joie la proposition du
journal.
« C'était un pas, en partie illusoire, comme je
l'expérimentai plus tard, mais un pas quand même
vers l'écriture personnelle, raconte Liouba. Mais sur le
moment, mon mobile principal était de relever enfin les
défis continuels de mon entourage au sujet de mon « ignorance
de la vie ». J'allais leur en remontrer en devenant
journaliste.
Elle avait un petit bagage atomique préalable. Bagage
théorique : pendant ses études de lettres,
elle avait suivi des cours d'infirmière de la Défense
civile. Bagage pratique : nommée pour son premier
poste en Sibérie dans la région de Sverdlovsk, elle
avait fait une enquête sur une série de morts par
leucémie chez les élèves de son école.
Il s'agissait des suites de l'explosion
d'un dépôt de déchets atomiques survenue
en 1958. dont la réalité a été reconnue
officiellement en 1989. L'enquête improvisée de Liouba
s'était heurtée à l'indifférence générale
et, très vite, au secret d'Etat. « Mais
j'étais déjà avertie, raconte-t-elle,
et j'abordai mon travail à Tchernobyl avec le souvenir
lancinant du dépérissement inéluctable
d'une des élèves de ma classe, que j'ai suivie pendant
plusieurs mois. Mes débuts de journaliste ont été
une épreuve. J'avais été une mauvaise lectrice
de journaux et je m'imaginais le journaliste comme quelqu'un qui
connaît la vie et la raconte comme elle est. Mes illusions
s'effondrèrent avec mon premier reportage. La consigne
était de faire un papier sur une brigade de volontaires
du Komsomol fraîchement débarquée sur le chantier
de la centrale. Je devais célébrer leur haute conscience
communiste, leur joie de vivre et leur ardeur au travail. Je les
trouvai désoeuvrés et buvant de la bière.
Avant de me presenter, je fus accueillie par une bordée
d'appréciations égrillardes sur ce que pouvaient
être mes performances au lit. Jamais je n'avais entendu
un langage aussi cru Je m'enfuis en pleurs, prête à
donner ma démission. »
Le rédacteur en chef sut la persuader de rester. Tant et
si bien que Liouba prit des galons dans le journal : reporter,
chef des reportages, responsable de la rubrique « Vie
du Parti », et pour finir adjointe du rédacteur
en chef.
« Il n'y a rien de tel pour mener une rubrique qu'un amateur qui débarque avec la conscience qu'il a tout à apprendre. Il n'est pas pris dans l'ornière de la routine. Je me lançai dans la physique nucléaire. Je lisais tout et prenais les instructions, les directives, les normes de sécurité, etc., au pied de la lettre. Avec mon regard neuf, je suivais la centrale au jour le jour en confrontant ce que je voyais avec ce que je lisais dans le projet et le cahier des charges. Je repérais les manquements que les exploitants de la centrale et les gens du chantier percevaient à peine, tellement ils y étaient habitués. En cinq ans, j'avais acquis assez d'assurance et d'informations pour être certaine des conclusions que j'ai fini par publier en mars 1986. »
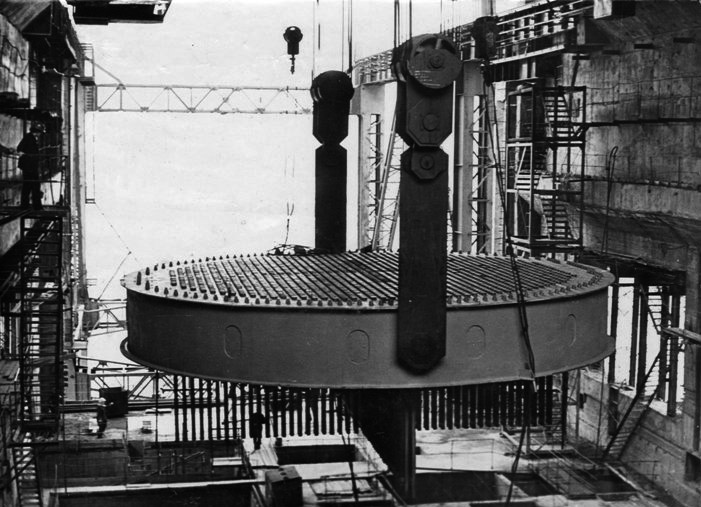


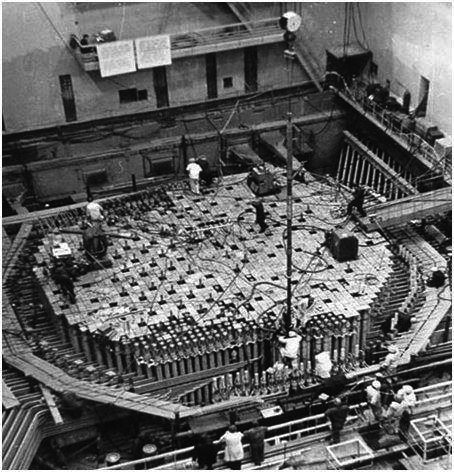
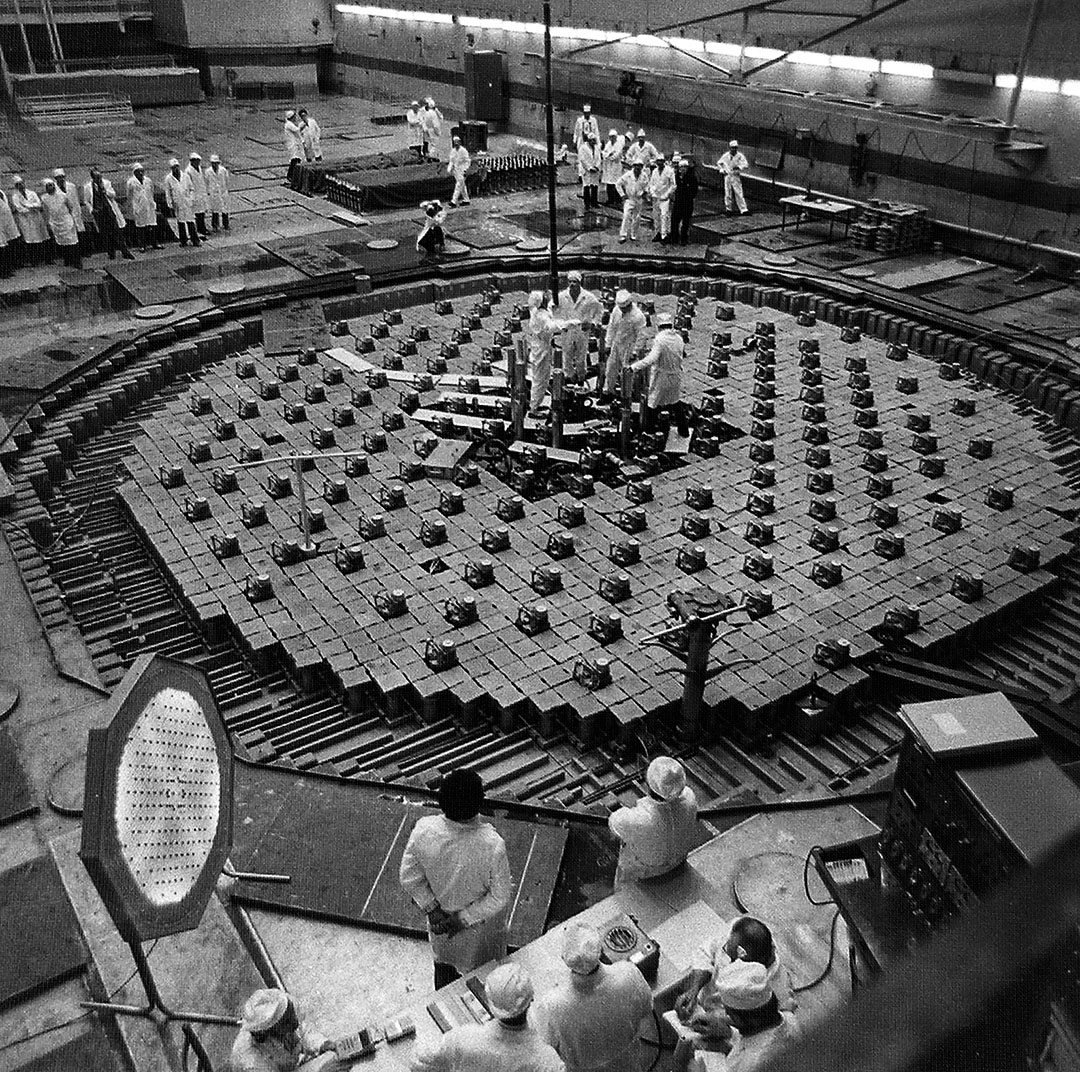
Avant de se révolter, Lioubov a appris
que le journaliste de l'époque brejnévienne n'est
pas « celui qui connaît
la vie et la raconte comme elle est », mais seulement
le propagandiste du système. C'est tout juste s'il peut
mentionner un nombre étroitement mesuré de faits
« négatifs », mineurs, sur
un fond résolument optimiste. Si, en plus, ce journaliste
s'occupe de l'atome, il doit savoir que l'ennemi impérialiste
est avide de la moindre information concrète. Un flou technique,
encore plus impénétrable que chez les autres journalistes,
doit baigner ses papiers. Certes, Lioubov regimbe : un tel
journalisme endort la vigilance technique du personnel de la centrale,
alors que la Tribune 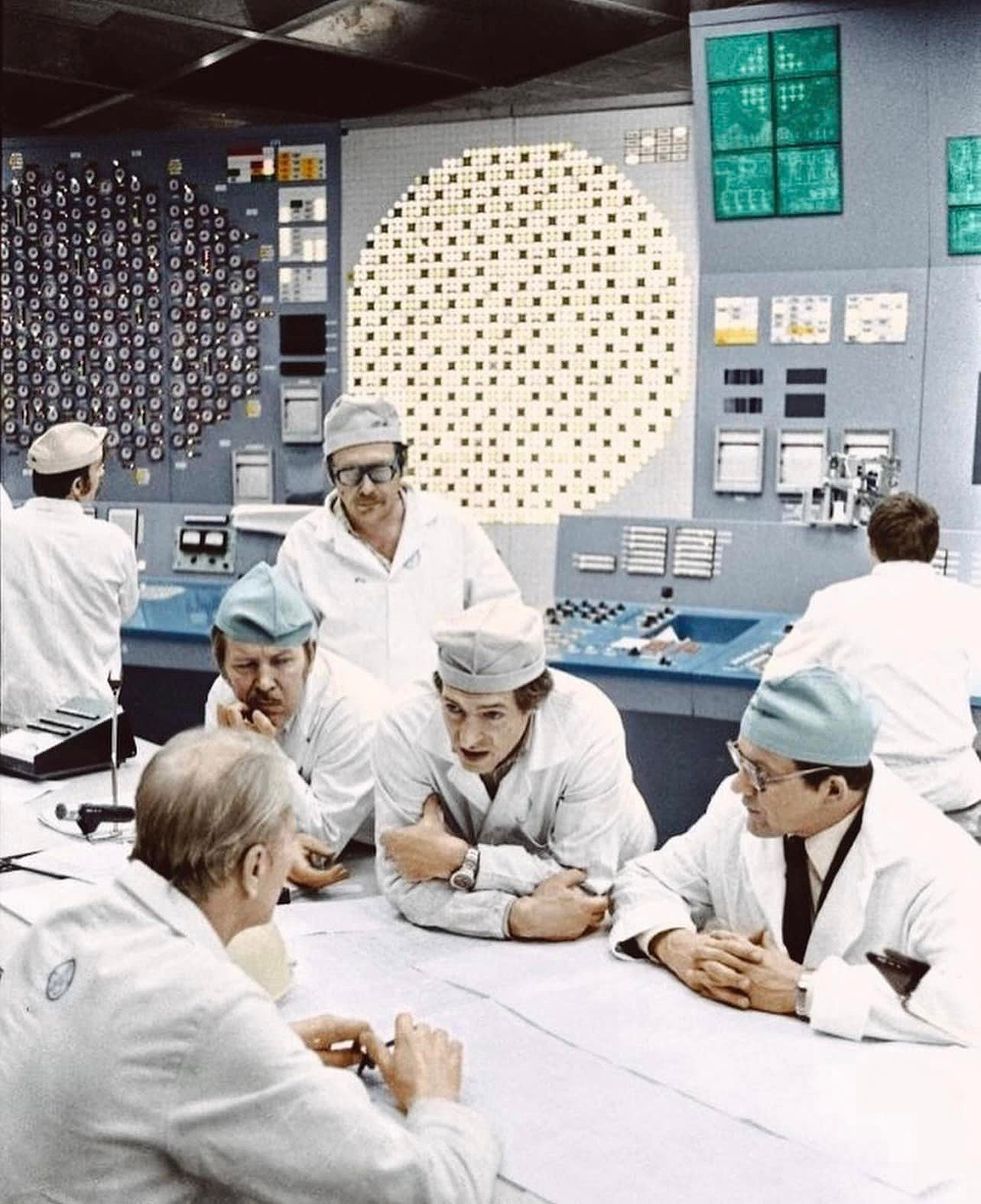 de
l'énergéticien prétend l'éduquer
face aux malfaçons et au laisser aller. Peine perdue Lioubov
ronge son frein mais cède. Elle cède si bien qu'on
l'estime bonne, elle une sans parti, pour diriger la rubrique
du Parti dans le journal. Puis on lui dit que, pour garder la
rubrique, elle doit adhérer. Elle adhère donc.
de
l'énergéticien prétend l'éduquer
face aux malfaçons et au laisser aller. Peine perdue Lioubov
ronge son frein mais cède. Elle cède si bien qu'on
l'estime bonne, elle une sans parti, pour diriger la rubrique
du Parti dans le journal. Puis on lui dit que, pour garder la
rubrique, elle doit adhérer. Elle adhère donc.
« A ma grande honte, avoue Lioubov, j'en étais
fière. Pour moi, le Parti était encore, selon la
formule consacrée, "l'intelligence, l'honneur
et la volonté de la nation". Ma mère ne m'avait
pas encore raconté l'histoire de mes grands parents et,
encore une fois, à ma grande honte, je n'ai fait aucun
effort pour savoir de l'histoire de l'URSS autre chose que ce
qu'on m'avait enseigné à l'école. »
Lioubov fit l'apprentissage d'une servitude supplémentaire,
propre au journaliste communiste : être le nègre
de ces messieurs du comité du Parti, rédiger leurs
discours et leurs articles. Les mêmes ne se privaient pas,
à l'occasion, de s'ériger en guides et critiques
de leur factotum littéraire. Cette outrecuidance a été
l'occasion pour Lioubov de son premier grand clash avec les autorités.
« Il ne leur suffisait pas que je me laisse imprégner
et encombrer le cerveau de la pensée officielle afin que
les discours de mes patrons soient impeccables idéologiquement.
Il [fallait] que je les remercie de la confiance qu'ils
me faisaient. Je déclarais publiquement que je ne marchais
plus. » S'ensuivirent blâme et menace
d'expulsion du Parti.
Pendant tout ce temps, Lioubov accumulait ses observations et
complétait ses connaissances qu'elle pouvait toujours aussi
peu utiliser dans ses articles.
« Les défauts de construction et le mode
incorrect de l'exploitation que j'observais ont ancré en
moi la conviction qu'une catastrophe était inévitable,
même si je ne pouvais m'imaginer qu'elle serait d'une telle
ampleur. Ma conviction a été renforcée par
les conversations que j'ai pu avoir avec des spécialistes
étrangers, parfois de haut rang, venus à Tchernobyl
où se tenaient les conférences d'Interatomenergo
(l'Office de coopération atomique des pays du COMECON
et la Yougoslavie, NDLR). Ces spécialistes parlaient
plus librement que les nôtres et transmettaient des informations
inconnues de moi. Les Yougoslaves étaient les plus ouverts
et ne cachaient pas leurs doutes sur la fiabilité de la
centrale. »


Fin 1985, Lioubov a trente trois ans, « l'âge du Christ, dit elle, où il faut décider si on est le maître de sa vie ou si on est un jouet manipulé par les autres ». Elle fait le bilan et démissionne de toutes ses responsabilités dans le journal où elle ne reste qu'en qualité de simple reporter. Elle veut se ménager du temps pour écrire. Sachant d'expérience ce qu'est l'école soviétique, elle s'apprête à en retirer sa fille de sept ans, pour faire elle-même son éducation à la maison.
Mais il lui reste encore à régler
ses comptes avec la centrale. Un journal de Kiev, l'Ukraine
littéraire, glasnost aidant - le premier congrès
gorbatchévien du PCUS vient d'avoir lieu, publie le 27
mars 1986, un mois avant la catastrophe, l'article désormais
fameux, qui fera de Lioubov la Cassandre de Tchernobyl.


Le capitaine de pompier Leonid Petrovitch Telanikov,
Le
même capitaine peu de temps après la catastrophe.
en tenue de cérémonie avant l'accident du 26 avril
1986. Parmi tous les pompiers
qui sont intervenus sur la centrale, un seul a survécu.
Les retombées de l'explosion irradient gravement Lioubov, sa fille et sa mère. Suivent deux jours sur place et dix jours d'évacuation panique à trente kilomètres seulement de la centrale, où les trois femmes, comme les autres évacués, continuent d'être soumises aux retombées.
Pendant tout ce temps, Lioubov s'interdit de
penser à elle-même et chasse de son esprit toute
réflexion sur l'événement. Une fois sa fille
et sa mère expédiées au loin, Lioubov se
retrouve seule à Kiev.
« A minuit, après le départ de l'avion,
j'ai pris le bus jusqu'au centre ville où je suis arrivée
avec 20 kopecks en poche. J'errais sans but dans la rue principale,
déserte. Je sentais que les symptômes de l'irradiation,
qui ne s'étaient pas encore manifestés, commençaient
à m'envahir. Comme si je les avais tenus à distance
tant que j'avais des choses concrètes à faire pour
mettre les miens à l'abri. Maintenant, pour repousser la
faiblesse nauséeuse que je sentais monter, je devais marcher,
marcher... fuir ma misère, m'occuper l'esprit par des projets
immédiats pour ne pas sombrer dans le désespoir.
« Où aller ? Tous mes amis en ville avaient
des enfants pour qui la poussière radioactive dont j'étais
couverte était dangereuse. Que faire pour désactiver
mes vêtements, mes chaussures, mes cheveux, ma peau ? Me
laver et faire la lessive, toute nue, dans l'eau, froide et inefficace,
des fontaines publiques ? Où et comment téléphoner
avec ma pièce de 20 kopecks ? Depuis le 26 avril, j'avais
réussi à tenir à distance toute pensée
globale de la catastrophe, pressentant que sa démesure
pouvait m'emporter. Cette nuit-là, je ne résistai
plus à l'angoisse qui m'étreignait. Je me sentais
physiquement écrasée, étouffée, sous
les décombres d'un monde foudroyé. La vie était
finie. Tout était inutile.
« Je n'osais pas aborder les rares passants
pour faire de la monnaie (les cabines de téléphone
ne prennent que des pièces de 1 kopeck. NDLR). Dans
leurs regards, je devinais qu'ils me prenaient pour une putain
ivre. J'étais radioactive, nauséeuse, sale, en sueur.
Je détestais mon corps. J'avais froid. Je voulus prendre
un bus de nuit, espérant m'y réchauffer, mais j'y
renonçai. A quoi bon ? Le Dniepr nétait pas loin.
Me noyer ? Oui, j'y ai pensé. Mais laisser ma fille orpheline
?
« Je continuai ma marche insensée. Une
douleur me ramena à la réalité : mes
pieds étaient en sang, un soulier était déchiré,
sans doute depuis des heures, sans que je m'en sois aperçue.
La marche devint tout à coup un supplice. Je claudiquai
jusqu'à une station de taxis où des gens attendaient.
Je voullais leur parler, mais n'osai pas : j'avais le sentiment
de n'être plus qu'une épave, au bord de la folie.
Je savais que mon discours serait incohérent, que ce que
je voulais dire était au-delà de la parole. Je me
mis dans la queue. Chaque fois que mon tour venait. Je me remettais
à l'autre bout de la file. Quelle adresse donner au chauffeur
? Oserais-je même lui parler ? Comment payer avec mes 20
kopecks ?
« Mes manoeuvres finirent par attirer l'attention
d'un homme. Il me demanda l'heure. Le truc habituel pour aborder
une femme ? Je cherchai ma montre : perdue, sans que je sache
où et quand. Je voulus le lui dire et pus à peine
parler. Ma gorge était sèche, ce n'était
qu'une plaie douloureuse, la muqueuse partie en lambeaux. Je poussai
un grognement rauque. En fait, il avait compris d'où j'arrivais.
"Venez !" me dit-il. Mais je me débattis. La
pudeur que voulez-vous ! Il m'expliqua qu'il allait me trouver
une chambre d'hôtel. On exigea de moi un certificat
de non-irradiation puisque telle était la consigne donnée
aux hôtels de Kiev. Heureusement, lors de l'évacuation,
on nous en avait délivré à tous sans examen.
« Je pus lessive, mes vêtements et prendre
une douche. Je restai bien une heure ou deux, hébétée
mais reprenant vie, sous l'eau chaude. C'est alors que je me vis
dans la glace. Horreur : un corps de jeune femme, une tête
de vieillarde. Le visage était tuméfié, déformé
et ridé. Ce sentiment d'horreur me révéla
que je n'étais pas, que je n'étais plus. indifférente
à mon sort puisque je m 'accrochais encore à ma
féminité. Je vivrai donc... Je fumai mes dernières
cigarettes, malgré la douleur qu'elles me causaient. Puis
je dormis vraiment. La premiere fois depuis douze jours.
Le matin, mon sauveteur de la veille m'apporta à manger
Je ne pouvais rien avaler. Il fallait avant chaque bouchée
faire fondre un morceau de beurre dans la bouche pour lubrifier
la gorge. Avant de sortir, je pris soin de me maquiller. Il régla
la chambre et m'accompagna à l'Ukraine littéraire.
Dans la rue, les passants se retournaient sur moi. Ils avaient
appris à identifier les gens de Tchernobvl à leur
regard, qu'ils garderont encore longtemps, où se lisaient
quelque chose d'indicible : exaltation, hébétude,
folie ? J'achetai des lunettes noires. Au journal, on m'accueillit
en triomphe. Mon article avait été lu à la
radio suédoise, à la BBC, etc. Les autorités
de Moscou m'avaient cherchée. J'étais une femme
célèbre. Tout le monde voulait entendre mon explication
de la catastrophe. »
Lioubov, grace à son article, avait cru prendre ses distances
à l'égard de la centrale, « avoir
réglé ses comptes ». Mais la catastrophe
a ajouté subitement un nouveau et énorme contentieux
dont Lioubov sait aujourd'hui qu'elle en a pour toute sa vie.
L'expérience pour tous ceux qui l'ont vécue, reste
indicible, tout en étant perpétuellement présente.
Elle obsède la mémoire, cherchant la moindre fissure
pour s'écouler en logorrhée. Frustration de se taire,
frustration de parler : cercle vicieux... Pour plusieurs,
l'issue a été la folie ou le suicide. Lioubov a
résolu de maîtriser ses souvenirs par l'écriture.
Morceau par morceau, du plus facile au plus dur. Le premier morceau,
c'est le Journal de Tchernohyl, écrit de
la façon la plus froide possible. Le texte reste à
la surface des événements, s'arrêtant au bord
du tourbillon noir du vécu intérieur, «
Même dans mes poèmes récents, où je
me protège à l'aide de la métaphore, c'est
avec crainte et prudence que je m'approche de ce tourbillon, confie
Lioubov. Je destine mes textes aux victimes de la catastrophe
pour qu'au-delà des écrits officiels ils
trouvent un premier fil pour sortir du soliloque suicidaire ou
du ressassemnen informe. »
 Dans
les rues désertes de Pripiat, la végétation,
parfois mutante, fissure l'asphalte. Lénine surplombe toujours
la grand-place mais la centrale, qui portait son nom, a été
débatiséee.
Dans
les rues désertes de Pripiat, la végétation,
parfois mutante, fissure l'asphalte. Lénine surplombe toujours
la grand-place mais la centrale, qui portait son nom, a été
débatiséee.
L'indicible, ce n'est pas seulement la catastrophe
et ses suites immédiates, c'est aussi la souffrance et
l'angoisse actuelle des quatre millions de personnes qui vivent
encore ou ont vécu dans la zone irradiée. Lioubov
en est un témoin privilégié. Son article
de mars 1986 a fait d'elle la destinataire des appels au secours
des victimes ainsi que des confidences de spécialistes
officiels. Ceux-ci confient à Lioubov (moyennant anonymat)
des copies de pièces administratives qui leur prescrivent
des mesures aberrantes ou inhumaines.
Lioubov partageait encore après l'accident l'illusion d'un
« bon tsar qui ignore l'incompétence et la
perfidie de ses ministres ». Elle a donc
envoyé en janvier 1987 au « bon tsar »
Gorbatchev une longue lettre où elle faisait part de ses
observations. Sans autre résultat que la visite d'un journaliste,
envoyé d'en haut, qui l'a écoutée poliment
avec un visage de pierre.
« Je compris, dit Lioubov, qu'il venait vérifier
si j'étais atteinte ou non de "radiophobie",
et que son diagnostic était positif. »
La « radiophobie » ou délire
des irradiés est une affection dont souffrent, en effet,
beaucoup de victimes de Tchernobyl, mais c'est aussi un moyen
commode pour l'administration que de mettre sur son compte, et
de rejeter comme nuls, les témoignages qui la desservent.
« Pour moi, dit-elle, le drame de Tchernobyl
a été doublé d'un autre : alors que
je n'avais plus d'illusions sur le présent, la glasnost,
coïncidant avec Tchernobyl, a révélé
le passé tragique du pays dont je ne savais rien. Je croyais
en notre Etat et qu'il nous aiderait après Tchernobyl,
mais le passé de l'URSS m'a fait comprendre pourquoi il
est vain aujourd'hui d'attendre d'un tel Etat une attitude humaine. »
Formellement toujours membre du Parti, son système de valeurs
a basculé. Depuis, elle cherche à s'adresser directement
à l'opinion publique, mais en quatre ans les médias
officiels n'ont publié que trois de ses articles, après
les avoir charcutés. Elle s'est donc tournée surtout
vers les irradiés eux-mêmes, pour secouer leur apathie,
pour les inciter à exiger de l'Etat qu'il les soigne, les
dédommage et les préserve des suites de la catastrophe.
Elle a contribué à la constitution de l'association
Les enfants de Tchernobyl, du mouvement des Verts d'Ukraine,
ainsi que d'organisations autonomes de victimes.
Surmontant sa maladie et celle de sa fille, elle s'arrime aujourd'hui
à sa nouvelle raison de vivre : témoigner.
Rôle rempli d'épreuves, comme en témoigne
ce poème, intitulé Cassandre.
« Ils te chasseront demain
comme ils l'ont fait hier,
toi, la folle Cassandre.
Ta bouche,
la vérité l'ensanglanta,
n'annonce que le malheur.
Ce cri,
qui le poussera si tu ne le fais ?
Cette vérité,
qui la verra si tu ne la dis ?
Qui dévoilera ce qui s'est passé ?
pour que, enfin, les gens se lèvent.
Fouaillé par mille soleils,
ce continent de malheur,
quelle âme s'y mesurera ?
Poids trop lourd, lumière trop cruelle. »
L'autre volet de son témoignage est
plus prosaïque. C'est le manuscrit: Tchernobyl, DSP.
DSP est le sigle du
secret, apposé sur les documents « exclusivement
à l'usage de l'administration ». Le
manuscrit est bâti sur un kilo et demi de documents DSP,
transmis clandestinement à Lioubov par les fonctionnaires
soviétiques chargés de la décontamination
de la région, des soins (combien dérisoires) aux
irradiés ou de l'exploitation des trois réacteurs
de Tchernobyl, remis en activité après la catastrophe.
Le manuscrit n'apporte pas une analyse globale du plan de traitement
des suites de la catastrophe. Mais c'est un échantillonnage
qui démontre clairement que les autorités, faute
de plan cohérent, de moyens et de volonté politique,
se satisfont de demi-mesures qui augmentent encore le gâchis
plutôt qu'elles ne le maîtrisent. Par contre, aucun
effort n'est épargné pour masquer aux yeux de l'opinion
l'impuissance des autorités.
Tchernobyl, DSP, pas plus que le Journal de Tchernobyl,
n'a pu être édité en URSS [Tchernobyl,
DSP fut publié
en 1995]. Lioubov était à Paris le mois dernier
avec ses manuscrits pour leur trouver un éditeur.
Une bouteille à la mer ?
Basile Karlinsky,
L'autre Journal n°1, mai 1990.