[Les remarques entre crochets sont d'Infonucléaire]
L'essais à Totsk en 1954
Voir "La bombe rouge" en vidéo Youtube raconté par
Sean Barrett (1994).

Une des rares photographies disponibles
de l'explosion nucléaire sur le site d'essais de Totsk.
[Le Webmaster d'Infonucléaire, s'est vu confirmer (lors
d'un voyage à Moscou en 1990) par un journaliste de la
Pravda des Komsomols que la plupart des vétérans
de cet exercice étaient soit malades, soit handicapés,
soit morts !]
Lenta.ru, 14
septembre 2024:
Le 14 septembre 1954, il y a exactement 70 ans, se déroulait
le seul exercice militaire de l'histoire soviétique impliquant
de véritables armes nucléaires. Une bombe atomique
de 40 kilotonnes fut larguée depuis un avion, après
quoi des fantassins lancèrent une offensive contre des
positions ennemies simulées. Trente-neuf mille soldats
et 6 000 officiers prirent part à cet exercice, commandé
par le maréchal Gueorgui Joukov. Cet exercice, baptisé
« Snezhok » (Boule de Neige), se déroula
sur le site d'essais de Totsky, dans la région d'Orenbourg.
Il s'agirait vraisemblablement d'une réponse à des
actions similaires menées par les États-Unis. Comme
l'a rapporté TASS quelques jours plus tard, l'essai a fourni
des données précieuses pour la défense contre
une attaque nucléaire. Cependant, certains pensent que
l'insuffisance des mesures de protection a entraîné
une exposition aux radiations du personnel et des habitants. Par
la suite, de nombreux témoins des événements
se sont plaints de diverses maladies, les attribuant à
l'explosion de la bombe atomique. Un surnom fut même donné
aux participants : les soldats atomiques. Lenta.ru relate
les essais d'armes nucléaires les plus controversés
en Union soviétique.
« Il y avait des incendies
partout, des oiseaux aux ailes brûlées s'envolaient.
»
À neuf heures et demie du matin, un
rugissement infernal secoua la steppe d'Orenbourg : le sol
sembla trembler et céder sous leurs pieds. Un Tu-4, commandé
par le major Vassili Kutyrchev, venait de larguer une bombe atomique
d'une altitude de 8 000 mètres. Une onde de choc passa,
suivie d'un éclair aveuglant, créant un nuage en
forme de champignon lumineux dans l'air.
Les habitants terrifiés des villages de Baklanovka et d'Ivanovka
sortirent dans les rues et virent un énorme nuage noir
se diriger droit sur eux. La panique s'empara des habitants ;
nul ne doutait que ce soit la fin. De vieilles femmes priaient
frénétiquement, implorant Dieu d'avoir pitié
de leurs enfants, tandis que d'autres couraient se cacher dans
les caves. Naturellement, personne ne savait qu'une bombe deux
fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima venait
de s'abattre sur leurs terres.
« Le sol s'est transformé en
scories et a été retourné », se
souvient le major I. Boukhonovsky, qui s'est retrouvé dans
la zone d'essai une demi-heure après l'explosion. «
Des incendies se sont déclarés partout, des oiseaux
aux ailes calcinées s'envolaient. De nombreux animaux d'essai
ont été brûlés, et de nombreuses vaches,
moutons et chevaux ont été blessés. »
Lorsque le bruit s'apaisa un peu, l'ordre fut
donné : « Au combat ! » Les soldats sortirent
précipitamment de leur abri, commencèrent à
dégager leurs positions et leur équipement, puis
se dirigèrent vers l'épicentre de l'explosion. Simultanément,
un puissant barrage d'artillerie, d'une ampleur que même
ceux qui avaient participé à l'assaut de Berlin
n'avaient jamais vue, commença, ainsi que des bombardements
aériens. [...]
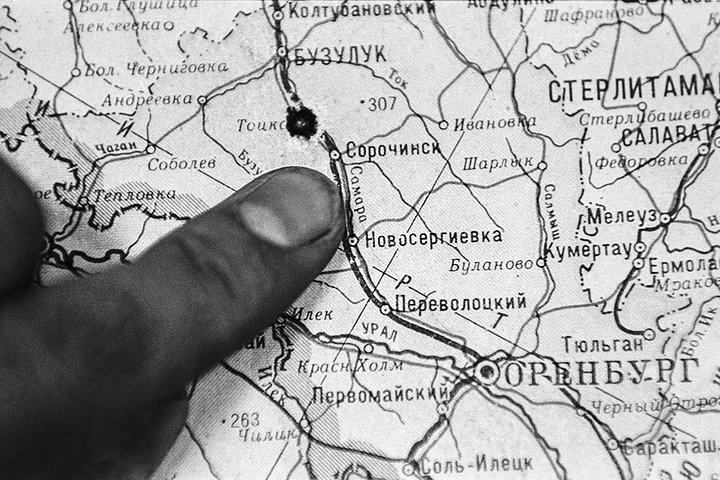 Le
terrain d'entraînement de Totsky.
Le
terrain d'entraînement de Totsky.
[...] La décision du gouvernement
soviétique de mener des exercices militaires utilisant
des armes nucléaires avait plusieurs raisons : des essais
réussis sur le territoire soviétique et des rapports
sur les préparatifs américains en vue d'une action
en cas d'explosion d'une bombe atomique.
Le plan Dropshot fut ensuite développé à
l'étranger, prévoyant le largage de 300 bombes atomiques
sur 100 villes soviétiques. Les États-Unis avaient
déjà mené plusieurs exercices militaires
utilisant des armes atomiques depuis 1951, contrairement à
l'Union soviétique. Par conséquent, les exercices
sur le site d'essais de Totsk étaient considérés
par le commandement soviétique comme « notre réponse
à l'ennemi ».
« Nous ne le souhaitions pas ; ce n'était
pas une fin en soi, mais les États-Unis, qui avaient lancé
la course aux armements, nous y ont contraints », a
écrit le célèbre commandant militaire soviétique
Valentin Varennikov dans ses mémoires. « Et
nous avons tout fait pour maintenir la défense du pays
à un niveau élevé et garanti. »
L'armée a lancé les essais. Le
29 septembre 1953, le Conseil des ministres de l'URSS a publié
un décret autorisant le début de l'entraînement
des forces armées aux opérations dans des conditions
spéciales. Les scientifiques et les concepteurs du KB-11
ont créé la bombe atomique pour ces exercices ;
une bombe identique avait été testée sur
le site d'essais de Semipalatinsk quelques années auparavant.
[...] Le village de Totskoïe est situé entre les rivières
Samara, Tok et Maly Uran. Le terrain d'entraînement est
accidenté, avec des collines, des ravins, des bosquets
et des arbustes, et le sol est sablonneux. Les zones dégagées
permettaient une progression rapide, mais la forêt entravait
les mouvements des troupes. En bref, les soldats soviétiques
se préparaient à une véritable guerre.
Le général d'armée Ivan Petrov devait initialement
être chargé de la préparation et de la conduite
des exercices, mais il tomba gravement malade et retourna à
Moscou, remplacé par le vice-ministre de la Défense
Gueorgui Joukov. C'est le célèbre maréchal,
formé aux méthodes militaires classiques et ayant
participé à la Première Guerre mondiale,
qui eut l'occasion de tester en conditions de combat l'arme la
plus terrifiante, développée sous la direction de
son adversaire, Lavrenti Beria .
[...] Au début des essais, le général Petrov
s'était rétabli et avait pris le commandement des
troupes, et le maréchal Joukov avait pris en charge les
exercices dans leur ensemble.
Des troupes sélectionnées avaient commencé
à converger vers la station de Totskaïa, dans le sud
de l'Oural, plusieurs mois auparavant. Les soldats avaient construit
des routes, creusé des abris et des tranchées, recouvert
les abris de plusieurs couches de rondins et enduit les parties
saillantes de bois d'argile jaune pour les empêcher de s'enflammer
au soleil.
L'armée a dû déployer
sur le terrain 320 avions, 600 chars et unités d'artillerie
automotrices, 500 canons et mortiers, 600 véhicules blindés
de transport de troupes, 6 000 tracteurs et véhicules.
Les marches forcées devaient être
effectuées avec des masques à gaz, malgré
une chaleur estivale extrême, atteignant 40 degrés
Celsius. [...]
« L'objectif des exercices était plus militaire que
politique », a expliqué à Lenta.ru Mikhaïl
Mints, chercheur principal à l'Institut d'information scientifique
sur les sciences sociales de l'Académie des sciences de
Russie. « Les troupes ont eu l'occasion de s'entraîner
au combat offensif et défensif après une frappe
nucléaire. Le deuxième objectif était d'explorer
la possibilité d'utiliser des armes nucléaires directement
sur le champ de bataille. Cette idée était déjà
largement débattue à l'époque, et ils souhaitaient
apparemment la tester expérimentalement. Pourquoi avoir choisi le terrain d'entraînement
de Totsky, entouré de villages de tous côtés
? Le terrain y est similaire à celui de l'Europe occidentale. Il était donc parfaitement adapté à
la simulation d'opérations de combat [en situation réelle
de guerre en territoire ennemi]. »
Les habitants du village de Makhovka, le plus proche du site d'essai,
ont été évacués hors de la zone interdite.
Les habitants ont été rassemblés de manière
organisée et transportés plus loin, hébergés
temporairement dans de grandes tentes militaires. Ils ont reçu
une indemnité journalière pour toute la durée
de l'exercice. Ceux qui n'ont pas souhaité retourner à
leur lieu d'origine après les essais se sont vu attribuer
des maisons construites sur la rivière Samara, tandis que
les autres ont reçu une indemnité de relogement.
Les habitants de Baklanovka
et d'Ivanovka, quant à eux, n'ont pas été
évacués : on leur a simplement conseillé
de se cacher dans des caves et des sous-sols le jour des essais,
ou, mieux encore, de creuser une tranchée dans leur jardin
et de s'y installer.
Comme le souligne Andrey Ozharovsky, ingénieur,
physicien et expert du programme de sécurité des
déchets radioactifs, l'impact négatif des rayonnements
ionisants et de la contamination radioactive a été
sous-estimé dans les années 1950 : aucun accident
ne s'était encore produit dans Three Mile Island et à
Tchernobyl , on n'avait aucune idée du danger que représentait
le dernier facteur dommageable : la contamination nucléaire.
« À l'époque, les pays se préparaient
sérieusement à une guerre nucléaire, préparant
du matériel et du personnel », a rappelé Ozharovsky
à Lenta.ru. « Des exercices militaires utilisant
de véritables armes nucléaires ont été
menés non seulement en URSS, mais aussi aux États-Unis.
C'est une excuse superficielle, sous prétexte que nous
ne sommes pas les pires contrevenants ici, mais comme tout le
monde. Globalement, [ces exercices] sont assurément mauvais.
Leur objectif principal était la préparation psychologique.
Nous devions démontrer que nos soldats étaient si
bien entraînés qu'ils attaqueraient à travers
l'épicentre d'une explosion nucléaire. Ils n'avaient
aucun autre but. »
Le centre de l'explosion fut marqué dans une vieille chênaie,
à environ 20 kilomètres du camp principal, où
une croix blanche de 100 mètres sur 100 fut peinte. Dans
la même zone, les troupes du génie établirent
une ligne défensive pour l'ennemi simulé. Une répétition
générale eut lieu fin août. Environ un mois
auparavant, les exercices de bombardement habituels avaient commencé :
des avions arrivaient à l'épicentre et larguaient
des bombes factices. Jusqu'au dernier moment précédant
l'explosion, les pilotes ignoraient qui serait chargé de
la mission principale.
Quelques jours avant les
exercices, des délégations militaires des pays socialistes
commencèrent à arriver au village de Totskoïe,
accompagnées de hauts dirigeants militaires soviétiques
- les maréchaux Alexandre Vassilievski, Constantin Rokossovski,
Ivan Konev, Rodion Malinovski - et les tout derniers à
arriver furent le chef du projet atomique Igor Kourtchatov, le
ministre de la Défense Nikolaï Boulganine et le premier
secrétaire du Comité central du PCUS Nikita Khrouchtchev.
Ce n'est qu'en voyant l'académicien à la barbe caractéristique,
dont le portrait a été publié dans les journaux,
que les soldats ont commencé à comprendre que quelque
chose d'inédit et de grande envergure les attendait.
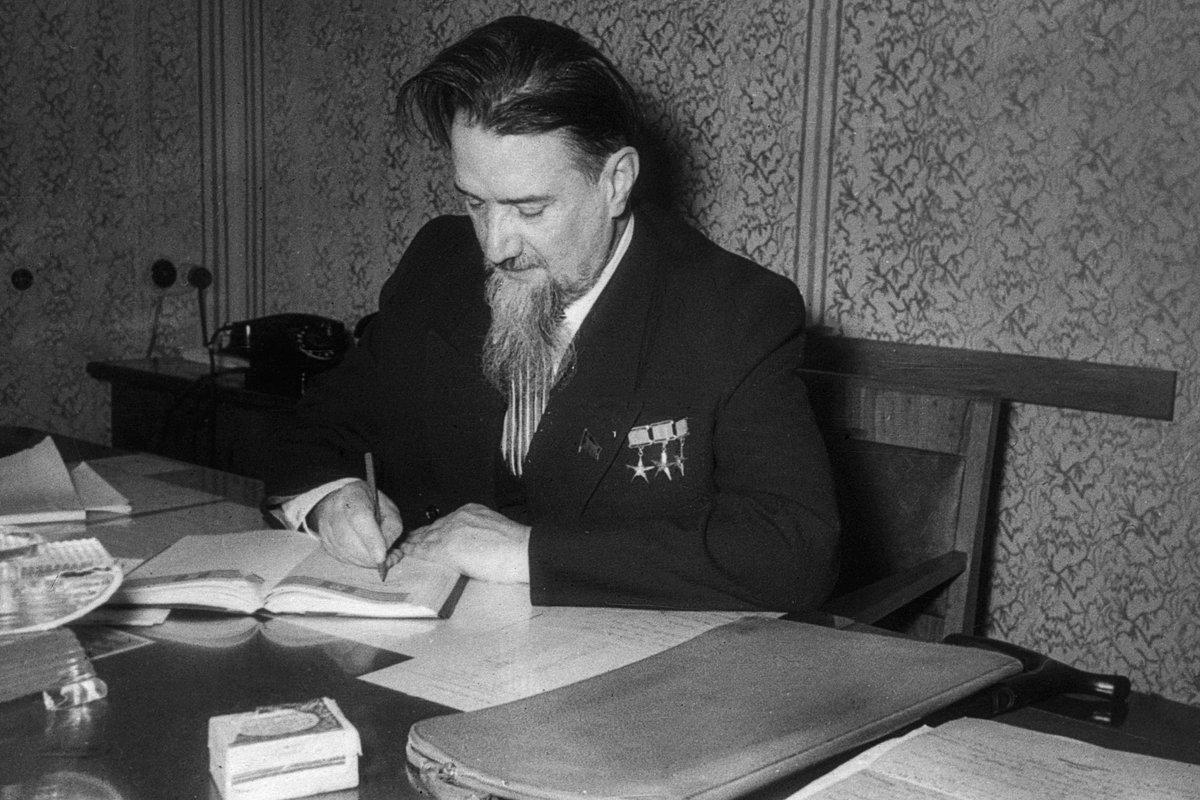 Igor Kourtchatov, directeur de l'Institut de
l'énergie atomique, après une inspection préalable
au lancement du réacteur nucléaire de recherche,
1960.
Igor Kourtchatov, directeur de l'Institut de
l'énergie atomique, après une inspection préalable
au lancement du réacteur nucléaire de recherche,
1960.
« Les bûches s'élevaient
dans les airs comme des grains de poussière. »
 Tôt le matin
du 14 septembre 1954, les troupes prirent leurs positions initiales :
les troupes « ouest » étaient sur
la défensive, positionnées à 10-12 kilomètres
du centre de l'explosion, tandis que les troupes « est »,
en progression, se trouvaient à cinq kilomètres
de là, de l'autre côté de la rivière.
Pour des raisons de sécurité, leurs unités
de tête furent retirées de la première tranchée
et stationnées dans des abris.
Tôt le matin
du 14 septembre 1954, les troupes prirent leurs positions initiales :
les troupes « ouest » étaient sur
la défensive, positionnées à 10-12 kilomètres
du centre de l'explosion, tandis que les troupes « est »,
en progression, se trouvaient à cinq kilomètres
de là, de l'autre côté de la rivière.
Pour des raisons de sécurité, leurs unités
de tête furent retirées de la première tranchée
et stationnées dans des abris.
[...] À 9 h 20, le commandement, dirigé par Joukov,
reçut des informations sur la situation météorologique
et prit une décision finale. Le commandant du Tu-4, le
pilote Kutyrchev (qui avait déjà participé
aux essais de bombes atomiques sur le site de Semipalatinsk),
reçut l'ordre de décoller par radio. Au signal d'alerte
atomique, les troupes se mirent à l'abri.
Les soldats reçurent
des doublures teintées spéciales pour leurs masques
à gaz, des capes de protection en papier, des chaussettes
et des gants. Malgré la chaleur de 30 degrés, chacun
fut contraint de porter des sous-vêtements chauds, censés
protéger efficacement contre les radiations. [...]
« Pendant l'explosion, je me souviens de l'éclair
qui m'a violemment frappé les yeux », a
déclaré le soldat V. Trofimov. « Je
n'avais aucune idée de ce qu'était un tremblement
de terre, mais là, pour la première fois, j'ai senti
le sol trembler. Près de notre abri se dressait une solide
cabane de cultivateur de melons, taillée dans un chêne.
Je me souviens de l'onde de choc, et les rondins de la cabane
ont commencé à s'élever dans les airs comme
des grains de poussière. Un spectacle inoubliable. »
Les conséquences de
l'explosion stupéfièrent même les officiers
les plus expérimentés. Au lieu d'arbres, des pieux
calcinés se dressaient désormais, des chars fondaient
et s'enfonçaient dans le sol, et les animaux de laboratoire
étaient réduits à l'état de carcasses
calcinées (sauf ceux qui se trouvaient dans des abris).
Bien sûr, les résultats variaient selon la distance
par rapport à l'épicentre, où il ne restait
plus rien de vivant. Par exemple, les avions
stationnés jusqu'à 1 800 mètres et au-delà
restaient pratiquement intacts s'ils étaient sous des abris
spéciaux. D'autres étaient partiellement calcinés.
Les animaux à deux kilomètres de l'explosion n'ont
subi pratiquement aucun dommage.
L'explosion a retenti jusqu'aux maisons du
village, fissurant les murs. L'onde de choc a été
si puissante que les fenêtres d'une école de Sorotchinsk,
à 40 kilomètres du site d'essai, ont volé
en éclats. Cependant, une seule maison, située sur
une colline beaucoup plus proche, a été complètement
détruite.
« Il y avait un mur noir et
solide de fumée et de poussière, de puanteur et
de suie. »
L'acte suivant était arrivé.
Après l'explosion, les « Occidentaux » retournèrent
à leurs positions détruites. Les « Orientaux
» lancèrent une offensive et simulèrent une
véritable bataille terrestre après une frappe nucléaire.
A 10h10, ils ont attaqué les positions de l'ennemi simulé,
puis les combattants ont continué leur avancée en
colonnes de matériel militaire.
« Nous nous sommes précipités hors de l'abri
», se souvient l'artilleur I. Putivlsky. «
Le vent s'est levé et, à l'horizon, un énorme
champignon rouge plomb a poussé, gonflant de sa tige, grandissant
et s'élevant de plus en plus haut. Mais nous n'avons pas
eu le temps de l'examiner. Le barrage d'artillerie a commencé.
»
Selon son témoignage, les artilleurs
avaient reçu l'ordre de tirer tous les obus à temps,
ce qui était formellement interdit lors de l'offensive.
Tout s'est transformé en un grondement incessant.
« Nous avons rapidement constaté que les canons avaient
jauni et fumé : la plupart des munitions avaient été
utilisées », a poursuivi le participant à
l'exercice. « Nous avons ralenti la cadence de tir. Le barrage
a progressivement diminué. »
À quatre ou cinq kilomètres de l'épicentre
de l'explosion, les soldats commencèrent à rencontrer
d'immenses chênes aux cimes épaisses, déracinés,
et des troncs et des bûches desséchés qui
brûlaient. Plus près du centre, l'onde de choc n'avait
même pas épargné les arbres rabougris :
ils gisaient comme s'ils avaient été polis par un
fer géant.
L'équipe de reconnaissance progressa,
surmontant les incendies et les décombres, et vers midi,
le détachement avancé atteignit l'épicentre
de l'explosion. Au même moment, des explosifs simulant des
explosions atomiques furent mis à feu, afin de former l'armée
à opérer en zones contaminées par la radioactivité.
« Nous avons traversé
la vallée, à un kilomètre et demi de l'épicentre
de l'explosion, avec masque à gaz », a décrit Putivlsky. « Des
avions à pistons, des voitures et des véhicules
d'état-major brûlaient, et des animaux calcinés
gisaient éparpillés. Un épais mur noir de
fumée et de poussière, d'odeurs et de vapeurs, s'élevait.
Nos gorges étaient sèches et irritées, et
nos oreilles bourdonnaient. »
Les avions participèrent également
activement aux exercices, soutenant l'avancée des troupes
par des raids terrestres. Il était interdit aux pilotes
de pénétrer dans le nuage radioactif ou de le survoler,
mais à 40-45 kilomètres de la cible, la zone était
déjà enveloppée d'une épaisse fumée
gris-noir. Alors que deux escadrons de tête établissaient
leur trajectoire de combat et larguaient leurs bombes avec succès,
le commandant du troisième prit les nuages de poussière
soulevés par les explosions pour un champignon atomique.
Après le bombardement, les MiG-15, ayant atteint l'aérodrome,
s'écrasèrent, aveuglés, sous une tempête
de poussière qui faisait rage au-dessus d'eux.
[...]
« Après les exercices, ils ont fait preuve de courage :
"Le diable nucléaire n'est pas aussi effrayant qu'on
le dit" », a-t-il déclaré après
l'expiration du délai de confidentialité de 25 ans.
« Mais plus tard, des maux de tête, des malaises,
des problèmes de vision et d'articulations sont apparus,
et presque tous ont dû suivre un traitement. »
 [juste]
après l'explosion nucléaire.
[juste]
après l'explosion nucléaire.
« Des radiations ?
Qui aurait pensé à ça à l'époque ! »
[...] Mais le véritable débat
sur les dommages causés à la santé publique
n'a éclaté que quarante ans plus tard, au début
des années 1990, lorsque les personnes impliquées
dans ces événements ont finalement pris la parole.
Désormais âgées, elles ont choqué un
public soucieux de réformes démocratiques.
Par exemple, un participant
a affirmé qu'après l'explosion de la bombe, l'équipement
et les uniformes n'avaient même pas été décontaminés.
Les soldats avaient reçu des ceinturons en cuir au lieu
de ceinturons en toile, comme d'habitude (apparemment en raison
de l'importance particulière de l'événement),
et personne ne voulait se séparer d'un bien aussi précieux :
ils sont retournés dans leurs unités avec ces ceinturons,
ainsi que de vieilles bottes et les vieilles armes, qui nt changé
de mains à maintes reprises depuis.
« Les radiations ? Qui aurait pensé
à ça à l'époque ! »
s'exclama un autre participant en haussant les épaules.
« Après
l'explosion, on s'est lavés aux bains, on a changé
d'uniformes, et c'est tout. On est repartis dans les mêmes
véhicules qu'à l'arrivée. On a même
emporté nos cuisines de campagne On s'est rendus à
l'épicentre de l'explosion sans masques à gaz. La
poussière était terrifiante. On a ensuite signé
un document promettant 25 ans de silence, et on est partis
servir dans nos unités. Notre génération
ne pensait pas à elle à l'époque, mais à
la cause. On était fiers d'avoir été recrutés. »
Mais la fierté s'est évaporée
et, il y a plus de trente ans, d'anciens militaires se sont plaints
en masse dans les journaux, affirmant qu'eux, qui avaient aidé
l'État à forger sa puissance militaire et politique,
avaient été tout simplement oubliés. Les
journalistes les ont surnommés « soldats atomiques ».
« J'étais soldat et je ne pouvais pas tout savoir
», a déclaré Vladimir Bentsianov, participant
à l'exercice et plus tard président du Comité
des vétérans des unités à risque spécial.
« Mais il est notoire que les conséquences potentielles
d'une explosion nucléaire ont été sous-estimées
pendant l'exercice. Je pense que cela s'est produit parce que
les responsables directs de l'exercice avaient une mission stricte
et très précise : livrer des armes d'une certaine
puissance dans un délai déterminé, à
tout prix. »
Bentsianov pensait qu'il était tout à fait possible
de confirmer la relation de cause à effet entre les maladies
parmi les militaires et les civils et leur participation aux tests,
mais cela aurait coûté beaucoup d'argent.
Ses propos furent largement confirmés
par le colonel à
la retraite M. Voronov, dont l'unité manquait d'équipement
de dosimétrie pour mesurer la dose de radiation reçue.
Selon ce soldat, les connaissances sur les explosions atomiques
et leurs effets sur l'homme étaient alors limitées,
ce qui lui permit de travailler pendant environ un mois dans la
zone de l'explosion sans protection adéquate. « L'attitude incompétente des hauts dirigeants
envers le personnel opérant dans des zones contaminées
radioactivement, comme le temps l'a montré, a conduit à
la mort prématurée de nombreux participants aux
exercices de Totskoïe », était certain Voronov.
[...]
 Un
bombardier Tu-4 exposé au Musée de Monino, 1970.
Un
bombardier Tu-4 exposé au Musée de Monino, 1970.
[...] les
observations des scientifiques, qui ont déjà constaté
entre 1985 et 1993 une augmentation significative des cas de cancer
au sein de la population locale de la zone de l'explosion nucléaire.
D'après les spécialistes de la branche ouralienne
de l'Académie des sciences de Russie, les tumeurs malignes
des organes respiratoires étaient 225 % plus fréquentes,
les cancers de la thyroïde 260 %, les cancers de la peau
131 % plus fréquents et les maladies des systèmes
lymphatique et hématopoïétique 670 % plus fréquentes.
L'incidence globale des cancers infantiles a doublé. Le
taux de mortalité a été multiplié
par 2,3 entre 1964 et 1991.
Les scientifiques ont découvert des
taux élevés d'anomalies chromosomiques chez les
habitants de ces régions, les enfants en étant deux
fois plus souvent atteints que les adultes. La situation a été
comparée à celle de la région de Briansk après l'accident de la centrale
nucléaire de Tchernobyl.
« Malheureusement, à ma connaissance, il n'existe
pas de statistiques médicales fiables sur les victimes
», conclut l'ingénieur et physicien Ozharovsky. «
Les exercices étaient classifiés. Certaines victimes
ont pris leur courage à deux mains et ont commencé
à s'exprimer pendant la période de la glasnost.
Nombre d'entre elles se sont battues pour figurer parmi les liquidateurs
de Tchernobyl. »
Selon l'historien Mintz, des précautions ont certes été
prises pour protéger les soldats et la population locale,
mais elles se sont avérées insuffisantes. L'expert
de Lenta.ru est convaincu que la méconnaissance des conséquences
d'une explosion nucléaire, ainsi que le mépris général
du commandement envers le personnel, ont conduit à ces
conséquences tragiques.
« Les généraux pensaient que des mesures suffisantes
avaient été prises », explique Mintz. «
En réalité, les "Orientaux" se trouvaient
dans la ligne de mire [de l'explosion nucléaire] et ont
reçu leur dose de radiation au moment de l'explosion. De
plus, les deux camps combattaient alors sur un terrain déjà
contaminé par des retombées radioactives. Il n'est
pas surprenant que les soldats aient finalement été
exposés aux radiations, tout comme les habitants des villages
voisins. Cela illustre clairement l'attitude envers leurs concitoyens
à l'époque. »
De l'avis de l'historien, les exercices sur le terrain d'entraînement
de Totsk n'eurent aucune incidence sur l'attitude des autorités
envers Joukov : sa carrière fut davantage marquée
par divers bouleversements politiques. Coïncidence ou non,
en février 1955, le maréchal fut nommé ministre
de la Défense de l'URSS, en remplacement de Boulganine.
Les exercices de Totsk restent uniques dans
l'histoire de notre pays : aucun essai représentant
une menace directe pour les troupes et les civils n'a été
reconduit. La raison pour laquelle le gouvernement soviétique
a décidé de ne pas les répéter demeure
un mystère. Selon l'historien Mintz, seules les archives
déclassifiées apporteront la réponse.
« Le gouvernement soviétique n'a jamais reconnu
que la santé des soldats et des agriculteurs locaux avait
été irrémédiablement affectée
», rappelle l'expert. « Il s'agissait d'un
test expérimental de l'idée même qui a donné
naissance plus tard à toutes les armes nucléaires
dites non stratégiques. L'armée soviétique
en était équipée en quantités prohibitives.
Un certain nombre d'ogives sont encore en service aujourd'hui.
L'idée que
les armes nucléaires puissent être utilisées
sur le champ de bataille, par exemple pour percer des défenses
préparées, n'a jamais disparu. »
Les changements géopolitiques du début
du XXe siècle ont entraîné des tournants surprenants.
En 1994, des exercices conjoints russo-américains ont eu
lieu sur le terrain d'entraînement de Totsky, impliquant
250 militaires de chaque côté. L'événement
a déclenché une vague de mécontentement parmi
les patriotes : des dizaines de communistes et de nationalistes
de Moscou, Samara , Ekaterinbourg et Tcheliabinsk se sont rassemblés
pour protester, accueillant les invités étrangers
au slogan : « Yankees, dehors la Russie ! ».
La même année, des habitants des villages voisins
se sont plaints auprès des journalistes que les autorités
ne les avaient pas indemnisés pour les dommages moraux
et les pertes de santé causés par la contamination
radioactive de la zone.
Dmitry Okunev
Kedr Media, 10
septembre 2024:
Témoignages de survivants
de l'explosion nucléaire dans la région d'Orenbourg.
À l'occasion de l'anniversaire de la tragédie de
Totsk.

Explosion nucléaire sur le site d'essais
de Totskoïe.
« Ils ont dit que nous avions un grand
honneur. »
Dans le contexte du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine,
la rhétorique nucléaire se fait de plus en plus
virulente. Le 27 août, le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov, a déclaré que le pays pourrait
modifier sa doctrine nucléaire . Il n'a pas précisé
comment, mais on sait que la version actuelle du document ne prévoit
que quatre situations dans lesquelles le pays pourrait utiliser
l'arme nucléaire :
- réception d'informations fiables sur le lancement de
missiles balistiques attaquant le territoire de la Fédération
de Russie et (ou) ses alliés ;
- l'utilisation par l'ennemi d'armes nucléaires ou d'autres
types d'armes de destruction massive sur les territoires de la
Fédération de Russie et (ou) de ses alliés
;
- impact ennemi sur des installations étatiques ou militaires
d'importance critique de la Russie, dont la neutralisation entraînerait
la perturbation des actions de réponse des forces nucléaires
;
- agression contre la Fédération de Russie au moyen
d'armes conventionnelles, alors que l'existence même de
l'État est en danger.
Le site d'essais central du ministère de la Défense
en Nouvelle-Zemble
est maintenu en état de préparation aux essais nucléaires
depuis février 2023. Le Kedr et des experts ont
déjà signalé que ces essais nuisent systématiquement
à la nature et aux populations des pays qui les effectuent.
Ceci est également confirmé par des témoignages
de témoins oculaires d'explosions nucléaires. Certains
de ces témoins sont encore en vie, tandis que les expériences
d'autres ont été documentées dans des articles
scientifiques.
Le 14 septembre marque le 70e anniversaire des exercices militaires
impliquant des armes nucléaires près du village
de Totskoïe, dans la région d'Orenbourg. À
l'époque, en 1954, l'armée avait fait exploser une
bombe atomique RDS-2 , nom de code « Tatyanka », à
10 kilomètres d'habitations. Ces exercices étaient
d'ailleurs affectueusement surnommés « Snezhok ».
Le lieu de l'essai nucléaire fut choisi avec soin :
le paysage du district de Totsky, dans la région d'Orenbourg,
rappelle celui de l'Allemagne de l'Ouest, où les dirigeants
soviétiques pensaient que la Troisième Guerre mondiale
pourrait éclater. Le maréchal Joukov commandait
personnellement les exercices. Environ 50 000 soldats y participèrent
: certains pratiquèrent des manoeuvres offensives, d'autres
des manoeuvres défensives. Par la suite, de nombreux participants
aux exercices, ainsi que des civils restés à 10-15
kilomètres du lieu de l'explosion, commencèrent
à se plaindre de graves problèmes de santé.
Cependant, en raison du secret entourant les exercices, personne
n'analysa l'impact précis de l'explosion de Tatianka sur
la population.
« Kedr » publie des témoignages
recueillis personnellement par l'auteur, ainsi que ceux issus
d'archives et de monographies militaires. Nous les présentons
sous forme de monologues : les histoires de ces personnes parlent
d'elles-mêmes.
 Le
terrain d'entraînement militaire de Totsky. Image tirée
du documentaire « Irradiation ».
Le
terrain d'entraînement militaire de Totsky. Image tirée
du documentaire « Irradiation ».
« C'était une vraie fête de village »
Valery Astafyev, en 1954 un habitant
du village de Totskoïe, un écolier :
J'étais en quatrième à l'époque. En
mai, quatre mois avant l'explosion, mes amis et moi sommes allés
à la rivière Samarka. Nous l'avons traversée,
sommes entrés dans la forêt, et soudain, un soldat
nous a barré le chemin : "Attendez, où allez-vous
?" Nous lui avons dit que nous courrions, jouions et cueillions
toujours des baies ici. Il a dit : "Ça y est, [c'est]
est interdits maintenant. N'allez plus dans la forêt. C'est
la ferme d'Ivanov maintenant."
Nous avons appris plus tard que les unités militaires stationnées
près de Totskoïe étaient qualifiées
de « fermes » par les soldats eux-mêmes dans
leurs conversations avec les civils. Pourquoi ? Je l'ignore.
À l'approche de l'été, de nouvelles unités
ont commencé à arriver. Les soldats qui y servaient
retournaient à Totskoïe sans permission. Nous leur
demandions : « Que se passe-t-il ? » Mais ils répondaient
simplement qu'ils n'en savaient rien : « Quelque chose de
grave va se produire, mais ils ne nous disent rien. »
Les militaires ne se cachaient pas des civils : ils organisaient
des concerts et des événements sportifs, installaient
un terrain de football à Totskoïe et jouaient des
matchs deux fois par semaine. Il y avait des équipes de
l'armée de l'air et de l'infanterie. Pour nous, villageois,
c'était un événement important.
Bien sûr, nous les entendions s'entraîner. Toutes
les deux semaines, à 4 heures du matin, des coups de feu,
le vrombissement des véhicules et les tirs d'artillerie
retentissaient de l'autre côté de la rivière.
Puis vinrent deux semaines de silence : pendant ce temps, nous
étions autorisés à aller sur les terrains
d'entraînement cueillir des baies et des champignons. Puis,
deux autres semaines de fusillades.
 Valery Astafyev.
Image tirée du documentaire « Irradiation ».
Valery Astafyev.
Image tirée du documentaire « Irradiation ».
Mon père était vice-président
du comité exécutif du district du Parti communiste
de l'Union soviétique. Il assistait aux réunions
du quartier général présidées par
le maréchal Joukov, mais il ne disait rien ; il ne prévenait
personne à la maison de ce qui allait se passer.
Et les préparatifs étaient sérieux. Les habitants
des villages situés à moins de 10 kilomètres
de l'épicentre ont été relogés dans
de nouvelles maisons près de Sorotchinsk, à 40 kilomètres.
Ces villages faisaient administrativement partie du district de
Sorotchinsk, pas du nôtre. Comment le relogement a-t-il
été expliqué aux gens ? Je l'ignore : j'étais
adolescent, après tout. Et à l'époque, le
gouvernement n'expliquait rien : si c'était nécessaire,
c'était nécessaire.
Le 12 septembre, deux jours avant les tests, des soldats ont commencé
à parcourir Totskoïe et ont donné des instructions
: nous devions constituer des réserves de nourriture pour
trois jours et retirer tous les matériaux inflammables
de la maison. Notre famille avait une cave à l'extérieur,
et nous y avons tout installé.
Le 14, jour de l'explosion, les militaires nous ont réveillés
à 4 heures du matin. Ils ont fait du porte-à-porte,
nous ont ordonné d'ouvrir portes et fenêtres, nous
ont interdit d'emmener notre bétail au pâturage et
nous ont dit que, sur leur ordre, nous devions nous cacher dans
nos jardins. Un soldat était affecté toutes les
dix maisons, avec un véhicule d'évacuation au cas
où le test échouerait. C'est seulement alors qu'on
nous a expliqué ce qui allait se passer.
À 9 heures du matin, ils ont donné
l'alerte d'une demi-heure. Ma voisine Gena et moi étions
allongés dans un sillon du jardin, près du puits.
Nous étions allongés sur le ventre, les bras au-dessus
de la tête, vêtus de vêtements d'été
légers. « Alerte vingt minutes », a dit le
soldat. Puis : « Alerte cinq minutes. »
Et à un moment, j'ai senti une secousse.
J'ai dit : « Gena, pourquoi tu me pousses ? » [elle]
a répondu : « Je ne te touche pas du tout ! »
Et le sol sous nos pieds a tremblé. Il y a eu un grand
bruit, et une vague d'air chaud nous a submergés. Mes oreilles
se sont débouchées. J'ai ouvert la bouche et j'ai
crié pour que ça s'arrête. Ça s'est
arrêté.
Nous sommes restés là encore dix minutes, car personne
n'avait reçu l'ordre de nous lever. Puis un soldat a crié
: « Rentrez chez vous ! » Gena et moi nous sommes
relevés et avons vu un énorme nuage de fumée
s'élever de la rivière. Tout était en feu,
le ciel était rouge vif et un champignon atomique planait
au-dessus de tout.
Je ne me souviens pas de mes émotions, plutôt de
la surprise. Mais les enfants et les adultes autour de moi pleuraient,
surtout les femmes. C'était effrayant.
Nous sommes rentrés. Un soldat est venu chez nous et s'est
plaint à ma mère de ses yeux qui lui piquaient.
Il s'est avéré qu'il avait vu l'explosion
bien sûr, il aurait dû s'en douter. Mais il a regardé.
Nous étions couchés la tête en bas, et les
soldats étaient debout ; ils pouvaient tout voir. Ma mère
lui a lavé les yeux avec du thé fort, et il a semblé
se sentir mieux.
Je suis monté sur le
toit de la maison et j'ai observé, fasciné, ce qui
se passait. Les avions militaires traversaient le champignon atomique
l'un après l'autre. Il me semblait qu'en entrant dans le
nuage de poussière, ils étaient légers et
qu'en ressortant, ils étaient noirs. C'était peut-être
vrai. Avec le temps, le champignon atomique s'est dissipé,
mais le nuage qu'il avait créé est resté.
Ce n'est que vers 19 heures qu'il a commencé à s'éloigner
vers le nord-est.
Vers sept heures et demie, les chars de retour de l'entraînement
ont commencé à circuler dans nos rues.
Les magasins ouvraient à
huit heures, et les hommes achetaient de l'alcool : « Nous
avons maintenant des armes nucléaires ! » Ils chantaient
: « Nous n'avons peur de personne, nous vaincrons tout le
monde. » Ils jouaient de l'accordéon, dansaient
c'était une vraie fête de village. Une pluie fine
tombait. Je ne sais pas si elle était radioactive, mais
je pense que oui. Personne ne parlait de ce qui allait nous arriver.
Quelques jours plus tard, après
le départ des militaires, les garçons et moi sommes
allés au champ de tir. Nous, les adolescents, étions
curieux de savoir ce qui restait après l'explosion. Nous
avons vu deux avions calcinés et un char renversé
. À une centaine de mètres de l'épicentre
se trouvaient des tranchées : certaines étaient
simplement en terre, d'autres bordées de planches, et une
autre avec des murs en béton. Toutes les tranchées
en planches étaient brisées, mais celle en béton
semblait plus ou moins intacte.
À l'épicentre même de l'explosion, la forêt
était complètement anéantie, et le sol semblait
laminé, recouvert d'une croûte vitreuse. Aucune végétation,
seulement un immense cratère et tout autour brûlé.
Nous sommes allés encore plus loin, jusqu'aux enclos à
bétail. Les soldats amenaient des chevaux et des vaches
des fermes collectives voisines au terrain d'entraînement.
Nous avons vu des fragments de leurs corps.
« Tout ce qui restait des animaux, ce sont des cendres.
»
Témoignage du vétérinaire
Leonid Pogrebinsky, enregistré par Valery Astafyev et l'écrivain
d'Orenbourg Vyacheslav Moiseyev après l'expiration de leur
accord de non-divulgation :
Des officiers de réserve furent appelés pour s'entraîner
au camp de Totsky. Ils reçurent l'ordre de recruter des
assistants, deux ou trois ambulanciers, et de sélectionner
dix animaux de chaque, âgés de deux ans maximum,
avec un nombre égal de mâles et de femelles. Nous
les avons récupérés dans les villages de
Nikolskoïe et de Baklanovka. Les responsables des kolkhozes,
semble-t-il, en reçurent l'ordre et, non seulement ils
ne s'opposèrent pas à la collecte du bétail,
mais ils demandèrent même à leurs spécialistes
de l'élevage de nous aider à le sélectionner.
On ne nous a pas dit quels tests seraient effectués. Mais
on nous a demandé de signer un accord de confidentialité
de 25 ans.
Le matin du 14 septembre, des zones de rassemblement avaient déjà
été préparées sur le terrain d'entraînement
de Totskoïe. Les chevaux étaient logés principalement
sous un auvent de dalles de béton d'environ 20 cm d'épaisseur,
creusées dans le sol en U ; le bétail était
logé sous d'épais pilotis, des couvertures de planches
et de clayonnage, et dans des stalles ouvertes. Tout cela se trouvait
à 700 mètres de l'épicentre de l'explosion.
Chevaux et moutons étaient également placés
dans des chars et des avions. Une fois la zone de rassemblement
terminée, le bétail était attaché
et les plus petits laissés dans des enclos. Toute notre
équipe était positionnée à environ
un kilomètre à l'est de l'épicentre. Les
tranchées des autres soldats mesuraient 1,8 mètre
de profondeur, mais les nôtres 2 mètres. La tension
était à son comble.
Lorsque l'alarme a retenti, nous nous sommes allongés,
les yeux fermés, masques à gaz à verres de
protection et imperméables. Nous avons d'abord aperçu
une lueur, puis la chaleur est devenue insupportable. Nous sommes
restés debout, trempés, au fond de la tranchée,
puis une secousse semblable à un tremblement de terre a
secoué la tranchée. Les parois ont bougé
et nous avons été complètement ensevelis.
Heureusement, l'un de nos hommes, Kolya de Toula, a réussi
à ramper jusqu'à la surface et a progressivement
dégagé le reste de l'équipe.



Image tirée d'une séquence d'archives filmée.
[Des animaux kamikazes: « Deux chevaux étaient
lentement menés par des soldats, attachés par des
cordes autour du cou. L'un était blanc, l'autre noir, tous
deux avaient les yeux crevés. Le blanc allait mieux ;
il ne souffrait que de légères brûlures. Le
noir, en revanche, était presque entièrement couvert
de croûtes. Il se déplaçait à petits
pas, et s'il essayait d'élargir ses foulées, ses
croûtes éclataient, le sang jaillissant des fissures.»
Moutons, vaches, chiens, chats, chameaux et même des singes :
tous étaient enchaînés autour de la cible
avant l'explosion. Les animaux étaient officiellement désignés
comme kamikazes ; ils avaient été déployés
par l'équipe biologique de Leonid Pogrebny : « De
ceux qui étaient à découvert, il ne restait
que des cendres. Dans les abris en bois, pour une raison inconnue,
nous n'avons trouvé que des sabots et des queues. Nous
n'avons même pas trouvé de cornes.» Les corps
furent ramassés et transportés vers le sud, au-delà
de la gare de Totskaïa, jusqu'à un cimetière
de six mètres de profondeur la fosse de décontamination
de Bekkari , arrosés d'essence et brûlés.
L'équipe de Pogrebnoy s'en occupa également. Un
an plus tard, l'un de ses assistants, l'assistant vétérinaire
Vikulov, reçut un diagnostic de cancer du poumon. Un an
et demi plus tard, un autre décéda d'un cancer du
foie et du pancréas. Le troisième à décéder
fut le commissaire Durnobragov. Pogrebnoy lui-même était
au bord de la leucémie, et sa famille ignorait où
il avait passé le mois de septembre un accord de
confidentialité de 25 ans lui interdisait de parler de
Totskoïe, même avec ses proches.]
Tard dans la soirée, nous avons été
autorisés à voir les animaux. Notre mission était
de les récupérer. Nous avons marché comme
sur du verre brisé : la température était
si élevée que le sable a fondu et que la croûte
s'est brisée sous nos pieds. Des ailes d'avion ont fondu,
des tourelles de chars ont été arrachées
et jetées. Nous avons commencé à rassembler
les animaux, et j'ai remarqué deux chevaux : un blanc et
un noir. Ils avaient été amenés d'un autre
endroit, à deux kilomètres de l'épicentre
de l'explosion. Tous deux avaient perdu la vue. Mais le cheval
blanc avait comparativement meilleure mine et était moins
blessé que le noir. Il marchait normalement, avec peu de
brûlures. En revanche, le cheval noir était une croûte
solide. Il faisait de petits pas, et s'il essayait d'aller plus
loin, ses croûtes éclataient, le sang jaillissant
des fissures.
Nous avons commencé à rassembler les animaux que
nous avions placés nous- mêmes. Les chevaux, qui
se trouvaient sous l'abri en béton, semblaient avoir été
ébouillantés avec de l'eau bouillante. Nous avons
ensuite découvert des brûlures aux voies respiratoires
supérieures.
D'autres animaux présentaient des brûlures
bien plus graves ; ils étaient simplement carbonisés.
Des animaux qui se trouvaient sous la clôture ou à
l'air libre, il ne restait que des cendres. Et de ceux qui se
tenaient dans des abris faits de pieux et de planches, pour une
raison inconnue, il ne restait que les sabots et l'extrémité
de la queue ; nous n'avons même pas retrouvé les
cornes.
Les cochons, les moutons et les lapins dans
les cages que nous avons laissées dans l'équipement
ont été tout simplement cuits.
Nous avons récupéré les animaux survivants,
principalement des chevaux, et une équipe d'évacuation
spéciale les a envoyés pour examen. Mon équipe
n'a effectué aucun test ; un groupe distinct a mené
les recherches. Le secret était si strict que même
ma femme ignorait où j'étais pendant ces jours de
septembre.
Sang blanc
Valery Astafyev, en 1954 un habitant
du village de Totskoïe, un écolier :
Six mois après
l'explosion, nous avons enterré mon ami Michka Kravchenko.
Le directeur de la station de machines et de tracteurs, Popkov,
est également décédé à la même
époque. En juin 1955, une fille de notre classe, Albina
Lambina, est décédée. Un agronome, un homme
respectable, travaillait avec mon père au comité
exécutif ; il est décédé un an et
demi plus tard. Tolya Kazachev, qui habitait avec moi dans la
rue voisine, est décédé peu après
avoir obtenu son diplôme universitaire. Les médecins
nous ont tous donné des diagnostics différents :
insuffisance cardiaque, par exemple. Mais ma mère avait
une amie, l'infirmière en chef de l'hôpital du district
de Totsk, qui venait nous voir et nous disait : « Ivan Petrov
est mort de leucémie », Zhenya Streltsov «
de leucémie ». Un nombre particulièrement
élevé de personnes sont mortes rue Samarskaïa,
plus proche de l'épicentre. Le dernier jeune de ma connaissance
à mourir de leucémie était mon ami Sacha
Zykov ; nous étions entrés ensemble à l'École
d'aviation Molotov . Il avait 33 ans.
Le schéma était le suivant : les hommes qui ont
vécu cette explosion jeunes n'ont pas vécu jusqu'à
40 ans.
Durant mes premières années d'université,
j'avais d'horribles maux de tête. La douleur était
atroce et je saignais constamment du nez. Je suis allé
chez le médecin et lui ai demandé : « Il y
a eu cette explosion, est-ce possible ? » Le médecin
a répondu : « Non, c'est impossible. » Et il
m'a prescrit un médicament contre le mal de tête.
Les autres médecins ne croyaient pas du tout à l'explosion
personne n'en avait jamais parlé. Les officiers étaient
tenus de garder le secret pendant 40 ans, les simples soldats
pendant 25 ans. Jusqu'en 1991, tout était entouré
de secret. Seul Eltsine,
devenu président, a publié un décret reconnaissant
les conséquences de jure de l'explosion de Totsk. Mais
même ce document ne concernait que l'armée. Personne
n'a parlé des conséquences pour la population civile.
Depuis 1992, j'écris à toutes les autorités
pour exiger que les civils présents dans les districts
de Totsky, Bouzoulouk et Sorochinsky au moment des essais soient
reconnus comme victimes des radiations. Mais je me suis heurté
à des refus. Vladimir Poutchkov, [ancien] ministre des
Situations d'urgence, m'a écrit que l'explosion nucléaire
de Totsky avait utilisé une charge qui « garantissait
l'absence de facteurs dommageables dans les zones adjacentes à
l'épicentre ». On m'a même demandé de
prouver que j'habitais à Totsky à l'époque
: curieusement, les archives du village ne contiennent aucun registre
[...] de 1954. Pourtant, mes voisins me connaissent et peuvent
le confirmer. Depuis 1992, j'ai fait le tour du ministère
de la Santé, de la Douma d'État et du Conseil de
la Fédération, mais je n'ai reçu que des
réponses formelles. Je ne sais pas comment faire reconnaître
les victimes de cette explosion. Même si mes parents sont morts d'un cancer, et
que j'en suis moi- même atteint.
« Nous avons respecté le bois
de chauffage atomique »
Zoya Volochenkova, en 1954, une jeune habitante
de Totskoye âgée de 17 ans :
En septembre, l'armée nous a ordonné de creuser
des tranchées dans les jardins et, sur signal, de nous
y allonger et de nous couvrir de couvertures. Ils ont annoncé
un événement, mais n'ont pas précisé
lequel. La veille de l'explosion, mes parents nous ont envoyés,
mon frère et mes deux surs, chez des proches du village
de Markovka, à 15 kilomètres du terrain d'entraînement.
Ils sont restés à Totskoïe. Ils ont creusé
une tranchée dans le jardin derrière la maison et
y ont attendu avec une voisine. [...] Mes parents n'aimaient pas
parler de cette explosion.
À l'époque, de nombreux enfants étaient évacués
de Totskoïe. Personne n'avait prévenu les gens de
ce qui allait se passer, mais tout le monde était terrifié.
Et si seulement ils avaient su...
 Zoya
Volochenkova. Image tirée du documentaire « Irradiation
».
Zoya
Volochenkova. Image tirée du documentaire « Irradiation
».
À Markovka, une tranchée séparée
avait été creusée pour tous les mineurs près
du jardin d'enfants. Nous étions censés y attendre
la fin de l'explosion. Mais le problème, c'est qu'on ne
l'a absolument pas ressentie. On ne voyait même pas le champignon
atomique à cause des arbres. On est restés assis
dans la tranchée jusqu'au soir, à jouer, puis on
nous a laissés sortir. Le lendemain, on nous a ramenés
à Totskoïe.
Personne n'a signalé
de danger. Presque immédiatement, les gens se sont dirigés
vers le site d'essai pour cueillir des baies et des champignons.
Ils ont également abattu des arbres brûlés
après l'explosion : le bois de chauffage nucléaire
était vénéré ici, car il brûlait
si bien.
Et puis le cancer est arrivé. Il a touché jeunes
et vieux. Ma mère est morte d'un cancer, mon père
était également malade, mais il a été
opéré à temps. Deux de mes camarades de classe
sont morts d'un cancer avant l'âge de 40 ans.
« L'oreiller était
couvert de sang. »
Vladimir Bentsianov, lieutenant d'artillerie
en 1954, a participé aux essais nucléaires de Totsk.
Ses souvenirs ont été recueillis par Valery Astafyev
:
Mon unité a traversé l'épicentre à
deux reprises, puis a continué sa route en véhicule.
À cinq kilomètres du lieu de l'explosion, nous avons
aperçu une école de village ; ses poutres avaient
été arrachées et elle brûlait à
proximité. Nous avons ensuite traversé la forêt
: les cimes des arbres étaient arrachées et leurs
troncs semblaient avoir été enfoncés dans
le sol et éclatés. Dans les trois villages traversés
(dont les habitants avaient été expulsés),
seules des cendres restaient à l'air libre, comme pendant
la guerre. Avant les exercices, nous avions signé un accord
de confidentialité concernant les secrets militaires. Nous
étions convaincus de deux choses : premièrement,
que les scientifiques et le commandement nous protégeraient
totalement des conséquences ; deuxièmement, qu'à
20 ans, on ne prête pas attention aux petits bobos.
Un an plus tard, j'ai commencé à voir des choses
et à ressentir de fortes douleurs à l'estomac. Tout
a commencé ici. Les survivants de Tchernobyl devraient
savoir ceci : lorsque de tels symptômes apparaissent et
sont attribués à la radiophobie , c'est soit parce
qu'ils sont incompétents dans leur traitement, soit parce
qu'ils ont gardé le silence, dissimulant l'exposition en
signant un accord de confidentialité.
L'endroit où quelqu'un était
malade ne devrait pas rester secret. Après de violents maux de tête, j'ai commencé
à saigner. D'abord, mes gencives ont commencé à
saigner et mon oreiller était couvert de sang. Puis mes
ongles ont commencé à peler et mes cheveux à
tomber. J'ai commencé à ressentir d'étranges
douleurs dans la colonne vertébrale.
J'ai passé un mois et
demi à l'hôpital, mais les médecins n'ont
rien trouvé d'anormal. En 1964, j'ai réussi à
entrer dans une clinique spécialisée dans les maladies
des rayons. Lors de leur visite, un médecin m'a examiné
et m'a dit : « Celui-ci était sous "Snezhok"
». « Snezhok » était le nom de code des
essais nucléaires sur le site de Totsk. Tous les patients
de cet hôpital avaient le même diagnostic : syndrome
asthénique. C'était une façon de dissimuler
la maladie sous-jacente. J'ai commencé
à perdre la vue de l'oeil droit très tôt,
cinq ou six ans après les examens. Cette perte de vision
s'accompagnait de terribles maux de tête.
La clinique Fedorov m'a sauvé. Là, ils m'ont demandé
où j'avais contracté tant de maladies oculaires.
Je leur ai tout raconté.
En 1967, j'ai envoyé une lettre par courrier secret au
bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire demandant
confirmation de ma participation à des exercices militaires
au terrain d'entraînement de Totsky pour établir
mon handicap, mais je n'ai reçu aucune confirmation.
« Nous savions peu de choses
sur cette arme. »
Souvenirs de l'artilleur Ivan Putvilsky,
enregistrés par le lieutenant général d'aviation
Sergueï Zelentsov pour la monographie scientifique et journalistique
« Exercices militaires Totsky » :
Après avoir obtenu mon diplôme de l'école
d'artillerie en 1953, j'ai servi dans un régiment d'artillerie
de la garnison de Brest. En mai 1954, nous avons été
informés qu'en juin, le régiment, en tant que division,
serait déployé hors du district militaire biélorusse
pour participer à des exercices majeurs. Le commandant
du régiment ne savait ni où ni pour combien de temps,
mais il nous a recommandé de régler les problèmes
familiaux de passer un examen médical et de préparer
notre équipement pour le transport par train. Nous avons
reçu de nouveaux uniformes. J'ai été surpris
de voir que nous avions reçu des sous-vêtements chauds
pour l'été. Les esprits malins ont plaisanté
: « On passera probablement l'hiver en Sibérie [...]
»
En juin, le convoi de troupes prit la direction de l'est. Moscou,
Kouïbychev et Bouzoulouk furent abandonnés. Nous débarquâmes
près de la gare de Totskoïe et, sous une chaleur étouffante,
nous nous dirigâmes vers la steppe d'Orenbourg. Des camps
étaient installés sur une colline, le long d'une
petite rivière. De loin, les tentes ressemblaient à
d'énormes nids d'abeilles, s'étendant sur des centaines
de mètres. Une fois installés, nous apprîmes
que nous étions arrivés dans le district militaire
du Sud-Oural pour participer à un exercice spécial
visant à percer les défenses fortifiées ennemies
à l'aide d'armes modernes. On disait que nous avions eu
l'immense honneur d'être les premiers au monde à
opérer dans les conditions réelles d'une bombe nucléaire.
Nous savions peu de choses sur cette arme.
Pendant des jours et des nuits, soldats et officiers creusèrent
à la main des tranchées et des abris, protégeant
les positions de tir et le matériel. Des rondins de bois
furent disposés en plusieurs couches sur les abris, et
les parties en bois saillantes furent soigneusement enduites d'argile
jaune pour les protéger des flammes. Mais le plus éprouvant
fut peut-être les entraînements répétés
sur le terrain où ils allaient opérer plus tard.
Le site d'entraînement choisi se trouvait au sommet d'une
vallée jaunâtre, parsemée de collines et de
ravins, couverte de forêts de feuillus. La vallée
s'étendait vers Totskoïe et plus loin jusqu'à
Sorotchinsk, à 40 km de là. Pour la suite, je relaterai
que lors de l'explosion de la bombe atomique, des fenêtres
furent soufflées dans l'une des écoles de la ville
où se déroulaient les cours ; l'onde de choc fut
si puissante qu'elle se propagea dans toute la vallée.
Heureusement, il n'y eut aucune victime.
Des sous-vêtements chauds
et un masque à gaz étaient considérés
comme les principaux moyens de protection.
Pendant la journée, sous une chaleur
étouffante, nous avons progressé le long du futur
épicentre, où des artificiers ont fait exploser
des barils de fioul, créant un nuage de suie en forme de
champignon, comme pour simuler une explosion atomique. La nuit,
[et] nos uniformes maculés de sueur et de saleté,
nous avons reculé dans l'obscurité de la poussière
noire.
En août, lors d'un de nos exercices d'entraînement,
nous avons croisé le général d'armée
Petrov, commandant des troupes, et le premier vice-ministre de
la Défense, Gueorgui Joukov, responsable de l'ensemble
de l'exercice. Joukov a stoppé l'avancée sur une
colline et a convoqué les commandants de régiment
et de division. Nous aussi, nous avons couru voir le légendaire
maréchal. Entouré de généraux et d'officiers
supérieurs, Gueorgui Konstantinovitch donnait des ordres,
nous ignorant complètement. Je me souviens de son appel
à accélérer la progression et la vitesse
des nouveaux chars T-54 du détachement avancé, et
à ne pas craindre d'être séparés du
gros des forces.
En septembre, à la veille de l'offensive, chacun reçut
des doublures teintées spéciales pour ses masques
à gaz, à travers lesquelles le soleil était
à peine visible. On leur donna également de nouveaux
uniformes et même des sous-vêtements chauds, qu'ils
devaient porter pendant l'entraînement (par 30 degrés).
Les essais étaient prévus pour le 14 septembre.
Les ministres de la Défense des pays socialistes, les hauts
gradés et les commandants des districts militaires y ont
participé. Un poste d'observation spécial, équipé
de miradors, a été construit à leur intention,
en hauteur, derrière nos positions de tir.
La frappe atomique a été menée au coeur des
défenses « ennemies » (à environ 8 kilomètres
de nous), afin de ne pas toucher nos unités avancées.
L'épicentre était marqué d'une grande croix
blanche. Autour et le long de la vallée, du matériel
militaire était déployé : chars, avions,
véhicules blindés de transport de troupes, auxquels
des moutons, des chiens, des chevaux et des veaux étaient
attachés dans des tranchées et au sol. Les scientifiques
les ont ensuite examinés attentivement, nous oubliant malheureusement
complètement.
À 9 heures, nous nous sommes mis à couvert. Vingt
minutes plus tard, le signal « Éclair » a retenti,
suivi d'une sirène et d'un coup de canon. Quitter un abri
sans ordre était strictement interdit. Le rugissement régulier
d'un avion s'est fait entendre. Puis le sol a tremblé dans
une terrible explosion. J'ai eu l'impression qu'un coup de canon
avait tiré juste à côté de mon oreille.
Puis une seconde détonation, violente, a balayé
tout sur son passage. La terre a commencé à s'effondrer
et mes oreilles ont bourdonné.
Après l'ordre de « fin d'alerte », nous nous
sommes précipités hors de l'abri. Le vent s'est
levé et, à l'horizon, un énorme champignon
rouge et plombé a poussé, s'élevant [...]
en ondulant, grandissant et s'élevant toujours plus haut.
Mais nous n'avons pas eu le temps de l'examiner. Le barrage d'artillerie
a commencé.
L'essentiel était de tirer avec précision
et promptitude tous les obus, dont l'utilisation était
strictement interdite lors de l'offensive. Un grondement continu
s'est alors fait entendre. Nous avons rapidement constaté
que les canons avaient jauni et fumaient : la plupart des munitions
avaient été tirées. Nous avons ralenti. Le
déluge de tirs s'est progressivement atténué.
Apparemment, nous n'étions pas les seuls à être
euphoriques. Au commandement « En avant », nous nous
sommes dirigés vers le lieu de l'explosion et avons aperçu
une longue file scintillante de voitures transportant le commandement
et des invités, s'étendant du poste d'observation
principal le long d'une route spécialement aménagée.
Les officiers du régiment ont été conduits
à l'épicentre pour une visite.
À quatre ou cinq kilomètres de l'épicentre
de l'explosion, d'immenses chênes aux cimes épaisses
ont été arrachés, et du bois de chauffage
sec et des bûches brûlaient. Plus près du centre,
l'onde de choc n'a même pas épargné les arbres
rabougris : ils se sont couchés dans sa direction, comme
aplatis par un fer géant.
Ils traversèrent la vallée, à un kilomètre
et demi de l'épicentre de l'explosion, équipés
de masques à gaz. Avions à moteur, automobiles et
véhicules de commandement brûlaient, et des animaux
calcinés gisaient éparpillés. Un épais
mur noir de fumée et de poussière, d'odeurs et de
vapeurs, emplissait l'air. Ma gorge était sèche
et irritée, et mes oreilles bourdonnaient.
Le soir, la mission était terminée. Les chimistes
nous ont examinés à la hâte avec des radiomètres,
mais aucune décontamination n'a été effectuée.
Plus tard, nous n'avons retrouvé aucune trace de l'exposition
aux radiations ni de la gratitude que nous avait témoignée
le ministre de la Défense Boulganine.
« La population a souffert,
c'est sûr. »
Viktor Boev, académicien de l'Académie
russe des sciences naturelles et ancien recteur de l'Académie
de médecine d'État d'Orenbourg. De 1993 à
1996, il a participé aux recherches sur les conséquences
de l'explosion nucléaire de Totsk :
Dans les années 1990, les essais nucléaires de Totsk
ont commencé à faire parler d'eux, et le gouvernement
a accordé des subventions à des scientifiques pour
étudier les conséquences de cette explosion. Notre
équipe médicale a réalisé une partie
de ces travaux, tandis que d'autres ont été réalisés
par des chercheurs de l'Université agraire d'État
d'Orenbourg.
En 1992, des agriculteurs
ont découvert que 71,7 % des cas de leucémie chez
les animaux d'élevage de la région d'Orenbourg survenaient
dans les districts de Krasnogvardeisky, Sorochinsky et Totsky,
limitrophes de la décharge. La même année,
des chercheurs de l'Institut de recherche sur l'élevage
bovin ont analysé le lait et la viande produits à
Totsky. L'étude a révélé la présence
de césium 137 et de strontium 90 radioactifs dans tous
les échantillons.
 Viktor
Boev. Image du documentaire « Irradiation ».
Viktor
Boev. Image du documentaire « Irradiation ».
Sur le plan humain, le district
de Sorochinsky présente le taux d'incidence le plus élevé
de la région d'Orenbourg, y compris le cancer : 598,5 cas
pour 100 000 habitants. Dans le district de Totsky, lors
de nos recherches, le taux d'incidence du cancer était
40 % supérieur à la moyenne de la région
d'Orenbourg. Cependant, selon les données
officielles, il a maintenant diminué pour atteindre 383,8
cas pour 100 000 habitants. De nouvelles recherches sont nécessaires
pour expliquer ce phénomène.
Nous avons pu déterminer
la trace radioactive. Après l'explosion, un vent s'est
levé, emportant les radionucléides vers le nord-est.
Des retombées radioactives auraient pu se produire dans
les districts de Sharlyk et de Sorochinsky, puis quelque part
en Sibérie, près de Krasnoïarsk. Après une étude de l'écosystème,
nous n'avons constaté aucun excès de radionucléides
dans l'eau potable les niveaux se situaient dans les limites
de la normale mais une contamination localisée du
sol a été constatée. Nous avons également trouvé du plutonium
dans le sol, une substance qui ne devrait pas être présente
dans l'environnement en conditions normales. Du césium
et du strontium ont également été détectés,
par endroits, et non en une couche continue. Ces niveaux dépassaient
de deux à trois fois les limites autorisées.
Lorsque nous avons analysé les informations sur les cas
de cancer dans les localités touchées par la traînée
radioactive, dans certains cas, le dépassement des taux
moyens s'est avéré très significatif : deux,
trois, cinq, dix fois.
De plus, le pic des maladies, à en juger par les documents,
s'est produit 10 ans après l'explosion - je pense en raison
de l'effet cumulatif de petites doses de strontium-90 et de césium-137,
dont la demi-vie ne dépasse pas 30 ans.
Lorsque nous avons présenté
ces recherches à Moscou, nous avons été accueillis
par une réaction extrêmement négative. En
coulisses, un haut fonctionnaire m'a dit : « Essayez-vous
de transformer Orenbourg en un second Tchernobyl ? » Nous
ne cherchions rien à faire ; nous nous contentions d'énoncer
les faits. Mais en 1996, le financement de nos recherches a été
interrompu. Nous avons ensuite tenté de solliciter de nouvelles
subventions, mais sans succès. Malgré tout, la population
locale a souffert après l'explosion nucléaire
c'est incontestable, nous l'avons prouvé.
On ignore si les générations suivantes ont souffert.
De nouvelles recherches sont nécessaires, mais la question
est de savoir si elles seront menées aujourd'hui.
Ivan Zhilin
Extrait Baza.io:
Deux filles de Bouzoulouk
Tamara Popova est également présente.
Elle a 18 ans, allongée dans une tranchée, recouverte
d'une couverture de flanelle, grelottant. Non loin de là
se trouve sa meilleure amie, Alexandra Ivaschenko, ou Shura, mais
elle est perdue de vue. Autour d'elle, des hommes en imperméables
épais et masques à gaz, la foule et la poussière
abondent, la chaleur dépasse les trente degrés Celsius.
Shura a quatre ans de plus ; ils se sont rencontrés
à la boulangerie de Bouzoulouk. Tamara est mince, sociable
et joyeuse. Shura est plus grande et plus modeste. Elles sont
allées danser ensemble ; elles ont fait la fête
jusqu'à tard, si bien qu'elles ont dormi chez l'une à
tour de rôle, puis se sont rendues ensemble à l'usine
le matin. Il y a trois semaines, les filles ont été
envoyées sur le site d'essais de Totskoïe, à
40 kilomètres de là. « On nous a juste
dit qu'il y aurait une explosion expérimentale »,
raconte Tamara à Baza. « Que c'était une nouvelle
invention et qu'elle impliquerait des atomes. »
Tamara et Shura portent de « petits analyseurs de gaz ronds
» avec un faisceau de tubes ; leur tâche consiste
à mesurer la composition de l'air. Trois heures plus tard,
le silence règne : la route vers l'épicentre est
libre, le champignon atomique a dérivé vers l'est,
les canons ont tiré, même si la fumée gronde
encore au loin. Les filles marchent lentement dans la poussière,
se rapprochant de plus en plus, passant devant des équipements
détruits, comme à une exposition, des avions aux
ailes fondues et des chars dégoulinant de métal.
Le sol autour d'elles est jonché d'empreintes de pas :
trois mille soldats viennent de passer par ici, mais ils sont
désormais hors de vue. « Des cadavres d'animaux jonchent
le sol », raconte Tamara. « Je me souviens de la viande
de vache, des moutons calcinés, de leur sang qui giclait.
Quand je les ai vus, j'ai immédiatement fondu en larmes,
j'ai eu une crise de nerfs. »
Une femme a surpris Tamara dans la poussière et lui a retiré
son masque à gaz : c'était un médecin
de Totskoïe ; elles se connaissaient déjà
l'épouse du commandant du site d'essais. « Elle
nous surveillait depuis notre arrivée, répétant
sans cesse : "Demande à rentrer, tu n'es qu'une
enfant, je ne comprends même pas comment tu es arrivée
ici. Ne vas nulle part, refuse, tu vas tomber malade et je ne
pourrai pas te guérir." Puis, sur le chemin de l'épicentre,
elle m'a de nouveau attrapée et m'a dit : "Tamara,
s'il te plaît, va t'asseoir dans la voiture, n'avance pas ;
s'ils te demandent, pleure. " Et j'ai fait demi-tour
à mi-chemin du champ et je suis simplement repartie à
pied. Shura a refusé de repartir : elle avait peur
d'être punie, car elle était plus âgée.»
Les filles sont restées à Totskoïe une semaine
de plus, seule Shura retournait sans cesse au site d'essais, tandis
que Tamara restait assise au laboratoire avec les échantillons.
Elles rentrèrent ensemble à Bouzoulouk : « Il
y avait de la musique dans toutes les gares. Ils nous payèrent
même un peu et nous donnèrent des fruits.»
Les filles ne quittèrent pas la boulangerie tout de suite ;
elles réussirent à travailler ensemble encore quelques
mois.
Tamara fut hospitalisée ce même hiver, souffrant
d'ulcères : « J'avais mal aux os, mais
surtout, je ne pouvais pas manger : je vomissais constamment
à cause de douleurs à l'estomac.» Les médecins
ne diagnostiquèrent qu'un ulcère duodénal
(les ulcères intestinaux et gastriques sont fréquents
chez les liquidateurs). Elle passa de plus en plus de temps au
lit, quitta son emploi et vit Shura moins souvent. Dès
qu'elle en eut la force, Tamara lui rendit visite : « Je
me souviens être revenue, et son père était
assis à la maison, en train de boire : "Shura
a été emmenée à l'hôpital de
Samara."» Le même jour, Tamara acheta des billets
et alla rendre visite à son amie. Elle avait radicalement
changé. Tout son corps était enflé, ses bras
et ses jambes énormes, rouges et gonflés. Ses yeux
semblaient sur le point de sortir de leurs orbites, sa bouche
était tordue, elle était complètement défigurée.
Je suis resté assis avec elle dans la salle pendant plusieurs
heures, à m'excuser, disant que je ne savais pas qu'elle
était si malade que je ne pouvais pas rester maintenant,
mais que je reviendrais. Les lèvres de Shura bougeaient
à peine, toutes meurtries, et elle murmurait sans cesse
: « Toi et moi sommes infectés. » Je suis rentré
chez moi à Bouzoulouk, et deux jours plus tard, sa mère
m'a appelé : « Shura est morte. » Alexandra
Ivaschenko a survécu à l'explosion pendant un an
et quatre mois ; elle avait 23 ans. Son diagnostic est inconnu
; Tamara n'a pas été informée, mais les médecins
interrogés par Baza, d'après sa description de ses
symptômes, ont suggéré qu'il s'agissait d'une
« hyperthyroïdie, ou maladie de Basedow, causée
par une exposition aux radiations sur fond de troubles endocriniens
systémiques ». Bien sûr, établir un
diagnostic précis se base sur Ses paroles, 60 ans après,
sont incompréhensibles. Pire encore, ni Tamara ni Shura
ne connaissaient les doses de radiation reçues à
Totskoïe ; après tout, personne sur le site d'essai
ne possédait de dosimètre personnel.
À 20 ans, Tamara s'est mariée. C'était un
vrai mariage de village à Bouzoulouk, avec beaucoup d'alcool,
une cérémonie de fiançailles et des vux.
Tamara pleurait et refusait, mais ses proches l'ont convaincue :
elle passait déjà des semaines à l'hôpital,
son mari serait là pour s'occuper d'elle et, surtout, il
voulait des enfants. Elle a donné naissance à une
fille en 1958. « Elle était toute rouge, petite
et semblait flétrie. La sage-femme est arrivée et
a dit : "Votre bébé ne survivra pas, ça
ne marchera pas, elle ne s'est pas développée."
Les médecins n'ont rien noté, ils ont simplement
dit : "C'est Totskoïe. Il vaut mieux ne pas essayer,
vous ne pouvez pas avoir d'enfants maintenant." J'ai pleuré
et je ne comprenais pas ce qui n'allait pas.» Tamara est
restée allongée avec le bébé pendant
huit heures supplémentaires, jusqu'à ce que la fillette
meure.
Après sa sortie de l'hôpital, elle trouva un emploi
et tenta de reprendre une vie normale, mais son mari réessaya
encore et encore. Ils conçurent un autre enfant la même
année. Un garçon. « C'était une douleur
atroce », raconte Tamara, les mains crispées comme
si elle tordait du coton. « Il était vraiment laid,
un simple morceau de chair. Il est mort. J'ai décidé
de ne plus avoir d'enfant. » Mais son mari persistait, encore
et encore : « Ivan était un homme si agité,
si agité. J'ai cédé.» En 1959, Tamara
Popova donna enfin naissance à une fille en bonne santé ;
ils la prénommèrent Tatiana. Deux ans plus tard,
elle eut une soeur. Son mari travaillait alors comme assistant
machiniste à Bouzoulouk, mais dans les années 1960,
il commença à boire beaucoup. À chaque licenciement,
Ivan déménageait dans une autre ville, y trouvait
un nouvel emploi, mais il recommençait à boire.
Il parvenait même à appeler sa femme pour qu'elle
le rejoigne. Aujourd'hui, Tamara ne veut plus parler de co-dépendance,
elle considère simplement cela comme un « amour amer
». Elle lui a rendu visite avec ses enfants à Krasnoïarsk,
Prague et Rostov-sur-le-Don. « J'ai eu du mal à le
quitter définitivement, car il s'est occupé de moi
après l'explosion, alors que j'étais constamment
malade. Il ne me frappait jamais, c'était juste une beuverie
constante, et nous avons déjà deux jeunes enfants.
» À Rostov, Tamara a finalement pris sa décision
et est retournée à Bouzoulouk sans son mari.
 Tamara Popova dans son laboratoire dans les années
1990.
Tamara Popova dans son laboratoire dans les années
1990.
Tamara fut embauchée dans une filiale
de Gazprom et posséda même son propre laboratoire,
à Volchya Gora, à Aleksandrovka. Elle rencontra
un autre homme bien, qui jouait de l'accordéon pour elle
le soir et plaisantait beaucoup, jusqu'au jour où il fut
renversé par une voiture à un arrêt de bus.
Après la mort de Shura Ivashchenko, sa famille vendit sa
maison ; ils quittèrent Bouzoulouk et ne furent plus
jamais revus. Tel fut le sort des deux jeunes filles qui se retrouvèrent
à huit kilomètres de l'épicentre. Qu'advint-il
de celles qui étaient beaucoup plus proches ?
Takie Dela, 14
septembre 2017:
À l'occasion du 63e anniversaire
de l'explosion sur le site d'essai de Totsky,
Takie Dela s'est entretenu avec un témoin oculaire des
essais d'armes nucléaires soviétiques.
Le 14 septembre 1954, une bombe atomique presque
deux fois plus puissante que celles larguées sur Hiroshima
et Nagasaki explosa sur le site d'essais de Totsky, près
d'Orenbourg. [...] des milliers de soldats participant à
un exercice visant à percer un front ennemi simulé.
Leur nombre reste inconnu, certaines sources évoquant 45 000
et d'autres 60 000.
Personne n'a même compté les victimes
civiles. Les essais ont blessé des habitants de près
de cinq cents communes de la région d'Orenbourg, dont beaucoup
ignoraient l'imminence de l'explosion et n'avaient donc pas pris
de précautions ni fourni d'équipement de protection.
Miraculeusement survécu
Valery Frolovitch Astafiev est assis dans les
bureaux de Greenpeace à Moscou. Sa fierté et sa
réussite de ces derniers mois sont un petit livre, un recueil
de poèmes, dont il rêvait depuis longtemps. Valery
Frolovitch a soixante-dix-huit ans un exploit remarquable
: rares sont les habitants du village de Totskoïe, dans la
région d'Orenbourg, qui ont atteint un âge aussi
vénérable. Astafiev a passé presque toute
sa vie à l'hôpital son dossier médical
est rempli des diagnostics les plus terrifiants. Astafiev avait
quinze ans au moment de l'explosion, et son ami Evgueni Panferov
seize.
« Il était à l'école ce jour-là ;
l'explosion s'est produite pendant un cours de russe »,
raconte Valery Frolovich. « Les garçons n'avaient
aucune idée de la cause de l'explosion ni de ce qu'il fallait
faire, alors ils se sont entassés dans la rue pour observer
le champignon. Personne ne leur a dit de se cacher, ni au moins
de ramper jusqu'à la cave. » Panferov est littéralement
le dernier témoin oculaire survivant de l'explosion dans
son village. Toute la famille et les amis d'Evgueni sont morts
d'un cancer : ses parents, sa femme, qui a à peine
atteint la soixantaine. Les problèmes de Panferov ont commencé
alors qu'il était encore dans l'armée : il
souffrait de problèmes cardiaques, mais ils n'ont jamais
été diagnostiqués. Il a subi des années
de traitement, d'abord dans un hôpital militaire, puis dans
des hôpitaux municipaux, une opération cardiaque
complexe, une tonne de médicaments et un stimulateur cardiaque.
Panferov nécessite des soins constants et est interdit
d'activité physique, mais il vit et gère seul son
foyer depuis plus de quinze ans.
Astafyev lui-même apprit que « quelque chose allait
se passer » quelques mois avant l'explosion, lorsqu'il croisa
des soldats pendant les vacances d'été. «
C'était la remise des diplômes. On nous a remis nos
diplômes, et avec les gars, on s'est précipités
dans les bois. On est entrés et on a vu des soldats se
promener. C'était en mai. On ne savait pas encore ce qui
se passait. On a commencé à enquêter :
il s'est avéré qu'ils avaient construit une voie
ferrée non loin de notre village, menant au terrain d'entraînement.
»
 Valery
Frolovich Astafyev, témoin de l'explosion nucléaire
de Totsk. (Photo : Stoyan Vasev pour
TD)
Valery
Frolovich Astafyev, témoin de l'explosion nucléaire
de Totsk. (Photo : Stoyan Vasev pour
TD)
Selon Astafiev, les troupes étaient
divisées en deux camps : occidental et oriental. Les
unités du district militaire biélorusse étaient
stationnées dans le camp occidental, tandis que celles
du district militaire de l'Oural étaient stationnées
dans le camp oriental. Selon le scénario de l'exercice,
le camp occidental devait se défendre contre une attaque
nucléaire, tandis que le camp oriental devait attaquer
avec des armes nucléaires.
« En août, les militaires ont commencé à
visiter les maisons des villages les plus proches du site d'essai,
expliquant leur projet », se souvient Valery Frolovich.
« On nous a dit que la bombe était inoffensive, que
seule l'onde de choc pouvait endommager les maisons. Le matin
de l'explosion, on nous a donc ordonné d'aller dans les
potagers, éloignés des maisons, et de nous allonger
dans les plates-bandes. Le plan initial était de faire
exploser la bombe le 1er septembre, mais la météo
n'a pas été clémente. »
« Le 14 septembre, nous avons été réveillés
vers cinq heures du matin », poursuit Valery Frolovich,
« et une alerte de quatre heures a été déclenchée.
On nous a ordonné d'ouvrir toutes les fenêtres et
portes pour éviter qu'elles ne soient soufflées
par l'onde de choc, de rassembler toute la nourriture dans la
cave et de la recouvrir de terre. Une demi-heure avant l'explosion,
on nous a ordonné de quitter nos maisons et de nous allonger
dans les jardins, les pieds face au site d'essai. Puis les soldats
ont compté à rebours : 15 minutes avant la
détonation, 10 minutes avant la détonation, cinq...
Un éclair rouge vif a brillé, suivi d'un craquement
métallique. Le sol a tremblé. Nous sommes restés
étendus là encore 10 minutes, puis les soldats nous
ont ordonné de nous lever et de rentrer. Je me suis relevé
et j'ai vu un champignon atomique. »
Après l'explosion, les habitants des « villages
tests », comme les appelle Astafyev, furent complètement
oubliés. Dans la plupart des cas, aucune évacuation
n'eut lieu ; l'explosion survint de manière inattendue
et, bien sûr, alarma les villageois, mais presque aussitôt,
tout rentra dans l'ordre. Les soldats terminèrent leur
entraînement et partirent, laissant derrière eux
des habitants désemparés, du matériel fondu
et des carcasses d'animaux calcinées. Les arbres abattus
furent rapidement déblayés et utilisés comme
bois de chauffage. Astafyev raconte alors avec un calme étrange :
« On jette un morceau de bois dans le poêle,
et il brûle avec une flamme bleue. Imaginez comme les garçons
et moi avons adoré ça ? »
Sujets de test
Les arbres contaminés n'étaient
pas les seuls à être utilisés pour l'agriculture.
Les habitants puisaient tranquillement l'eau des sources contaminées
et se rendaient à leurs puits habituels, même en
cas d'explosion nucléaire à quelques kilomètres.
Sur des terres arables présentant des niveaux élevés
de césium 137, de strontium 90 et de plutonium 240, ils
cultivaient des céréales, faisaient paître
le bétail et faisaient du foin. Le site d'essais de Totsky
lui-même fut bientôt rouvert : il devint le terrain
de jeu préféré des garçons, et les
adultes s'y rendaient pour récupérer les pièces
détachées des équipements détruits
et ramener tous ces débris chez eux. Et après quelque
temps, les familles des villages dont les habitants avaient été
évacués retournèrent chez elles et s'installèrent
directement dans les maisons calcinées.
[...] Dans les premières
années qui ont suivi l'explosion, le taux de mortalité
dans la région d'Orenbourg a fortement augmenté.
Des enfants et des personnes dans la force de l'âge, dont
certaines souffraient de maladies rares, sont décédés
subitement. La soeur d'Astafiev, Svetlana Frolovna, était
médecin stagiaire à Totskoïe à cette
époque. Elle racontait presque quotidiennement à
son frère des cas de patients impossibles à diagnostiquer,
réfractaires à tout autre traitement que des analgésiques
puissants, qui mouraient pourtant les uns après les autres
dans d'atroces souffrances.
« Au début, on ne comprenait rien », se souvient
Astafyev, « mais des rumeurs circulaient dans le village,
les gens étaient terrifiés, ils partaient parce
que tous leurs voisins mouraient ! Il y avait une belle voisine,
Nastia, vingt-cinq ans. Et soudain, Nastia est partie. Quelqu'un
est mort en sixième. En seconde. Ma camarade de classe,
Albina Lambina, est morte ; nous l'avons enterrée près
de l'école. Un garçon venait d'entrer à l'université
et, un mois plus tard, il est mort d'une leucémie. Mais
tout le monde n'est pas mort en même temps. Prenez Tolia
Kazachuk : il a vécu jusqu'à trente-sept ans !
Il est mort d'un cancer. »
Nier l'évidence
Selon Valery Frolovitch, les médecins
locaux étaient très réticents à croire
qu'une bombe nucléaire avait été testée
sur des civils. Les problèmes de santé d'Astafiev
ont commencé deux mois après l'explosion :
« J'ai eu de terribles maux de tête, je ne pouvais
ni lire ni dormir. Je suis alors allé voir un médecin
à Orenbourg et je lui ai tout raconté : l'explosion,
les autres patients et ma propre maladie mentale. Le médecin
ne m'a pas cru, m'a conseillé de ne rien inventer et m'a
prescrit de l'analgine. »
Les maux de tête
n'étaient pas son seul problème. À trente-huit
ans, Astafyev souffrit d'une grave crise d'hypertension, à
la suite de laquelle il perdit subitement 15 kilos. On lui diagnostiqua
rapidement une hyperthyroïdie, un trouble de la thyroïde.
Deux ans plus tard, Valery Frolovich fut admis dans un nouvel
hôpital et reçut un nouveau diagnostic : « goitre
toxique diffus avec protrusion de l'oeil droit », autrement
appelé maladie de Basedow. Pendant les huit années
qui suivirent, Astafyev fut hospitalisé chaque année.
Au début des années 1990, autre service d'urgences,
autre hôpital, et nouveau diagnostic. Cette fois, une maladie
cardiaque. À la fin des années 1990, une tumeur
maligne de la peau de l'oeil. La liste des affections ne fit que
s'allonger d'année en année. À un moment
donné, Astafyev devint complètement aveugle.
 Totskoïe-2,
site d'essais de Totskoïe. La croix en pneus est un repère
pour les pilotes de bombardiers. (Photo : Youri Pirogov)
Totskoïe-2,
site d'essais de Totskoïe. La croix en pneus est un repère
pour les pilotes de bombardiers. (Photo : Youri Pirogov)
La soeur d'Astafyev, Svetlana,
a également commencé à souffrir de problèmes
de santé, notamment de maux de tête, d'une thyroïde
affaiblie et d'un système immunitaire affaibli. S'en est
suivie une longue liste de maladies diverses. Selon Astafyev,
la thyroïde a été un problème dans toute
sa famille : sa mère a développé une
tumeur un goitre rétrosternal peu après
l'explosion, et elle a subi une intervention chirurgicale pour
l'enlever. La fille de Svetlana Astafyeva a également reçu
un diagnostic d'hypothyroïdie il y a quatre ans.
Année après année, les médecins ont
nié tout lien entre l'essai nucléaire et les maladies
(et les décès) des habitants des villages environnants.
Les autorités locales et fédérales ont longtemps
et assidûment prétendu que l'explosion n'avait jamais
eu lieu, et encore moins qu'elle n'avait eu aucune conséquence.
Aucune mesure de réhabilitation n'a été mise
en oeuvre et les habitants n'ont reçu aucune explication
sur ce qui s'était passé. Les limites des zones
touchées restent inconnues à ce jour. Selon les
rapports du Rospotrebnadzor de la région d'Orenbourg, les
informations sur la contamination radioactive dans les zones,
sur les personnes touchées par l'explosion nucléaire
et sur ses limites sont inexistantes.
Classifié
Les conséquences des exercices ne furent
évoquées que pendant la Perestroïka, après
les événements de Tchernobyl. En 1991, le président
Eltsine signa un décret sur les mesures de protection de
la population de toutes les zones touchées d'une manière
ou d'une autre par les conséquences des essais nucléaires.
Au milieu des années 1990, des scientifiques d'Orenbourg,
de Novossibirsk, de Saint-Pétersbourg, de Moscou et d'Ekaterinbourg,
grâce à un effort conjoint, parvinrent enfin à
prouver l'impact négatif de l'explosion nucléaire
sur la santé publique. Ils purent même identifier
une liste de zones nécessitant une réhabilitation
urgente et une aide de l'État. Il convient de noter que
personne ne voulut ménager les scientifiques : l'armée
évita (et évita toujours) de répondre directement
aux questions sur la nature de l'explosion (aéroportée,
terrestre ou aérosol) et même sur son ampleur. Le
ministère de la Défense continua (et continue) de
maintenir les rapports sur l'explosion de Totsk classés
« top secret ». De plus, le délai
de quarante ans entre l'explosion et les recherches ne facilita
pas l'exactitude des résultats.
 Panneau
commémoratif sur le site de l'explosion. (Photo : Youri
Pirogov)
Panneau
commémoratif sur le site de l'explosion. (Photo : Youri
Pirogov)
Les scientifiques ont fondé leurs conclusions
sur plusieurs paramètres. Par exemple, les rapports de
V. M. Boev, docteur en sciences médicales et recteur de
l'Académie de médecine d'Orenbourg, indiquaient
que les scientifiques avaient découvert une quantité
totalement inattendue de plutonium dans le sol des steppes d'Orenbourg.
Ils ont également étudié les dépôts
de limon dans les plans d'eau, qui, même après quarante
ans, présentaient des niveaux de contamination par des
radionucléides sept à dix fois supérieurs
à la normale.
En 1997, le Premier ministre Tchernomyrdine offrit à Orenbourg
et à sa région un cadeau inattendu le soir du Nouvel
An : il signa la résolution du gouvernement de la
Fédération de Russie « Sur le développement
socio-économique de la région d'Orenbourg ».
Cette résolution, outre le programme économique,
incluait une clause sur la « réadaptation médicale
et sociale de la population de la région d'Orenbourg après
l'explosion nucléaire de Totsk ». Selon ce document,
la région devait recevoir des fonds pour ouvrir des centres
de cancérologie dans plusieurs districts. Mais cette joie
fut de courte durée : en 1998, le défaut de
paiement se produisit et le gouvernement réduisit les dépenses,
notamment [pour] la région d'Orenbourg.
Pendant tout ce temps, Astafiev a tenté de rétablir
la justice par ses propres moyens et a fait preuve d'une incroyable
ténacité ces dernières années. Au
tout début de sa lutte pour obtenir le statut de victime,
Astafiev s'est heurté non seulement à une réticence
à répondre aux questions, mais aussi à un
problème totalement inattendu : il devait prouver
qu'il était bien originaire de Totskoïe. Il s'est
avéré que lors du recensement du village, Astafiev
était enregistré sous le nom de Valéry Fedorovitch,
et non Valéry Frolovitch. Il a néanmoins défendu
son patronyme.
Les choses se sont compliquées à partir de là.
Valéry Frolovitch, cherchant à obtenir réparation
pour ses dommages de santé, a rendu l'affaire publique
et a lancé un appel à l'aide à tous. Par
exemple, il y a environ six mois, il a tenté de contacter
la Commissaire aux droits de l'homme, Tatiana Moskalkova, mais
en vain. « Je me demande comment ça marche ? Elle
est allée voir ce type, Dadin, à la colonie pénitentiaire,
mais elle refuse de venir chez nous à Totskoïe. Comment
ça se fait ? » s'est lamenté Astafyev.
Il a également tenté de contacter la politicienne
Valentina Matvienko, le journaliste Sergueï Brilev, le patriarche
Kirill et le chef du parti Russie Juste, Sergueï Mironov.
Dans chaque centre de presse, Astafiev a reçu des demandes
polies de patienter pendant qu'ils réglaient la situation.
Presque partout, ils ont acquiescé tristement, exprimé
leur sympathie, et n'ont pas répondu.
 Valery
Frolovich Astafyev (Photo : Stoyan Vasev).
Valery
Frolovich Astafyev (Photo : Stoyan Vasev).
« Mais je ne peux pas abandonner ; c'est
peut-être le plus important pour moi maintenant. Je sais
très bien que ma vie est divisée entre l'avant et
l'après-explosion. Avant, nous étions des êtres
humains ; après, nous étions des cobayes »,
explique Valery Frolovich. En énumérant ceux à
qui il a demandé de l'aide, sans succès, il ressent
une tristesse accrue. Mais vous savez, je ne perds pas courage
! Je viens de publier un recueil de poèmes, sur Totskoïe
[...]
Elizaveta Nesterova
Russia House News,
22 September 2015:
Hiroshima soviétique
Victimes du site d'essais de Totski
[...] La région d'Orenbourg commémore
les événements du 14 septembre 1954, lorsque
des essais nucléaires ont été effectués
sur le site d'essais nucléaires de Totsk sous le commandement
du maréchal Joukov dans le cadre d'exercices militaires.
 [...] Ce qui s'est
passé le 14 septembre 1954 dans la région
d'Orenbourg est resté secret pendant de nombreuses années.
À 9 h 33, l'explosion de l'une des bombes
nucléaires les plus puissantes de son époque a retenti
au-dessus de la steppe. Les troupes « orientales »
se sont alors lancées à l'attaque, passant devant
des forêts incendiées par le feu atomique et des
villages rasés. Des avions, frappant des cibles au sol,
ont traversé le nuage en forme de champignon. À
dix kilomètres de l'épicentre de l'explosion, dans
la poussière radioactive et le sable en fusion, les «
Occidentaux » tinrent bon. Plus d'obus et de bombes furent
tirés ce jour-là que lors de l'assaut sur Berlin.
[...] Ce qui s'est
passé le 14 septembre 1954 dans la région
d'Orenbourg est resté secret pendant de nombreuses années.
À 9 h 33, l'explosion de l'une des bombes
nucléaires les plus puissantes de son époque a retenti
au-dessus de la steppe. Les troupes « orientales »
se sont alors lancées à l'attaque, passant devant
des forêts incendiées par le feu atomique et des
villages rasés. Des avions, frappant des cibles au sol,
ont traversé le nuage en forme de champignon. À
dix kilomètres de l'épicentre de l'explosion, dans
la poussière radioactive et le sable en fusion, les «
Occidentaux » tinrent bon. Plus d'obus et de bombes furent
tirés ce jour-là que lors de l'assaut sur Berlin.
Tous les participants aux exercices furent
tenus de signer un accord de confidentialité de 25 ans
concernant les secrets d'État et militaires. Décédés
prématurément de crises cardiaques, d'accidents
vasculaires cérébraux et de cancers, ils ne purent
même pas parler à leurs médecins de leur exposition
aux radiations. Peu de participants aux exercices de Totskoïe
survécurent jusqu'à ce jour. Un demi-siècle
plus tard, ils racontèrent au Moskovsky Komsomolets les
événements de 1954 dans la steppe d'Orenbourg.
Préparation de l'opération
« Snezhok »
« Tout au long de la fin de l'été,
des trains de troupes venus de toute l'Union soviétique
arrivaient à la petite gare de Totskoïe. Personne,
pas même les commandants d'unités militaires, ne
savait pourquoi ils étaient là. À chaque
gare, des femmes et des enfants accueillaient notre train. Tout
en nous offrant de la crème fraîche et des oeufs,
les femmes se lamentaient : "Mes chers, vous irez probablement
combattre en Chine" », raconte Vladimir Bentsianov,
président du Comité des vétérans des
unités à risques spéciaux.
Au début des années 1950, ils
se préparaient sérieusement à la Troisième
Guerre mondiale. Suite aux essais menés aux États-Unis,
l'URSS décida également de tester une bombe nucléaire
en plein air. Le lieu des
exercices la steppe d'Orenbourg fut choisi pour sa
ressemblance avec le paysage d'Europe occidentale.
« Initialement, des exercices interarmes
avec une véritable explosion nucléaire étaient
prévus sur le polygone de tir de Kapoustine Yar, mais au
printemps 1954, le polygone de Totskoïe fut évalué
et reconnu comme offrant les meilleures conditions de sécurité »,
se souvenait alors le lieutenant-général Osin.
Les participants aux exercices de Totskoïe
racontent une histoire différente. Le terrain où
la bombe nucléaire devait être larguée était
clairement visible.
« Les hommes les plus forts de nos escouades
ont été sélectionnés pour les exercices.
Nous avons reçu des armes de service individuelles :
des fusils d'assaut Kalachnikov modernisés, des fusils
automatiques à dix coups à cadence de tir rapide
et des radios R-9 », se souvient Nikolaï Pil'shchikov.
Le camp de tentes s'étendait sur 42 kilomètres.
Des représentants de 212 unités, soit 45 000 militaires,
sont arrivés pour les exercices : 39 000 soldats,
sergents et sous-officiers, 6 000 officiers, généraux
et maréchaux.
Les préparatifs des exercices, baptisés
« Snezhok », ont duré trois mois.
À la fin de l'été, le vaste champ de bataille
était littéralement sillonné de dizaines
de milliers de kilomètres de tranchées, de fossés
et de fossés antichars. Des centaines de casemates, de
bunkers et d'abris ont été construits.
La veille des exercices, les officiers ont
pu visionner un film secret sur les effets des armes nucléaires.
Un studio de cinéma spécial a été
construit à cet effet, l'entrée étant réservée
aux personnes munies d'une liste et d'une pièce d'identité,
en présence du commandant du régiment et d'un représentant
du KGB. On nous a alors dit : "Vous avez l'immense honneur
d'être les premiers au monde à opérer dans
les conditions réelles d'une bombe nucléaire."
On a compris pourquoi nous avions recouvert les tranchées
et les abris de plusieurs couches de rondins, en enduisant soigneusement
les parties en bois saillantes d'argile jaune. "Cela devait
les empêcher de s'enflammer sous l'effet des radiations",
se souvient Ivan Putivlsky.
"Les habitants des villages de Bogdanovka
et Fedorovka, situés à 5-6 km de l'épicentre
de l'explosion, ont été priés d'évacuer
temporairement à 50 km du site de l'exercice. Les troupes
les ont évacués de manière organisée
et ont été autorisées à emporter tout
leur matériel. Les habitants évacués ont
reçu une indemnité journalière pendant toute
la durée de l'exercice", raconte Nikolaï Pilschikov.
Les préparatifs de l'exercice se sont
déroulés sous un barrage d'artillerie. Des centaines
d'avions bombardèrent les zones désignées.
Un mois avant le début de l'exercice, un Tu-4 larguait
quotidiennement une « bombe factice » de
250 kg sur l'épicentre, se souvenait Putivlsky, participant
à l'exercice.
Selon le lieutenant-colonel Danilenko, une
croix de calcaire blanc mesurant 100 mètres sur 100 mètres
était peinte dans une vieille chênaie entourée
d'une forêt mixte. Les pilotes d'entraînement visaient
cette croix. L'écart par rapport à la cible ne devait
pas dépasser 500 mètres. Des troupes étaient
déployées autour.
Deux équipages s'entraînaient :
le major Kutyrchev et le capitaine Lyasnikov. Jusqu'au dernier
moment, les pilotes ignoraient qui serait le chef et qui serait
le remplaçant. L'équipage de Kutyrchev, qui avait
déjà l'expérience des essais en vol d'une
bombe atomique sur le site d'essais de Semipalatinsk, avait l'avantage.
Pour se protéger des dommages causés
par l'onde de choc, les troupes situées de 5 à 7,5
km de l'épicentre ont reçu l'ordre de se mettre
à l'abri, puis à 7,5 km, dans des tranchées,
assises ou allongées.
« Sur l'une des collines,
à 15 km de l'épicentre prévu de l'explosion,
une tribune gouvernementale a été construite pour
observer les exercices », explique
Ivan Poutivlski. « La veille, elle a été peinte
en vert et blanc à la peinture à l'huile. Des dispositifs
d'observation y ont été installés. Une route
goudronnée a été construite sur le sable
épais adjacent, depuis la gare. La police militaire de
la circulation n'a autorisé aucun véhicule non autorisé
à y accéder. »
« Trois jours avant le
début des exercices, de hauts responsables militaires ont
commencé à arriver à l'aérodrome près
de Totsk : les maréchaux de l'Union soviétique
Vassilievski, Rokossovski, Koniev et Malinovski », se souvient
Pil'shchikov. Même les ministres de la Défense des
démocraties populaires, les généraux Marian
Spychalski, Ludwig Svoboda, le maréchal Zhu De et Peng
De Huai, étaient présents. Ils étaient tous
logés dans un complexe gouvernemental construit à
l'avance près du camp. Khrouchtchev, Boulganine et le créateur
des armes nucléaires, Kourtchatov, étaient présents
à Totsk la veille des exercices.
Le maréchal Joukov fut nommé
commandant de l'exercice. Des véhicules de combat
chars, avions et véhicules blindés de transport
de troupes étaient positionnés autour de l'épicentre
de l'explosion, marqué d'une croix blanche. Des « troupes »
de moutons, de chiens, de chevaux et de veaux y étaient
attachés dans des tranchées et au sol.
À 8 000 mètres d'altitude,
un bombardier Tu-4 largua une bombe nucléaire sur le site
d'essai.
Le jour de l'exercice, les deux équipages
du Tu-4 étaient parfaitement préparés :
des bombes nucléaires furent fixées sur chaque appareil,
les pilotes démarrèrent simultanément leurs
moteurs et se présentèrent prêts à
accomplir la mission. L'équipage de Kutyrchev, composé
du capitaine Kokorin comme bombardier, de Romensky comme copilote
et de Babets comme navigateur, reçut l'ordre de décoller.
Le Tu-4 était escorté par deux chasseurs MiG-17* et un bombardier Il-28, chargés
d'effectuer des reconnaissances météorologiques,
de filmer et d'assurer la sécurité du l'avion porteur
en vol.
« Le 14 septembre, nous avons été
relevés à quatre heures du matin. C'était
une matinée claire et calme », raconte Ivan Putivlsky.
« Il n'y avait pas un nuage dans le ciel. On nous a conduits
en voiture au pied de la tribune du gouvernement. Nous nous sommes
installés dans un ravin et avons pris des photos. Le premier
signal est arrivé dans les haut-parleurs de la tribune
15 minutes avant l'explosion nucléaire : "La
glace a bougé !" Dix minutes avant l'explosion,
nous avons entendu le deuxième signal : "La glace
bouge !" Comme on nous l'avait demandé, nous
sommes sortis en courant des voitures et nous sommes précipités
vers les abris aménagés dans le ravin, à
côté de la tribune. Nous étions allongés
sur le ventre, la tête face à l'explosion, comme
on nous l'avait appris, les yeux fermés, les mains sous
la tête et la bouche ouverte. Le troisième signal,
enfin, a retenti : "Éclair !" Un grondement
infernal a résonné au loin. L'horloge s'est arrêtée
à 9 h 33. » L'avion porteur largua la bombe
atomique d'une altitude de 8 000 mètres lors de son
deuxième passage sur la cible. La puissance de la bombe
au plutonium, nom de code « Tatyanka »,
équivalait à 40 kilotonnes de TNT, soit plusieurs
fois supérieure à celle de la bombe lancée
au-dessus d'Hiroshima. D'après les souvenirs du lieutenant-général
Osin, une bombe similaire avait déjà été
testée sur le site d'essais de Semipalatinsk en 1951. La
« Tatyanka » de Totsk explosa à 350
mètres d'altitude. La déviation par rapport à
l'épicentre prévu était de 280 mètres
vers le nord-ouest.
Au dernier moment, le vent
tourna : il emporta le nuage radioactif non pas vers la steppe
déserte, comme prévu, mais directement vers Orenbourg,
puis vers Krasnoïarsk.
Cinq minutes après l'explosion nucléaire,
les préparatifs d'artillerie commencèrent, suivis
par le bombardement. Canons et mortiers de divers calibres, lance-roquettes
Katioucha, unités d'artillerie automotrice et chars retranchés
se mirent à rugir. Le commandant du bataillon nous raconta
plus tard que la densité de tir au kilomètre était
supérieure à celle de la prise de Berlin, se souvient
Kazanov.
« Pendant l'explosion, malgré
les tranchées et les abris fermés où nous
nous trouvions, une vive lumière nous a traversés.
Quelques secondes plus tard, nous avons entendu un bruit semblable
à celui d'un éclair violent », raconte
Nikolaï Pil'shchikov. « Trois heures plus tard,
le signal d'attaque fut reçu. Des avions, frappant des
cibles au sol 21 à 22 minutes après l'explosion
nucléaire, traversèrent le champignon atomique,
le tronc du nuage radioactif. Mon bataillon et moi, à bord
d'un véhicule blindé de transport de troupes, avons
parcouru 600 mètres de l'épicentre de l'explosion
à une vitesse de 16 à 18 km/h. J'ai vu une forêt
brûlée de fond en comble, des colonnes de véhicules
déchiquetés et des animaux calcinés.»
À l'épicentre même dans un rayon de
300 mètres il ne restait plus un seul chêne
centenaire ; tout avait brûlé Le matériel
à un kilomètre de l'explosion était écrasé
« Nous avons traversé la
vallée, à un kilomètre et demi de l'épicentre,
masques à gaz à la main », se souvient
Kazanov. « Du coin de l'oeil, nous avons aperçu
des avions à moteur à pistons, des automobiles et
des véhicules de commandement en feu, avec des restes de
vaches et de moutons éparpillés un peu partout.
Le sol ressemblait à des scories, d'une consistance monstrueusement
remuée. La zone après l'explosion était méconnaissable :
l'herbe [...], des cailles calcinées s'agitaient, les buissons
et les bosquets avaient disparu. J'étais entouré
de collines nues et fumantes. Un épais mur noir de fumée
et de poussière, d'odeurs nauséabondes et de vapeurs.
Ma gorge était sèche et irritée, mes oreilles
bourdonnaient Le général de division m'a ordonné
d'utiliser un dosimètre pour mesurer le niveau de radiation
près d'un feu mourant non loin. J'ai couru, j'ai ouvert
le volet sous l'instrument, et l'aiguille a déraillé.
« Montez en voiture ! » a ordonné le général,
et nous avons quitté le lieu, qui se trouvait juste à
côté de l'épicentre de l'explosion
Deux jours plus tard, le 17 septembre 1954,
le journal Pravda publiait un rapport de l'agence TASS :
« Conformément au plan de recherche scientifique
et de travaux expérimentaux, un essai d'un type d'arme
atomique a été mené en Union soviétique
ces derniers jours. L'objectif était d'étudier les
effets d'une explosion atomique. Cet essai a donné des
résultats précieux qui aideront les scientifiques
et les ingénieurs soviétiques à résoudre
avec succès les problèmes de défense contre
une attaque atomique. » Les troupes avaient accompli
leur mission : le bouclier nucléaire du pays était
créé.
Les habitants des villages
environnants, dont les deux tiers avaient été incendiés,
transportaient, bûche par bûche, les nouvelles maisons
construites pour eux jusqu'aux anciens sites habités et
déjà contaminés, et ramassaient des céréales
radioactives et des pommes de terre cuites dans les champs. Les
anciens de Bogdanovka, Fedorovka et du village de Sorotchinskoïe
se souvenaient longtemps de l'étrange lueur du bois de
chauffage. Les tas de bois, provenant des arbres calcinés
dans la zone de l'explosion, brillaient d'une lueur verdâtre
dans l'obscurité.
Souris, rats, lapins, moutons, vaches, chevaux
et même les insectes présents dans la « zone
» étaient soumis à une inspection minutieuse
« Après les exercices, nous n'avons subi qu'une surveillance
dosimétrique », se souvient Nikolaï Pil'shchikov.
Les spécialistes accordaient beaucoup plus d'attention
aux rations sèches qui nous étaient distribuées
le jour des exercices, enveloppées dans une couche de caoutchouc
de près de deux centimètres d'épaisseur Ils
les emportaient immédiatement pour analyse. Le lendemain,
tous les soldats et officiers recevaient des rations normales.
Les friandises avaient disparu.
De retour du terrain d'entraînement de
Totsky, selon Stanislav Ivanovitch Kazanov, ils n'étaient
pas dans le train de marchandises par lequel ils étaient
arrivés, mais dans un wagon de voyageurs normal. De plus,
le train les laissa passer sans le moindre retard. Les stations
défilaient à toute vitesse : un quai vide,
sur lequel se tenait un chef de gare solitaire, saluant. La raison
était simple : Semion Mikhaïlovitch Boudionny
revenait des exercices par le même train, dans un wagon
spécial. « Un accueil chaleureux attendait le
maréchal à la gare de Kazansky à Moscou »,
se souvient Kazanov. « Nos élèves-officiers
n'ont reçu ni insignes, ni certificats, ni décorations
Nous n'avons plus jamais reçu la gratitude que le ministre
de la Défense Boulganine nous avait témoignée.»
Les pilotes ayant largué la bombe nucléaire
reçurent chacun une voiture Pobeda pour avoir mené
à bien leur mission. Lors du débriefing, Boulganine
remit au commandant d'équipage, Vassili Koutyrchev, l'Ordre
de Lénine et, plus tôt que prévu, le grade
de colonel.
Les résultats des exercices interarmes
impliquant des armes nucléaires furent classés « top
secret ».
La troisième génération
de survivants du site d'essais de Totsk souffre d'une prédisposition
au cancer.
Pour des raisons de confidentialité,
aucun contrôle ni examen des participants à cette
expérience inhumaine ne fut effectué. Tout fut dissimulé
et étouffé. Le nombre de victimes civiles demeure
inconnu. Les archives de l'hôpital du district de Totsk
de 1954 à 1980 furent détruites.
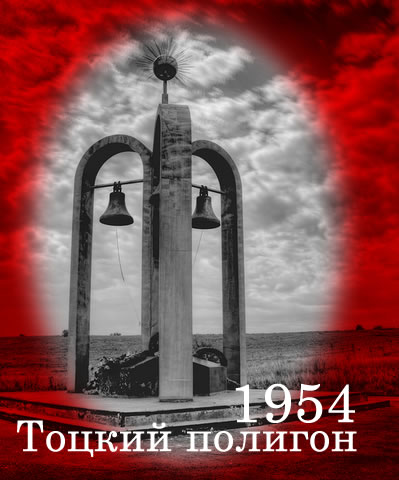 Au bureau d'état
civil de Sorochinsky, nous avons compilé un échantillon
de diagnostics de personnes décédées au cours
des 50 dernières années. Depuis 1952, 3 209
personnes sont décédées d'un cancer dans
les villages voisins. Immédiatement après l'explosion,
il n'y a eu que deux décès. Ensuite, il y a eu deux
pics : le premier 5 à 7 ans après l'explosion,
le second au début des années 1990.
Au bureau d'état
civil de Sorochinsky, nous avons compilé un échantillon
de diagnostics de personnes décédées au cours
des 50 dernières années. Depuis 1952, 3 209
personnes sont décédées d'un cancer dans
les villages voisins. Immédiatement après l'explosion,
il n'y a eu que deux décès. Ensuite, il y a eu deux
pics : le premier 5 à 7 ans après l'explosion,
le second au début des années 1990.
Nous avons également étudié
l'immunologie des enfants : nous avons interrogé les
petits-enfants de personnes ayant survécu à l'explosion.
Les résultats ont été stupéfiants :
les immunogrammes des enfants de Sorochinsky ont montré
une quasi-absence de cellules tueuses naturelles, impliquées
dans la défense anticancéreuse. Le système
interféron, la défense de l'organisme contre le
cancer, est quasiment inexistant chez ces enfants. Il s'avère
que la troisième génération de personnes
ayant survécu à l'explosion atomique vit avec une
prédisposition au cancer », explique Mikhaïl
Skachkov, professeur à l'Académie de médecine
d'Orenbourg. Les participants aux exercices de Totskoïe n'ont
reçu aucun document ; Ils ne sont apparus qu'en 1990,
lorsqu'ils ont obtenu les mêmes droits que les victimes
de Tchernobyl.
Sur les 45 000 soldats ayant participé
aux exercices de Totskoïe, un peu plus de 2 000 sont
encore en vie aujourd'hui. La moitié d'entre eux sont officiellement
reconnus invalides au premier ou au deuxième degré,
74,5 % souffrent de maladies cardiovasculaires, dont l'hypertension
et l'athérosclérose cérébrale, 20,5 %
de maladies gastro-intestinales et 4,5 % de tumeurs malignes
et de maladies du sang.
En 1994, un panneau commémoratif a été
érigé à Totsk, épicentre de l'explosion :
une stèle ornée de cloches. Le 14 septembre,
elles sonneront à la mémoire de toutes les personnes
touchées par les radiations sur les sites d'essais de Totsk,
Semipalatinsk, Nouvelle-Zemble, Kapoustine-Iarsk et Ladoga.
* L'appareil de Kutyrchev était
escorté par des chasseurs MiG-17. Ces derniers étaient
entièrement armés et, selon plusieurs sources, avaient
reçu l'ordre d'abattre immédiatement le Tu-4 s'il
tentait de dévier significativement de sa route, afin d'empêcher
l'équipage de larguer accidentellement ou intentionnellement
ses bombes près des postes de commandement.
AIF, 14 septembre
2014:
Un cauchemar devenu réalité
« Nous avons été enterrés
vivants. Mon escouade et moi étions allongés dans
une tranchée de 2,5 mètres de profondeur, à
6 kilomètres du lieu de l'explosion. Il y a d'abord eu
un éclair intense, puis un bruit si fort que nous sommes
devenus sourds pendant une minute ou deux. Un instant plus tard,
nous avons ressenti une chaleur torride, nous avons été
immédiatement trempés et nous avions du mal à
respirer. Les parois de notre tranchée se sont refermées
sur nous. Nous n'avons été sauvés que grâce
à Kolya, qui s'est assis pour ajuster sa casquette une
seconde avant l'explosion. Il a ainsi pu ramper hors de la tranchée
et nous dégager », se souvient Leonid Pogrebnoy,
participant aux exercices de Totsk .
 Leonid Pogrebny rêve encore des exercices
au centre d'entraînement de Totsky.
Leonid Pogrebny rêve encore des exercices
au centre d'entraînement de Totsky.
Pendant ce temps, une colonne de feu s'élevait
à l'horizon. Là où les oiseaux avaient récemment
chanté et où se dressaient des chênes centenaires,
un nuage en forme de champignon s'élevait, occultant la
moitié du ciel. L'air sentait le brûlé, et
il ne restait plus rien de vivant aux alentours. Plus tard, l'homme
comprendrait que les conséquences des exercices d'entraînement
auxquels il avait été appelé comme officier
de réserve n'étaient pas moins horribles que la
vue du nuage en forme de champignon lui-même.
Des neuf personnes qui travaillaient au sein
de l'équipe spéciale de biologie, j'étais
le seul survivant. Ayant une formation vétérinaire,
j'ai été chargé de sélectionner des
animaux cliniquement sains : chevaux, bovins, petits ruminants,
porcs et même des lapins. Nous les avons placés à
500 mètres de l'épicentre présumé
de l'explosion, sous différents types d'abris. Les chevaux
étaient sous des abris en béton, les porcs sous
des abris en bois, les vaches sous des abris sur pilotis, et les
lapins et les chèvres dans des avions et des chars. Seuls
les chevaux et quelques vaches ont survécu, mais c'était
pitoyable de les voir : leurs cornes avaient fondu et leurs
corps semblaient avoir été arrosés d'eau
bouillante.
Des animaux restants, il ne restait que cendres ou fragments isolés
sabots et queues. La chaleur fit fondre les avions et le
sable se transforma en verre granuleux. L'onde de choc renversa
des chars de plusieurs tonnes, arracha leurs tourelles et les
projeta à un demi-kilomètre.
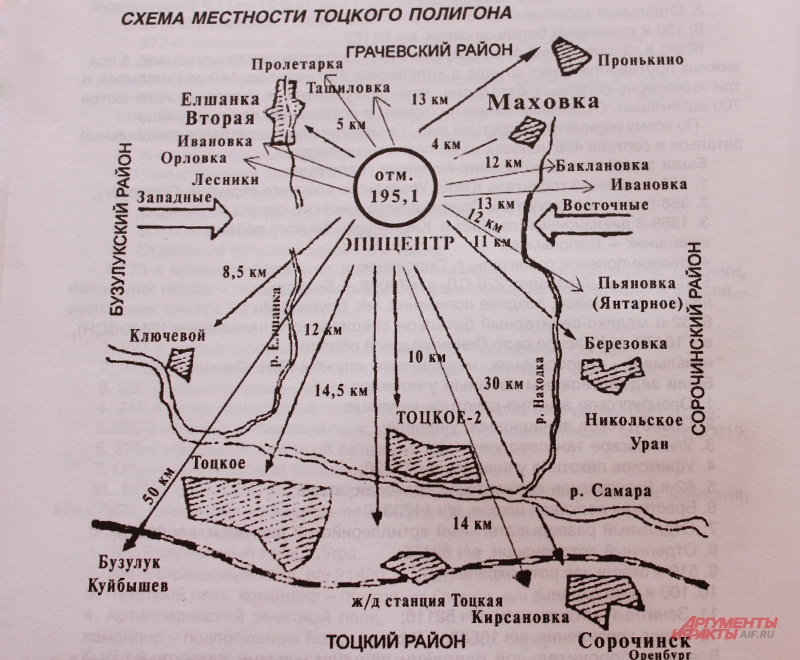 L'explosion
s'est produite à proximité des villages. Schéma
tiré du livre.
L'explosion
s'est produite à proximité des villages. Schéma
tiré du livre.
Des pieux calcinés se dressaient là
où se trouvaient autrefois les arbres, de nombreux animaux
et oiseaux des steppes périrent, et les rares survivants
furent aveuglés. Les châssis des fenêtres furent
soufflés et les murs fissurés dans les maisons situées
à 25 kilomètres de là. Deux villages, heureusement
relocalisés à l'avance, furent réduits en
cendres.
Leonid Petrovich admet que l'explosion elle-même et les
animaux lui donnent encore des cauchemars.
Ils sont morts d'un cancer
Après les examens, Leonid, 26 ans, en pleine forme,
commença à se plaindre de maux de tête incurables
et d'une faiblesse constante. Trois ans plus tard, sa plus jeune
fille naquit, elle aussi atteinte de maux de tête. On lui
diagnostiqua des migraines congénitales. La maladie fut
ensuite transmise à son fils. « Une mutation
génétique », répondit Leonid Petrovich
en secouant la tête.
De nombreux participants à l'expérience nucléaire
de Totskoïe sont morts d'un cancer. Deux assistants vétérinaires
travaillant sous la supervision de Pogrebny sont décédés
d'un cancer dans l'année qui a suivi l'exercice :
l'un d'un cancer du poumon, bien qu'il n'ait jamais fumé,
et l'autre d'un cancer du pancréas.
 L'herbe a repoussé
sur le lieu de l'explosion, et un mémorial avec des cloches
a été érigé.
L'herbe a repoussé
sur le lieu de l'explosion, et un mémorial avec des cloches
a été érigé.
Les proches de Leonid Petrovitch, qui vivaient
près du site d'essai, sont également décédés
d'un cancer. Deux théories s'affrontent actuellement quant
aux conséquences néfastes de l'expérience :
soit les effets nocifs des radiations n'ont pas été
suffisamment étudiés et des civils ont été
exposés aux risques sans le savoir, soit les autorités
ont délibérément testé les effets
des radiations sur le corps humain.
« À l'époque, l'onde de choc était
considérée comme la pire conséquence d'une
explosion, alors tout le monde s'est mis à l'abri. On nous
a fourni des capes et des masques à gaz. Un tel équipement
paraît ridicule aujourd'hui, mais c'est grâce aux
masques à gaz que nous avons survécu lorsque la
tranchée a été remplie de débris »,
explique Leonid Pogrebnoy.
Léonid Petrovitch lui-même était proche de
la mort : son taux d'hémoglobine était proche
de zéro et il était menacé de leucémie.
Il ne fut sauvé de cette maladie mortelle que par un miracle :
son frère lui envoyait régulièrement des
colis de caviar noir et rouge d'Extrême-Orient.
 Voici
l'uniforme remis aux participants à l'expérience
nucléaire.
Voici
l'uniforme remis aux participants à l'expérience
nucléaire.
« Aujourd'hui, ils ne veulent pas établir de lien
entre le cancer et une explosion nucléaire, même
si tout le monde sait depuis longtemps que le nombre de patients
atteints de cancer dans notre région dépasse largement
la moyenne russe », soupire un vétéran des
unités à risques spéciaux.
Polina Sedova
Extrait de « L'Ombre de la Victoire
» de Victor Souvorov:
« Il est généralement admis qu'il y
avait deux catégories de sujets d'essai sur le terrain
d'essai de Totsky : des dizaines de milliers de chevaux,
vaches, moutons, cochons, chiens et chats, et 45 000 (ou
60 000) soldats et officiers. Mais il y avait aussi une
autre catégorie de sujets d'essai : les prisonniers.
L'ancien capitaine soviétique Mladlen Markovic raconte
l'histoire. Son nom n'a pas de consonance sibérienne.
Il faut le préciser. Après la Seconde Guerre mondiale,
l'Union soviétique a formé des milliers d'officiers
pour les armées de pays « frères »
: Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie,
Yougoslavie et Albanie. Mais la rupture avec la Yougoslavie est
survenue. Les jeunes Yougoslaves ont dû faire un choix
: rentrer chez eux, où ils seraient emprisonnés
comme espions de Staline, ou rester en Union soviétique.
Ce choix était purement théorique. Quiconque souhaitait
rentrer était, sur ordre du camarade Staline, emprisonné
ici comme espion yougoslave. Mladlen Markovic, parmi tant d'autres,
est resté, a accepté la citoyenneté soviétique
et s'est enrôlé dans les forces armées de
l'URSS. Il a joué un rôle particulier dans l'expérience
de Totsk. Il a été choisi car, s'il était
mort, personne ne se souviendrait de lui.
Voici son récit : « Le chef du service
chimique du district militaire de l'Oural du Sud, le colonel
Chikhladze, m'a conduit dans un grand bureau où des civils
que je ne connaissais pas étaient assis à une table.
Il m'a présenté à eux, s'est retourné
et est parti. Je pense que Chikhladze n'était pas censé
être au courant de la mission qui m'attendait. Ces inconnus
ne se sont pas présentés et ne m'ont posé
aucune question. Mon consentement n'était requis pour
rien. J'ai écouté l'ordre : « À
partir de demain, vous êtes nommé responsable des
cours de mesure des radiations lors de l'utilisation pratique
des armes atomiques dans l'armée soviétique. Vous
devez former les condamnés à la mesure des radiations
et, avec eux, à la mesure des radiations après
les explosions de bombes atomiques. Vous recevrez tout le nécessaire
pour cette mission. » Puis, on m'a expliqué
mes responsabilités et mes droits illimités :
pour toute désobéissance de mes subordonnés,
j'avais le droit de les abattre sur-le-champ, sans avoir à
rendre de comptes à qui que ce soit. En conclusion, on
m'a fait signer un engagement de confidentialité militaire
pendant 25 ans. J'avais 27 ans à l'époque. »
Des inconnus m'ont donc assigné verbalement à un
poste non officiel et, sans aucun document écrit, m'ont
chargé d'entraîner un détachement de détenus
aux origines inconnues. La seule trace écrite était
ma signature, gage de silence. Le conteneur et le matériel
étaient constamment gardés par deux sentinelles
armées de mitrailleuses. L'accès à la zone
où je vivais et travaillais avec mes cadets était
interdit : notre seule protection consistait en un masque
à gaz à usage général, des bas de
lin et une cape en papier. Nous avons affronté la vague
d'air de l'explosion atomique dans des tranchées ouvertes.
Pendant que les attaquants combattaient l'ennemi sur les flancs
avec leur artillerie et leurs avions, je me dirigeais vers l'épicentre
à bord d'un char. Les niveaux de radiation dans un rayon
de 10 kilomètres étaient élevés,
atteignant [...] roentgens à l'épicentre.
De retour au poste de commandement et après avoir signalé
la situation à mes supérieurs, je suis reparti
avec tout le monde vers l'épicentre, marquant le niveau
de contamination de la zone avec des drapeaux. Cela a mis fin
à mon rôle de sujet d'essai principal sur le terrain
d'essai de Totsky.
Je n'ai pas supporté l'évacuation des prisonniers
et je n'ai rien appris de plus sur leur sort. On m'a placé
sur une couchette, où je suis resté plusieurs jours
sans aucun soin médical. Aucun examen médical n'a
été effectué pour déterminer l'étendue
de mon infection »
Svoboda, 14 septembre
2009:
Victimes du champ de tir de Totsky

Les premières bombes atomiques
soviétiques ont été littéralement
testées sur des personnes vivantes.
La région d'Orenbourg commémore
les événements du 14 septembre 1954, lorsque des
essais nucléaires ont été effectués
sur le site d'essais nucléaires de Totsk, sous le commandement
du maréchal Joukov, dans le cadre d'exercices militaires.
Un bombardier a largué une bombe nucléaire
équivalente à 40 kilotonnes de TNT d'une altitude
de 13 kilomètres, la faisant exploser à 350 mètres
d'altitude. De nombreux participants aux exercices ont ainsi reçu
des doses variables de radiations. Parmi les victimes des manoeuvres
de la bombe atomique figuraient non seulement des militaires,
bénéficiant d'une protection minimale, mais aussi
des civils stationnés dans des unités militaires.
Tous ont signé des accords de confidentialité. Les
données relatives à ces essais restent confidentielles,
mais il s'est avéré impossible d'en dissimuler les
graves conséquences sanitaires. Le nombre exact de décès
dus à l'exposition aux radiations suite aux essais de Totsk
demeure inconnu. Un correspondant de Radio Liberty s'est entretenu
avec des témoins oculaires des événements
survenus il y a 55 ans.
« Il y a eu une terrible explosion,
le sol a tremblé et tout s'est écroulé. Un
nuage en forme de champignon a commencé à se former,
puis à s'enrouler en volutes », se souvient Lidiya
Lebedeva, qui a eu 17 ans quelques jours avant l'explosion nucléaire.
Sur le site d'essais de Totsky, elle et d'autres élèves
de l'école de cuisine étaient stagiaires au mess
des officiers. Le 14 septembre, on ne leur a offert, à
elles, mineures, qu'une couverture pour se protéger des
radiations.
« Elles étaient entièrement
équipées : couvre-chaussures, salopettes et
masques à gaz. Et on m'a dit d'aller chercher une couverture
dans le lit pliant. » Les jeunes filles ont utilisé
ces mêmes couvertures pendant les quarante jours suivants ;
elles n'ont été évacuées du site d'essais
que le 25 octobre. Huit ans plus tard, Lidiya Lebedeva a donné
naissance à une fille.
« Elle est née complètement
malade, sans aucun développement physique ni mental »,
raconte Lydia. Elle est restée allongée là
pendant douze ans. Elle avait la taille d'un enfant de quatre
ans, mais ses membres étaient ceux d'un enfant de dix-huit
mois. Trois ans plus tard, un fils est né, et tout son
système endocrinien a été détruit.
Dans la zone de traces radioactives de Totskoïe,
le taux de natalité a diminué de près de
3 fois en 50 ans et le nombre d'anomalies congénitales
a augmenté de 1,6 fois.
Dans la zone de déchets radioactifs
de Totsk, le taux de mortalité a presque [...] en 50 ans,
tandis que l'incidence des anomalies congénitales a augmenté
de 1,6 fois. Le cancer est la deuxième cause de décès
dans la région d'Orenbourg, après les maladies cardiovasculaires.
« Toutes les personnes ayant reçu une dose importante
de radiations sont décédées immédiatement,
dans l'année », explique l'oncologue Vladimir
Baranovsky. « Le taux d'incidence est élevé
dans notre région, et dans le district de Bouzoulouk et
à Bouzoulouk, il dépasse la moyenne régionale.
»
Bouzoulouk se trouve à 50 kilomètres
du lieu de l'explosion, Orenbourg à 200 kilomètres
et Sorotchinsk à 30 kilomètres. Il y a cinquante-cinq
ans, personne n'essayait d'empêcher les habitants de pénétrer
dans la zone dangereuse. « Cette forêt a été
carbonisée après l'explosion nucléaire »,
raconte Valentina Sotnikova, une habitante du district de Sorotchinsk.
« Les gens ont essayé de construire des maisons
dans cette forêt, car elle était abandonnée,
inutile. Ils l'ont donc entièrement rasée et ont
construit des maisons. Ils y ont vécu deux ou trois ans,
puis sont morts. »
Outre 45 000 militaires,
plus de 10 000 civils et habitants des villages et hameaux
voisins ont été touchés par le nuage radioactif. Lidiya Lebedeva, devenue invalide à 43 ans,
a dû prouver sa participation directe aux essais pendant
plusieurs années. « L'indemnisation s'élève
actuellement à 1 544 roubles. Ce montant comprend
les prothèses dentaires, les déplacements annuels
en Russie, les déplacements urbains, 50 % pour la
radio et 50 % pour le téléphone. Cet argent
est insuffisant. Je ne sais même pas comment le décrire
autrement. » Aujourd'hui,
environ 40 000 personnes vivent dans 58 localités
au sein de la zone d'essais nucléaires. Pendant 55 ans,
aucune d'entre elles n'a reçu de véritable aide
de l'État pour compenser les pertes de santé ou
la perte de proches.
Extrait de « Essai nucléaire à Totskoïe
en 1954 »
Ecrit et traduit par Dietrich Tissen,
22 janvier 2005
« Au total, 45 000 soldats de différentes
parties de l'armée ont pris part à l'exercice. En
plus, il y avait encore 600 chars, 500 canons et lance-mines,
320 avions et 6000 automobiles. En tant que maréchaux de
personnalités importantes GK Zhukov, AM Vasslevskij, KK
Rokossovskiy, IS Konew ont observé le test, en outre il
y avait le secrétaire général du Parti communiste
195364 Nikita Khrouchtchev, le secrétaire à
la défense NA Boulganine et le scientifique nucléaire
IV Kurtchatov présents.
La zone d'essais nucléaires doit être
choisie de manière à ressembler au lieu de déploiement
potentiel en Allemagne, c'est-à-dire qu'elle doit être
vallonnée et boisée. Les tests précédents
ont été principalement effectués dans une
zone désertique près de Semipalatinsk (aujourd'hui
Kazakhstan). Après une enquête "soigneuse",
la zone d'entraînement militaire de Totskoïe a été
sélectionnée. Celui-ci était déjà
utilisé depuis la fin du XVIIIe siècle comme camp
militaire et terrain d'exercice.

Après des préparatifs de plusieurs
jours, environ 380 km de fossés de protection furent creusés,
l'exercice devait avoir lieu le 14 septembre 1954. [...] au début
presque calme, le vent de direction nord-est devenait de plus
en plus fort. Cependant, il restait dans le cadre autorisé
lorsque l'avion porteur a démarré. A 9 heures, le
vent a atteint la vitesse de 20 m/s. À 9 h 33, la bombe
atomique a été lancée d'une hauteur de 8
000 m et a explosé environ 45 secondes plus tard à
une hauteur de 350 m. La bombe atomique utilisée avait
une puissance de 40 kilotonnes de TNT (peut-être 2 à
3 fois celle de la bombe d'Hiroshima). [...] Presque tous les
soldats, qui avaient pris part à l'exercice, devaient porter
des effets néfastes sur la santé. Beaucoup sont
morts plus tard d'un cancer. Ceux qui avaient reçu une
dose assez forte, mouraient déjà dans le camp militaire
à Totskoïe de la maladie des radiations.
Passons maintenant aux effets sur la colonie
de Neu Samara. Comme déjà mentionné, un vent
fort était là avant l'explosion, cela a soufflé
après l'explosion les produits de la fissure et le nuage
de poussière, a grimpé jusqu'à une hauteur
de 12-15 km, loin du lieu de l'explosion. Une grande partie de
la matière radioactive est descendue dans une zone d'environ
210 km de long. L'axe de cette zone allait peut-être du
village de Makhowka à Yashkino et Starobogdanovka dans
le Krasnogvardeyskiy [...], puis à travers Rozhdestvenka
dans le districte d'Alexandrovskij. Le reste a été
éparpillé sur une vaste zone : jusqu'à Krasnosyarsk
et Novossibirsk, à des milliers de kilomètres de
l'explosion. »
MK-ru, 13 septembre
2004:
La vérité sur la zone
de la mort
Ce qui s'est passé il y a
cinquante ans, le 14 septembre 1954, sur le site d'essais de Totsky,
dans la région d'Orenbourg, est resté secret pendant
de nombreuses années.
À 9 h 33, l'explosion d'une des bombes
nucléaires les plus puissantes de son époque retentit
sur la steppe. Aussitôt après, les forces de l'Est
se lancèrent à l'attaque, dépassant des forêts
ravagées par la conflagration atomique et des villages
rasés. Des avions, frappant des cibles au sol, traversèrent
le champignon atomique À dix kilomètres de l'épicentre
de l'explosion, au milieu de poussières radioactives et
de sable en fusion, les forces de l'Ouest tinrent bon. Ce jour-là,
on tira plus d'obus et de bombes que lors de l'assaut sur Berlin.
Tous les participants aux exercices furent
contraints de signer un accord de confidentialité de 25
ans concernant les secrets d'État et militaires. Décédés
prématurément de crises cardiaques, d'AVC et de
cancers, ils ne purent même pas révéler à
leurs médecins leur exposition aux radiations. Rares sont
les participants aux exercices de Totskoïe qui ont survécu
jusqu'à nos jours. Un demi-siècle plus tard, ils
ont révélé à MK la vérité
sur les événements de 1954 dans la steppe d'Orenbourg.
« Un grand honneur vous a été
fait »
Durant toute la fin de l'été,
des trains militaires venus de toute l'Union se dirigeaient vers
la petite gare de Totskoïe.
« Aucun des soldats qui arrivaient -
pas même les commandants d'unité - ne savait pourquoi
ils étaient là », raconte Vladimir Bentsianov,
président du Comité des vétérans des
unités à risque. « À chaque gare, des
femmes et des enfants nous attendaient. Nous tendant de la crème
fraîche et des oeufs, les femmes pleuraient : "Mes
chers enfants, vous allez sans doute en Chine combattre"
»
Stanislav Kazanov a poursuivi sa formation
dans la région d'Orenbourg alors qu'il était cadet
à l'école de sergents de Golitsyn, près de
Moscou, et ce n'est que dans le train qu'il a appris qu'«
une nouvelle arme secrète devait être testée
».
Au début des années 1950, les
préparatifs de la Troisième Guerre mondiale s'intensifiaient.
Après les essais menés aux États-Unis, l'Union
soviétique décida elle aussi de tester une bombe
nucléaire en plein air. Le site de l'exercice, la steppe
d'Orenbourg, fut choisi en raison de sa ressemblance avec les
paysages d'Europe occidentale.
« Au départ, des exercices interarmes
avec une véritable explosion nucléaire étaient
prévus sur le polygone de missiles de Kapustin Yar, mais
au printemps 1954, le polygone de Totsky a été évalué
et reconnu comme le meilleur en termes de conditions de sécurité
», se souvenait à l'époque le lieutenant-général
Osin.
Les participants aux exercices de Totskoïe
racontent une tout autre histoire. Le champ où il était
prévu de larguer la bombe nucléaire était
parfaitement visible.
« Ils ont sélectionné les
plus coriaces de nos escouades pour l'entraînement »,
se souvient Nikolaï Pilashtchikov, qui vit aujourd'hui à
Nijnekamsk. « On nous a distribué des armes de service
individuelles : des fusils d'assaut Kalachnikov modernisés,
des fusils automatiques à dix coups à tir rapide
et des radios R-9. »
Le camp de tentes s'étendait sur 42
kilomètres. Des représentants de 212 unités,
soit 45 000 militaires, arrivèrent pour les manoeuvres
: 39 000 soldats, sous-officiers et sergents, et 6 000 officiers,
généraux et maréchaux. Les préparatifs
de l'exercice, baptisé « Snezhok », durèrent
trois mois. À la fin de l'été, le vaste champ
de bataille était littéralement sillonné
de dizaines de milliers de kilomètres de tranchées,
de fossés et de canots antichars. Des centaines de casemates,
de bunkers et d'abris souterrains furent construits.
« Chaque gramme de terre excavée
représentait un travail colossal. C'était de l'argile
recouverte de gravier », se souvient Nikolaï Pilchtchikov.
« Tous les travaux de génie civil se faisaient avec
des masques à gaz. On creusait, on retirait le masque,
on vidait l'eau, puis on reprenait la pelle La chaleur atteignait
40 à 45 degrés Celsius. Nos uniformes étaient
trempés d'une pellicule blanche de sel, et quand on les
enlevait, ils se déchiraient au niveau des épaules
avec un craquement sonore »
À la veille de l'exercice, les officiers
visionnèrent un film secret sur les effets des armes nucléaires.
« Un studio de cinéma spécial avait été
construit à cet effet, et l'accès y était
réservé aux personnes munies d'une liste et d'une
pièce d'identité, en présence du commandant
du régiment et d'un représentant du KGB »,
se souvient Ivan Putivlsky. « Puis nous avons entendu :
"Vous avez le grand honneur d'être les premiers au
monde à opérer dans les conditions réelles
d'une explosion nucléaire." Nous avons alors compris
pourquoi nous avions recouvert les tranchées et les abris
de plusieurs couches de rondins, en enduisant soigneusement les
parties en bois exposées d'argile jaune Cela était
censé empêcher les radiations de les faire prendre
feu. »
« Les habitants des villages de Bogdanovka
et Fedorovka, situés à 5-6 km de l'épicentre
de l'explosion, ont été priés d'évacuer
temporairement un périmètre de 50 km autour du site
de l'exercice », explique Nikolaï Pilashtchikov. «
L'évacuation a été organisée par les
troupes et les habitants ont pu emporter tous leurs biens. Ils
ont perçu une indemnité journalière pendant
toute la durée de l'exercice. »
« On nous a nourris comme si on allait
à l'abattoir. »
« Les préparatifs des exercices
se sont déroulés sous un déluge de feu d'artillerie.
Des centaines d'avions ont bombardé les zones désignées
», se souvient Ivan Putivlsky. « Un mois avant les
exercices, un Tu-4 larguait chaque jour une bombe factice de 250
kg sur l'épicentre. »
D'après les souvenirs du lieutenant-colonel
Danilenko, une croix en calcaire blanc de 100 mètres sur
100 était peinte dans une vieille chênaie entourée
d'une forêt mixte. C'était la cible des pilotes d'entraînement.
L'écart par rapport à la cible ne devait pas excéder
500 mètres Des troupes étaient positionnées
autour.
Deux équipages furent entraînés
: le commandant Kutyrchev et le capitaine Lyasnikov. Jusqu'au
dernier moment, les pilotes ignoraient qui serait le pilote en
tête et qui serait le pilote suppléant. L'équipage
de Kutyrchev bénéficiait d'un avantage, ayant déjà
effectué des essais en vol d'une bombe atomique sur le
site d'essais de Semipalatinsk.
Le régime était extrêmement
strict. « L'adresse de retour sur les lettres était
Brest ou d'autres villes d'où provenaient les unités,
mais pas Totskoïe », explique Bentsianov.
Tous les participants à l'exercice ont
été nourris comme s'ils allaient à l'abattoir.
On leur a donné de la viande, du lait concentré,
des fruits et des légumes
« Avant l'explosion, les hommes de notre
unité, en tête de l'avancée, ont d'abord reçu
des sous-vêtements, puis des sous-vêtements chauds
», raconte Nikolaï Pilchtchikov. « Et ce, par
une chaleur de 36 degrés ! On nous a aussi donné
des doublures teintées spéciales pour nos masques
à gaz, à travers lesquelles le soleil filtrait à
peine, ainsi que des capes en une matière ressemblant à
du papier imbibé de kérosène, et des bas
montants en fils synthétiques épais, à porter
par-dessus les bottes. Ils étaient verts et avaient une
odeur âcre. »
Chaque membre de la section de reconnaissance
radiologique a reçu un dosimètre neuf. Pour mesurer
le niveau de radiation, il fallait ouvrir un orifice au fond et
lire l'affichage. Une ligne rouge marquait la dose de «
50 roentgens ». Si la flèche la franchissait, les
soldats devaient quitter la zone.
Pour éviter les dommages causés
par l'onde de choc, les troupes situées entre 5 et 7,5
km de l'épicentre de l'explosion ont reçu l'ordre
de se mettre à l'abri, et celles situées au-delà
de 7,5 km, de rester dans des tranchées en position assise
ou couchée.
« La glace est brisée ! »
« Sur une colline, à 15 kilomètres
de l'épicentre prévu de l'explosion, une tribune
gouvernementale a été construite pour observer les
exercices », explique Ivan Putivlsky. « La veille,
elle avait été peinte en vert et blanc à
la peinture à l'huile. Des dispositifs d'observation y
avaient été installés. Une route goudronnée
avait été aménagée sur le sable profond,
reliant la gare à la tribune. La police militaire de la
circulation interdisait l'accès à cette route à
tout véhicule non autorisé »
« Trois jours avant le début de
l'exercice, les plus hauts responsables militaires commencèrent
à arriver sur la base aérienne près de Totsk
: les maréchaux soviétiques Vassilievski, Rokossovski,
Koniev et Malinovski », se souvient Pilashtchikov. «
Même les ministres de la Défense des démocraties
populaires arrivèrent : les généraux Marian
Spychalski, Ludwig Svoboda, le maréchal Zhu De et Peng
De Huai Ils furent tous logés dans un complexe gouvernemental
construit à l'avance près du camp. La veille de
l'exercice, Khrouchtchev, Boulganine et le concepteur des armes
nucléaires, Kourtchatov, se présentèrent
à Totsk. »
Le maréchal Joukov fut nommé
commandant de l'exercice. Des véhicules de combat - chars,
avions et véhicules blindés de transport de troupes
- furent positionnés autour de l'épicentre de l'explosion,
marqué d'une croix blanche. Des « troupes »
- moutons, chiens, chevaux et veaux - y furent attachées
dans les tranchées et au sol.
Et l'heure « H » est arrivée
Le jour de l'exercice, les deux équipages
de Tu-4 étaient fin prêts : des bombes nucléaires
étaient installées sur chaque appareil, les pilotes
démarrèrent simultanément leurs moteurs et
se déclarèrent prêts à accomplir la
mission. L'équipage de Kutyrchev, avec le capitaine Kokorin
comme bombardier, Romensky comme copilote et Babets comme navigateur,
reçut l'ordre de décoller. Le Tu-4 était
accompagné de deux chasseurs MiG-17 et d'un bombardier
Il-28, chargés de la reconnaissance météorologique,
du tournage et de la sécurité en vol.
« Le 14 septembre, on nous a réveillés
à quatre heures du matin. C'était une matinée
claire et calme », raconte Ivan Putivlsky. « Pas un
nuage à l'horizon. On nous a emmenés en voiture
au pied de la tribune gouvernementale. Nous nous sommes installés
dans un ravin et avons pris des photos. Le premier signal a retenti
par les haut-parleurs de la tribune 15 minutes avant l'explosion
nucléaire : "La glace a bougé !" Dix minutes
avant l'explosion, nous avons entendu le deuxième signal
: "La glace bouge !" Conformément aux instructions,
nous sommes sortis des voitures en courant et avons rejoint les
abris préparés à l'avance dans le ravin,
à côté de la tribune. Nous nous sommes allongés
sur le ventre, la tête face à l'explosion, comme
on nous l'avait appris, les yeux fermés, les mains sous
la tête et la bouche ouverte. Le dernier signal, le troisième,
a retenti : "Éclair !" Un grondement infernal
s'est fait entendre au loin. L'horloge s'est arrêtée
à 9 h 33. »
L'avion porteur largua la bombe atomique à
une altitude de 8 000 mètres lors de son second passage
sur la cible. La puissance de la bombe au plutonium, nom de code
« Tatyanka », était de 40 kilotonnes d'équivalent
TNT, soit plusieurs fois supérieure à celle de la
bombe larguée sur Hiroshima. D'après les souvenirs
du lieutenant-général Osin, une bombe similaire
avait déjà été testée sur le
site d'essais de Semipalatinsk en 1951. La « Tatyanka »
de Totsk explosa à 350 mètres d'altitude. L'épicentre
déviait de 280 mètres vers le nord-ouest.
Au dernier moment, le vent
a tourné : il a transporté le nuage radioactif non
pas vers la steppe déserte, comme prévu, mais directement
vers Orenbourg et plus loin, vers Krasnoïarsk...
« Il ne restait plus un seul chêne
centenaire dans un rayon de 300 mètres. »
« Cinq minutes après l'explosion
nucléaire, les tirs d'artillerie ont commencé à
se préparer, suivis d'un bombardement. Canons et mortiers
de différents calibres, lance-roquettes Katioucha, pièces
d'artillerie automotrices et chars d'assaut retranchés
se sont mis à gronder Le commandant de bataillon nous a
dit plus tard que la densité de feu par kilomètre
carré était supérieure à celle de
la prise de Berlin », se souvient Kazanov.
« Pendant l'explosion, malgré
les tranchées et les abris fermés où nous
étions, une lumière vive a pénétré,
et quelques secondes plus tard, nous avons entendu un bruit sec,
comme un éclair », raconte Nikolaï Pilchtchikov.
« Trois heures plus tard, le signal d'attaque a été
reçu. Les avions, frappant des cibles au sol 21 à
22 minutes après l'explosion nucléaire, ont traversé
le champignon atomique le tronc du nuage radioactif Mon
bataillon et moi, à bord d'un véhicule blindé
de transport de troupes, avons parcouru 600 mètres depuis
l'épicentre de l'explosion à une vitesse de 16 à
18 km/h. J'ai vu une forêt entièrement brûlée,
des colonnes de matériel tordues, des animaux carbonisés
À l'épicentre même dans un rayon de
300 mètres il ne restait pas un seul chêne
centenaire ; tout était brûlé Du matériel
situé à un kilomètre de l'explosion était
écrasé sous terre. »
« Nous avons traversé la vallée,
à deux kilomètres et demi de l'épicentre
de l'explosion, en portant des masques à gaz », se
souvient Kazanov. Du coin de l'oeil, nous apercevions des avions
à moteur à pistons en flammes, des voitures et des
véhicules d'état-major, jonchés de restes
de vaches et de moutons. Le sol ressemblait à de la scories,
une substance monstrueusement tourmentée. Après
l'explosion, la zone était à peine reconnaissable
: l'herbe fumait, des cailles calcinées couraient alentour,
les buissons et les bosquets avaient disparu. J'étais entouré
de collines dénudées et fumantes. Un mur noir de
fumée, de poussière, de puanteur et de suie s'élevait.
J'avais la gorge sèche et irritée, les oreilles
bourdonnaient Le général m'ordonna de mesurer le
niveau de radiation près d'un feu mourant à l'aide
d'un dosimètre. J'y accourus, j'ouvris le volet situé
sous l'appareil et l'aiguille sortit de l'échelle. «
Montez dans la voiture ! » ordonna le général,
et nous nous éloignâmes de cet endroit, qui s'avéra
être tout près de l'épicentre de l'explosion
Deux jours plus tard, le 17 septembre 1954,
le journal Pravda publiait un reportage de l'agence TASS : «
Conformément au plan de recherche scientifique et de travaux
expérimentaux, un essai d'un type d'arme atomique a été
mené ces derniers jours en Union soviétique. L'objectif
de cet essai était d'étudier les effets d'une explosion
atomique. L'essai a donné des résultats précieux
qui aideront les scientifiques et les ingénieurs soviétiques
à résoudre efficacement les problèmes liés
à la défense contre une attaque atomique. »
Les troupes avaient atteint leur objectif : le bouclier nucléaire
du pays était créé.
Les pilotes ont reçu chacun [une
voiture] Pobeda.
Les habitants des villages
environnants, dont les deux tiers furent détruits par l'incendie,
transportèrent les nouvelles maisons qu'ils avaient construites,
bûche par bûche, vers les anciens emplacements, habités
mais déjà contaminés, et ramassèrent
dans les champs des céréales radioactives et des
pommes de terre cuites. Longtemps, les anciens de Bogdanovka,
Fyodorovka et du village de Sorochinskoïe se souvinrent de
l'étrange lueur du bois de chauffage. Les piles de bois,
constituées d'arbres calcinés dans la zone de l'explosion,
luisaient d'une lueur verdâtre dans l'obscurité.
Souris, rats, lapins, moutons,
vaches, chevaux et même insectes ayant séjourné
dans la « zone » ont été soumis à
un examen minutieux « Après les exercices, nous n'avons
subi qu'un contrôle dosimétrique », se souvient Nikolaï Pilchtchikov. « Les
spécialistes s'intéressaient bien plus aux rations
sèches qui nous avaient été distribuées
le jour des exercices, enveloppées dans une couche de caoutchouc
de près de deux centimètres d'épaisseur Ils
les ont immédiatement emportées pour analyse. Le
lendemain, tous les soldats et officiers ont reçu des rations
normales. Les mets délicats ont disparu. »
Stanislav Ivanovitch Kazanov se souvient qu'ils
revenaient du camp d'entraînement de Totsky non pas dans
le train de marchandises par lequel ils étaient arrivés,
mais dans un wagon de voyageurs ordinaire. De plus, le train les
laissa passer sans le moindre retard. Les gares défilèrent
: un quai désert, où un chef de gare solitaire saluait.
La raison était simple. Semion Mikhaïlovitch Boudionny
revenait d'exercices d'entraînement dans le même train,
dans un wagon spécial.
« Un accueil fastueux attendait le maréchal
à la gare de Kazan à Moscou », se souvient
Kazanov. « Nos élèves
de l'école des sous-officiers n'ont reçu ni insignes,
ni certificats spéciaux, ni décorations Nous n'avons
jamais reçu non plus la gratitude
que le ministre de la Défense, Boulganine, nous avait exprimée.
»
Les pilotes ayant largué la bombe nucléaire
reçurent chacun une voiture Pobeda pour avoir mené
à bien leur mission. Lors du débriefing, Boulganine
remit au commandant d'équipage Vassili Koutyrchev l'Ordre
de Lénine et, avec une année d'avance, le promut
au grade de colonel.
Les résultats des exercices
interarmes utilisant des armes nucléaires ont été
classés « top secret ».
« Chacun des Totsky a 50 diagnostics
»
De tels exercices à grande échelle
se déroulent rarement sans victimes. « Nous en avons
eu aussi : lors d'un entraînement par quarante degrés,
le commandant responsable des transmissions du régiment
de chars a été victime d'une crise cardiaque,
et une nuit, par inadvertance, un soldat a été écrasé
par un char », se souvient Ivan Putivlsky. « Mais
pendant les exercices, il n'y a eu aucune victime. » Les
essais nucléaires ont affecté la santé des
participants par la suite
« En 1990, une demande
est arrivée de Leningrad, du Comité des vétérans
des unités à risque spécial, concernant mon
mari », se souvient Anna Novomodnaya, habitante de Khabarovsk.
« J'avais enterré Anatoly Pavlovich douze ans auparavant
Mon mari commandait un bataillon de chars lors des manoeuvres
de Totskoïe. Tolya est décédé en août
1978, officiellement de la tuberculose, deux ans avant l'expiration
de son accord de confidentialité. »
Je me souviens très
bien comment, en 1954, leur unité fut retirée en
urgence de sa caserne et envoyée par train « en colonie
de vacances ». À leur retour, tous se plaignirent
de malaise, de frissons intenses, de syncopes et de douleurs diffuses
difficiles à diagnostiquer. Nombre d'entre eux furent alors
démobilisés, avec invalidité et une maigre
pension. On diagnostiqua chez Tolya une tache sombre au poumon
Mon mari, conscient de son
exposition aux radiations, n'a même pas pu en parler à
son médecin Je n'ai appris que des années plus tard
comment, sans aucune protection, ils avaient été
conduits à l'épicentre du bombardement atomique,
où les niveaux de radiation dépassaient les 50 roentgens.
Aujourd'hui, aucun de ceux qui se trouvaient « sous le parapluie
nucléaire » avec mon mari en 1954 n'est encore en
vie : handicapés, ils sont décédés
prématurément d'infarctus, d'AVC ou de cancers.
Pour des raisons de secret, aucun contrôle
ni examen des participants à cette expérience inhumaine
n'a été effectué. Tout a été
dissimulé et étouffé. Le nombre de victimes
civiles demeure inconnu. Les archives de l'hôpital du district
de Totsk, couvrant la période de 1954 à 1980, ont
été détruites.
Le professeur Mikhaïl
Skachkov de l'Académie médicale d'Orenbourg déclare
:
« Au bureau d'état
civil de Sorochinsky, nous avons compilé un échantillon
de diagnostics de personnes décédées au cours
des 50 dernières années. Depuis 1952, 3 209 personnes
sont décédées d'un cancer dans les villages
voisins. Immédiatement après l'explosion, il n'y
a eu que deux décès. Puis il y a eu deux pics :
l'un 5 à 7 ans après l'explosion, et le second au
début des années 1990. »
Nous avons également étudié
l'immunologie des enfants en interrogeant les petits-enfants des
survivants de l'explosion. Les résultats sont étonnants
: les immunogrammes des enfants de Sorochintsy ont révélé
une quasi-absence de cellules NK, impliquées dans la défense
anti-cancer. Le système interféron, mécanisme
de défense de l'organisme contre le cancer, est pratiquement
inexistant chez ces enfants. Il s'avère que la troisième
génération de survivants de la bombe atomique présente
une prédisposition au cancer.
« J'ai survécu à 44 hospitalisations
et je suis devenu presque complètement aveugle »,
raconte Bentsianov. « Les participants aux exercices de
Totskoye n'ont reçu aucun document ; ils ne sont apparus
qu'en 1990, lorsque nous avons obtenu les mêmes droits que
les victimes de Tchernobyl. »
« Lorsque l'ordre concernant les participants
aux exercices de Totskoïe a été émis,
après tant d'années de secret, je n'ai pas pu trouver
les documents nécessaires dans les archives pendant cinq
ans », raconte Stanislav Kazanov. « À l'époque,
mentionner l'utilisation d'armes nucléaires dans les ordres
et les documents de combat était considéré
comme inacceptable. »
Sur les 45 000 militaires ayant
participé aux exercices Totskoye, un peu plus de 2 000
sont encore en vie. La moitié d'entre eux sont reconnus
comme ayant une invalidité de premier ou de deuxième
degré, 74,5 % souffrent de maladies cardiovasculaires,
notamment d'hypertension et d'athérosclérose cérébrale,
20,5 % de maladies gastro-intestinales et 4,5 % de tumeurs malignes
et de maladies du sang.
Ces données coïncidaient avec les
résultats de scientifiques japonais et britanniques ayant
examiné des victimes des bombardements atomiques d'Hiroshima
et de Nagasaki.
« Chacun des soldats de la brigade Totsky
présentait jusqu'à 50 diagnostics. En 1954, nous
avons mené une guerre nucléaire sans ennemi, où
il était impossible de contrôler l'impact des facteurs
de risque », conclut Bentsianov. « Les vétérans
pensaient et espéraient que leurs prestations seraient
à vie. Récemment, 304 députés de la
Douma d'État ont voté pour remplacer les prestations
des vétérans des unités à haut risque
par une compensation financière bien insuffisante »
Il y a dix ans, un mémorial a été
érigé à Totsk, à l'épicentre
de l'explosion : une stèle ornée de cloches. Aujourd'hui,
elles sonneront en mémoire de toutes les victimes des radiations
sur les sites d'essais nucléaires de Totsk, Semipalatinsk,
Novaya Zemlya, Kapoustine-Iarsk et Ladoga. Lors de ces guerres
nucléaires non déclarées.
Svetlana Samodelova
Extrait de News RU, 14 septembre 2004
:
Il y a 50 ans, l'URSS menait l'opération
« Boule de neige »
«Sur les 45 000 soldats qui ont participé
aux exercices de Totsk, un peu plus de 2 000 sont aujourd'hui
en vie. La moitié d'entre eux sont officiellement reconnus
comme invalides des premier et deuxième groupes, 74,5%
ont des maladies du système cardiovasculaire, y compris
l'hypertension et l'athérosclérose cérébrale,
20,5% ont des maladies du système digestif et 4,5% ont
des néoplasmes malins et des maladies du sang. »

Le lieu de l'explosion est marqué
par deux monuments :

Un panneau commémoratif a
été érigé par l'armée en 1994.

Une stèle avec des cloches
érigé en 2004 ou 2014.
Extrait du livre Apocalypse Rouge, de
Pierre Kohler, 1995:
Près de Totskoe, le point
zéro...
Manoeuvres militaires réalisées
en 1954 à Totskoe, dans la circonscription d'Orenbourg,
au nord de la mer Caspienne, pour évaluer les effets d'une
explosion nucléaire dans les conditions réelles
d'un conflit.
C'est en fait à l'automne 1953 que les
militaires soviétiques ont commencé à considérer
sérieusement le problème des effets d'une explosion
nucléaire en situation réelle, afin d'adapter au
mieux leur défense dans l'hypothèse d'une guerre
atomique. Un premier exercice à blanc permit d'évaluer
les méthodes de conduite du combat, au cas où l'ennemi
utiliserait des armes nucléaires. L'exercice était
dirigé par le maréchal Konev, et même le constructeur
de fusées Serguei Korolev y assistait. Mais l'explosion
proprement dite était alors simulée.
En novembre 1953, le ministère de la Défense ordonne
que l'ensemble du personnel militaire reçoive une formation
technique et psychologique, adaptée au combat sur un champ
de bataille nucléaire. A cette époque, l'Armée
rouge est surtout préoccupée par la défense
à mettre en oeuvre contre les armes nucléaires,
plus que par leur utilisation offensive. En tout cas, l'URSS vit
réellement dans la crainte d'une guerre nucléaire,
et n'a pas encore une juste idée du danger des radiations.
Le stage va durer six semaines et sera suivi par 150 officiers.
L'entraînement pour une opération effectuée
dans des conditions réelles débute durant l'hiver
1953-1954 sous le commandement du général Ivan Petrov,
tandis que le maréchal Gueorgui Joukov dirige l'ensemble
de l'opération. La zone de « combat »
choisie se situe à seulement 130 kilomètres au sud-est
de Kouibichev (aujourd'hui Samara), peuplée de 800 000
habitants ! Différentes sortes de défenses
sont mises en place sur le terrain, allant de simples fortifications
aux bunkers à double porte pour protéger les munitions
du puissant souffle mécanique et thermique de l'explosion.
Quand les soldats arrivent à Totskoe au début de
l'été 1954, ils savent déjà qu'ils
vont participer à un exercice nucléaire, et reçoivent
une instruction sur la meilleure façon de se protéger
contre les effets d'une explosion atomique.
Puis c'est le « grand » jour. Les habitants
des villages environnants sont évacués d'autorité
dans un rayon de 7 kilomètres, et à ceux qui habitent
un peu plus loin, on explique ce qu'il faudra faire quand la bombe
explosera. [...]
Le 14 septembre 1954, à 6h28 du matin,
un bombardier Tu-4 commence à rouler sur la piste d'un
aéroport militaire situé à 680 kilomètres
de là. Le lourd appareil prend de l'altitude, escorté
de deux bombardiers légers. Dans sa soute : une bombe
atomique de [40] kilotonnes, [deux fois] la puissance que celle
larguée neuf ans auparavant par les Américains sur
Hiroshima... L'appareil est guidé avec précision
tout au long de son trajet vers sa cible, son plan de vol ayant
été établi pour éviter de survoler
des villes. Des feux ont été allumés dans
la steppe pour matérialiser sa ligne de vol, mais l'équipage
est rôdé. Il a en effet déjà effectué
ce trajet à treize reprises, au cours de vols d'entraînement.
Près de Totskoe, le point zéro a été
marqué par une grande croix blanche tracée dans
les champs, à la chaux. Les premières tranchées
se trouvent à seulement 5 kilomètres du point d'explosion.
A 9h20, le maréchal Joukov signe l'ordre de larguage de
la bombe et l'état d'alerte atomique est aussitôt
décrété dans toute la région. Il est
9h33 lorsque le Tu-4, dès son premier passage, largue son
dangereux colis, d'une altitude de 8 000 mètres. L'explosion
a lieu une minute plus tard, à 280 mètres du sol,
et c'est alors la vision terrifiante bien connue des spécialistes :
un flash aveuglant, puis un énorme nuage rouge-orangé
qui vire au noir profond et enfle démesurément tout
en s'élevant dans le ciel comme une longue colonne, bientôt
surmontée d'un curieux chapeau en forme de champignon.
Au sol, juste en dessous, s'étale une magnifique forêt
de chênes séculaires. Elle disparaît en une
fraction de seconde, soufflée, calcinée, volatilisée.
Comme tout ce qui se trouve dans un cercle de 3 kilomètres
de diamètre. Même les tranchées couvertes
sont détruites, jusqu'à 1 300 mètres du lieu
de l'explosion, et les dégâts sont très importants
jusqu'à 6 kilomètres du point zéro.
Le haut Commandement, prudent, s'est placé à la
distance respectable de 15 kilomètres. Parmi les spectateurs,
au milieu de tous les gradés soviétiques, se trouvent
même les ministres de la Défense de plusieurs pays
du bloc communiste, et deux généraux chinois. Malgré
la distance, le souffle de l'explosion, a emporté leurs
képis ! Cinq minutes plus tard, l'artillerie ouvre
le feu sur un ennemi invisible, que pas moins de 86 bombardiers
légers Iliouchine-28 vont ensuite piloner, larguant 700
tonnes de bombes classiques. L'un des officiers, qui a connu le
bombardement de Berlin, avoue qu'il n'avait jamais rien vu de
tel.
Quarante minutes après l'explosion, un premier détachement
reçoit l'ordre de pénétrer dans cet enfer
radioactif. Les jeunes hommes lancés dans cette aventure
découvrent alors un spectacle d'apocalypse, tout en progressant
au milieu des arbres calcinés et des cadavres d'animaux.
La consigne est de ne contourner que les terrains qui émettent
plus de [...] rems par heure, et de ne pas s'approcher à
moins de 500 mètres du point zéro. Au total pas
moins de 44 000 soldats sous le sceau du secret le plus total
ont participé à cet exercice hors du commun. Lors
de l'explosion, ils étaient abrités dans de simples
tranchées. A la fin de la journée, ces hommes sont
retournés au campement pour prendre une douche et changer
d'uniforme. C'est la seule décontamination qu'ils aient
subie. Quant aux armes, elles ont été ramenées
telles quelles à la caserne...
[...] Les responsables militaires, eux, sont satisfaits :
l'opération a été menée dans des conditions
très réalistes. La frappe nucléaire a provoqué
les dommages attendus, et les troupes participantes se sont enfoncées
sans crainte dans la zone de l'explosion. Cette simulation de
guerre atomique a été filmée, puis étudiée
attentivement par l'Etat major pour servir de base à une
nouvelle stratégie. Les généraux ont en effet
constaté que les armes nucléaires tactiques pouvaient
parfaitement être utilisées dans un conflit, tout
autant que l'armement stratégique qui jusque là
prévalait.
En récompense, les officiers ont reçu une montre
gravée à leur nom ! Mais les soldats n'ont
eu droit à aucun traitement spécial, et à
aucun dédommagement. C'est seulement en septembre 1989,
soit trente cinq-ans plus tard, qu'un article paru dans le journal
du ministère de la Défense, Krasnaya zvezda*
(l'Etoile rouge), a pour la première fois évoqué
ces « soldats atomiques » et cette expérience
extraordinaire au sens littéral du terme. Puis la Pravda
a enquêté et récupéré des
informations dans le fichier du Comité des vétérans
des « détachements à hauts risques ».
En 1992, ses journalistes ont pu alors retrouver des témoins,
qui s'étaient engagés par écrit à
ne rien révéler de cette expérience pendant
vingt-cinq ans. Ils auront finalement respecté leur serment
pendant dix ans de plus ! Mais on n'a pu recueillir le témoignage
que d'un millier de militaires ayant participé aux manoeuvres
de Totskoe. La plupart des 43 000 autres sont aujourd'hui décédés
des suites de l'irradiation. Quant aux survivants, ils sont oubliés
par l'Etat, qui s'est totalement désintéressé
de leur sort.
* Journal du ministère de la Défense
de l'URSS.

Krasnaya Zvezda,
entretien réalisé par le lieutenant-colonel Valentin
Rudenko de V. Ya. Bentsianov, président du Comité
des vétérans des unités à risque spécial,
24 septembre 1992:
Le champignon atomique n'a pas empoisonné
nos âmes.
Aujourd'hui, nul n'ignore que des milliers
de militaires, et pas seulement des scientifiques, ont participé
à la création du bouclier nucléaire de la
Patrie, et ont été directement impliqués
dans l'assemblage des charges et les essais de bombes atomiques.
Il y a trois ans, ils se sont unis pour former le Comité
des vétérans des unités à risque spécial,
présidé par Vladimir Bentisianov, participant aux
exercices Totskoïe de 1954 et ancien directeur général
adjoint de l'association Sevzapmebel. Notre correspondant s'est
entretenu avec lui.
Vladimir Yakovlevitch, comment est née
l'idée de ce comité et qui en étaient les
membres ?
- Pendant de
nombreuses années, la presse n'a divulgué aucune
information sur les exercices impliquant des armes nucléaires.
Même si de rares fuites parvenaient parfois à paraître,
elles ne mentionnaient pas la participation de militaires à
ces exercices. Comme si la bombe atomique était une notion
abstraite. Pourtant, ceux qui ont participé à sa
création et à ses essais ont accompli des choses
extraordinaires. C'étaient des héros.
Leur héroïsme réside également
dans le fait qu'ayant signé un accord de confidentialité
concernant les secrets militaires, ils ont respecté cet
engagement pendant plusieurs décennies. Un tel précédent
n'existait dans l'histoire ni de nos armées ni des armées
étrangères.
La perestroïka a levé le voile
du secret qui entourait les essais d'armes nucléaires.
Les journaux nationaux, dont Krasnaya Zvezda, ont publié
de nombreux articles sur Totskoïe et d'autres exercices.
J'ai également participé à une émission
de télévision populaire de Leningrad, où
j'ai partagé mes souvenirs de ce mois de septembre 1954
caniculaire. Par la suite, les lettres ont afflué. Chacune
d'elles relatait une tragédie, un supplice. Nous avons
donc décidé de nous unir pour former le Comité
des vétérans des unités à risque,
qui a par la suite obtenu le statut d'organisation publique de
la Fédération de Russie.
Le comité regroupait des personnes ayant
personnellement vécu l'expérience du « nuage
champignon » ou l'ayant traversé, et ayant participé
directement aux essais d'armes nucléaires. Parmi elles,
le capitaine de vaisseau de 1er rang (à la retraite) Nikolaï
Zateïev, commandant de l'un des premiers sous-marins nucléaires,
le K-19, et le colonel
(à la retraite) Youri Sazonov, assembleur de charges nucléaires,
dont celle de la « bombe de Totskoïe ».
Le lieutenant-colonel à la retraite Evgueni Ivanovitch
Novikov, avec de nombreux autres scientifiques nucléaires
militaires, a accompli un travail considérable pour identifier
les participants à l'exercice parmi les équipages.
Notre comité a été créé
à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Le 9
mai 1990, nous avons défilé pour la première
fois sur la perspective Nevski avec une banderole où l'on
pouvait lire « Anciens combattants des unités
spéciales à risque ». On raconte qu'après
cela, les journaux locaux ont été submergés
de lettres demandant qui nous étions.
D'ailleurs, pourquoi votre comité
porte-t-il un tel nom ? À ma connaissance, il n'y
a jamais eu d'unités spéciales à risque dans
l'armée, le KGB ou le ministère de l'Intérieur.
- En effet, il
n'y en a jamais eu. Mais nous ne nous sommes pas appelés
ainsi par hasard. D'abord, pour souligner l'héroïsme
et le dévouement à la patrie de ces personnes. Ensuite,
pour éviter d'afficher notre implication dans les armes
nucléaires. Nous pensons qu'il n'est pas convenable de
s'en vanter.
Les scientifiques nucléaires militaires
sont une espèce à part. Le champignon atomique a
empoisonné leurs vies, mais pas leurs âmes. Des centaines
de lettres reçues par la commission déplorent que
ces personnes aient été oubliées. Pourtant,
aucune ne critique le gouvernement, l'État ou l'armée.
Je tiens à ce que chacun comprenne :
la commission ne réunit pas des plaignants ni des victimes
de l'explosion atomique, mais des personnes qui ont consciemment
traversé l'épicentre de cette explosion.
Dites-moi, avez-vous des informations sur
le nombre de scientifiques nucléaires militaires présents
dans le pays ? Il est possible que d'autres exercices et
essais aient eu lieu, dont on ignore encore tout.
- Je ne connais
pas le nombre exact, et je ne pense pas que quiconque le connaisse.
Tout ce qui concernait les armes nucléaires s'est déroulé
dans le plus grand secret. Nous avons connaissance de cas où
les noms d'unités militaires et de militaires ont été
modifiés. Et pourtant, notre objectif principal est de
tous les retrouver.
Actuellement, le comité réunit
les participants aux exercices et essais d'armes nucléaires
menés à Semipalatinsk, Novaya Zemlya, Totskoïe et sur d'autres
sites d'essais, ainsi que des assembleurs d'ogives nucléaires,
des spécialistes ayant participé aux interventions
suite à des accidents sur des sous-marins et des navires
de surface, et d'autres militaires impliqués dans la mise
en place du bouclier nucléaire de la Patrie. Notre comité
comprend non seulement des fantassins, des transmetteurs, des
pilotes, des artilleurs, des marins et des médecins militaires,
mais aussi d'anciens membres du KGB et du ministère de
l'Intérieur.
Vladimir Yakovlevitch, en examinant le mandat
du Comité des unités spéciales à risque,
j'ai constaté que l'éventail des tâches que
vous vous êtes fixées est très large. Laquelle
considérez-vous comme prioritaire ?
- La priorité
absolue du comité est, sans aucun doute, le moral des troupes.
La réadaptation physique, financière,
médicale et sociale des militaires travaillant dans le
nucléaire, ainsi que de leurs familles. Aussi triste que
cela soit à admettre, beaucoup de ceux qui ont vécu
l'incident du « champignon nucléaire »
ne sont plus parmi nous.
Malgré l'effondrement de l'Union soviétique,
le comité se sent tenu de protéger nos camarades
d'armes, non seulement en Russie, mais aussi dans les autres États
membres du Commonwealth. Là-bas, pendant l'entraînement,
nous ne nous divisions pas en Ukrainiens, Ouzbeks, Kazakhs ou
Moldaves. Dans notre seul
bataillon de reconnaissance, il y avait des représentants
de plus de 20 nationalités. Nous
nous appelions entre nous « compatriotes ».
Et aujourd'hui, je recherche Bayselbayev, Taygushanov et Dyusembayev
du Kazakhstan, Papazyan d'Arménie et Bordian de Moldavie.
Aman Nepesov, Nepes Durdy le petit Nepes, qui jouait de
son instrument traditionnel du Turkménistan. Batyrov
du Kirghizistan, Kryuchkov d'Ivanovo, Rurik Abashidze de Zestafoni
(Géorgie), Paliy et Parfenov d'Ukraine, et Karl Järvolakht
d'Estonie. Je prie pour qu'ils soient sains et saufs.
Au moment des exercices de Totskoïe,
auxquels vous avez participé, les leçons tirées
d'Hiroshima et de Nagasaki l'avaient déjà été.
En a-t-on tenu compte lors des exercices ?
- Il m'est difficile
de répondre précisément à cette question.
J'étais soldat et je ne pouvais pas tout savoir. Mais il
est généralement admis que les conséquences
possibles d'une explosion nucléaire ont été
sous-estimées pendant les exercices. Je pense que cela
s'explique par le fait que les responsables directs des exercices
avaient un objectif strict et très précis :
livrer des armes d'une certaine puissance dans un délai
imparti, à n'importe quel prix.
Pourtant, après nous avoir contraints
à signer un accord de confidentialité ce qui
était absolument nécessaire à l'époque,
en pleine Guerre froide , l'État aurait dû soumettre
tous les participants aux exercices à un examen médical
approfondi et à un suivi régulier. Nous aurions
peut-être alors été mieux préparés
à la tragédie de Tchernobyl. Malheureusement, à
ce jour, malgré tous nos efforts, nous n'avons bénéficié
d'aucun examen médical spécifique. Nous avons des
griefs à formuler à l'encontre de l'ancienne direction
du ministère de la Défense et des scientifiques.
On ne médit pas des morts. Mais l'académicien Sakharov,
défenseur d'une approche humaine pour l'élimination
des armes nucléaires, ne pouvait ignorer que de nombreux
militaires avaient été exposés à des
niveaux de radiation variables lors des essais. Il avait l'obligation
de nous retrouver et de nous aider. Après tout, nous partagions
avec lui l'esprit, la philosophie et la science qui sous-tendaient
ses travaux.
Lorsqu'on envoie des militaires en mission
à risque, qu'ils soient simples soldats ou généraux,
l'État est tenu de constituer un fonds de prévoyance,
c'est-à-dire un fonds destiné à assurer la
survie ou la famille de ceux qui perdraient leur santé.
Il serait judicieux d'accorder des prestations
spécifiques à ces militaires, car une personne atteinte
de maladie liée aux radiations meurt de l'intérieur.
Aujourd'hui, nous gaspillons notre argent en alimentant les escrocs
et les spéculateurs au lieu d'allouer ces réserves,
aussi minimes soient-elles, à ceux qui ont participé
aux essais nucléaires et aux opérations de décontamination
de Tchernobyl. Pour eux, chaque gramme de protéines supplémentaire
représente une infime parcelle de santé.
Nombreux sont les participants à ces
exercices qui ont contracté diverses maladies, dont certaines
ont persisté pendant 20 à 30 ans. Youri Dmitrievitch
Sorokine, par exemple, souffre de 63 diagnostics différents.
Il me semble juste de qualifier ces maladies de blessures, de
traumatismes de guerre.
Est-il réellement possible de confirmer
un lien de causalité entre les maladies actuelles des travailleurs
du nucléaire militaire et leur participation à des
activités nucléaires militaires ? Après
tout, des décennies se sont écoulées.
- C'est difficile,
mais possible. Il existe des méthodes spécifiques,
et nos spécialistes les maîtrisent. Cela inclut l'examen
de la thyroïde, l'évaluation de l'émail dentaire
et une multitude d'autres facteurs permettant de déterminer
l'impact d'une explosion nucléaire sur le corps humain.
Malheureusement, nous manquons actuellement
de ressources et de personnel pour mener à bien l'ensemble
de ces examens. Certains s'en servent pour gagner du temps.
Notre comité est reconnu et légalisé
par des résolutions spéciales du Conseil suprême
de la Fédération de Russie et du ministère
de la Justice. Mais à quel prix ! Nous avons visité
450 bureaux de différents ministères et administrations
et obtenu des résolutions des plus hautes autorités
du pays.
Suite à cela, la résolution n° 2123-1
du Conseil suprême du 27 décembre 1991,
« Relative à la protection sociale des citoyens
exposés aux risques spéciaux », a été
promulguée. La résolution stipule notamment que
l'éligibilité à participer aux essais et
exercices d'armes nucléaires est déterminée
par le comité et par lui seul. À cette fin, une
commission d'experts médico-sociaux et un centre scientifique
et thérapeutique sont mis en place au sein du comité.
Ils sont dirigés par Igor Nikolaïevitch Boukhalovski,
docteur en sciences médicales, professeur et ancien médecin-chef
adjoint des forces armées. Nous sommes pleinement conscients
de notre responsabilité envers l'État de veiller
à ce que ce soient les scientifiques militaires spécialisés
en armes nucléaires, et non des imposteurs, qui bénéficient
de ces avantages. L'apparition de ces derniers ne peut être
exclue.
Nous sommes déjà parvenus à
résoudre de nombreux problèmes, mais malheureusement
pas tous. Pour l'instant, le comité fonctionne grâce
à des dons et à la charité.
Nous n'avons même pas de logement. Nous
sommes entassés dans une seule pièce avec neuf autres
personnes. Environ 10 000 dossiers personnels y sont entreposés.
Et pourtant, nous devons examiner près de 15 000 personnes
dans un délai très court. N'oublions pas que le
comité emploie des personnes tout aussi fragiles.
Depuis huit mois, depuis la publication de
la résolution du Conseil suprême, nous travaillons
quotidiennement à préparer les décisions
gouvernementales correspondantes. Les vétérans du
nucléaire espèrent que leur contribution à
la création du bouclier nucléaire de la Patrie sera
dûment reconnue et que leurs dommages à leur santé
seront d'une manière ou d'une autre indemnisés.
Il ne faut pas oublier que l'armée se construit non seulement
sur le présent et l'avenir, mais aussi sur le passé.
Totsk
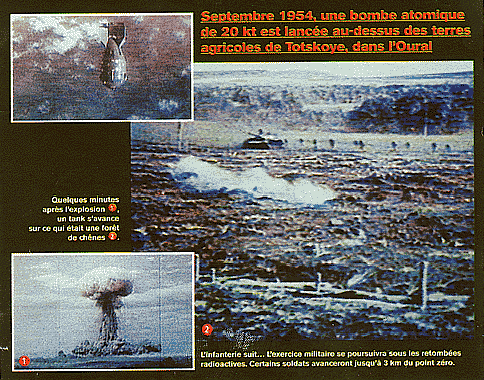 L'essais réalisé
à Totsk, aux confins du sud de l'Oural, était d'un
genre spécifique. M. Donald J. Bradley (op. cit. page 154)
en donne la description suivante : « Le 14 septembre
1954, à l'occasion d'exercices militaires courants* près
de Totsk dans la région d'Orenburg, un engin nucléaire
de 40 kilotonnes explosa a une altitude de 350 m. Environ 40 000
soldats furent exposés dans cet exercice faisant partie
d'une expérience pour étudier les effets des armes
nucléaires (Los Angeles Times, 2 - 192 - septembre
1992 ; Minatom et MOD 1996). Deux zones de contamination résultèrent
de l'explosion : la zone épicentrale de l'explosion de
20 km de rayon et une 'trajectoire' de contamination de 210 km
de long dans la direction nord-est. Ces zones comprenaient 57
villages d'une population totale de 39 000 personnes. De récentes
études de santé humaine ont montré un taux
plus élevé de mortalité par cancer pour ce
groupe de populations que pour celui de la population rurale de
la région d'Orenburg (Boev et coll., octobre 1996). Peu
de temps après l'explosion, des exercices militaires furent
dirigés à cet endroit à environ 10 km de
Totsk. L'explosion détruisit également des forêts
dans un rayon de 1 à 1,5 km. (Spaseniye, juillet 1992). »
L'essais réalisé
à Totsk, aux confins du sud de l'Oural, était d'un
genre spécifique. M. Donald J. Bradley (op. cit. page 154)
en donne la description suivante : « Le 14 septembre
1954, à l'occasion d'exercices militaires courants* près
de Totsk dans la région d'Orenburg, un engin nucléaire
de 40 kilotonnes explosa a une altitude de 350 m. Environ 40 000
soldats furent exposés dans cet exercice faisant partie
d'une expérience pour étudier les effets des armes
nucléaires (Los Angeles Times, 2 - 192 - septembre
1992 ; Minatom et MOD 1996). Deux zones de contamination résultèrent
de l'explosion : la zone épicentrale de l'explosion de
20 km de rayon et une 'trajectoire' de contamination de 210 km
de long dans la direction nord-est. Ces zones comprenaient 57
villages d'une population totale de 39 000 personnes. De récentes
études de santé humaine ont montré un taux
plus élevé de mortalité par cancer pour ce
groupe de populations que pour celui de la population rurale de
la région d'Orenburg (Boev et coll., octobre 1996). Peu
de temps après l'explosion, des exercices militaires furent
dirigés à cet endroit à environ 10 km de
Totsk. L'explosion détruisit également des forêts
dans un rayon de 1 à 1,5 km. (Spaseniye, juillet 1992). »
*Un film, tourné par les services de l'Armée
rouge, témoigne de la véracité des faits.
Tandis que les cameramen commencent à filmer, un commentateur
explique que l'objectif de l'exercice est de savoir si les troupes
seront capables de combattre dans une zone sous bombardement atomique.
Les soldats, pour la plupart de jeunes recrues, des milliers de
véhicules, des centaines de canons et de tanks, sont à
proximité du point zéro. A une quinzaine de kilomètres
de là, prudents, des généraux soviétiques,
des membres du ministère de la Défense et quelques
invités des pays de l'Est sont bien à l'abri dans
un poste de commandement. Parmi eux, le maréchal Georgi
Joukov, héros de la Seconde Guerre mondiale, qui dirige
l'exercice.
Le champignon atomique se forma quasiment à la verticale
des troupes. Après la dispersion des ondes de choc, les
soldats sortirent de leurs abris ou tranchées et s'élancèrent
dans la fournaise radioactive à l'assaut d'une cible imaginaire.
Dans le film, on les voit courir entre les maisons en flammes,
parmi des animaux brûlés par la chaleur et les radiations
et le matériel militaire calciné.

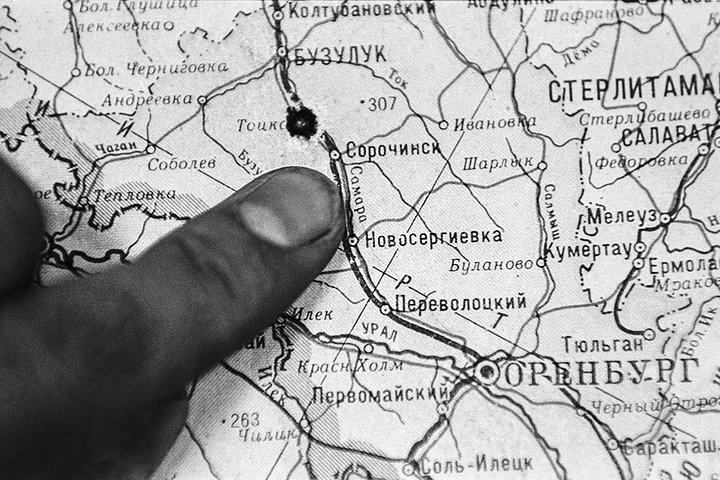 Le
terrain d'entraînement de Totsky.
Le
terrain d'entraînement de Totsky.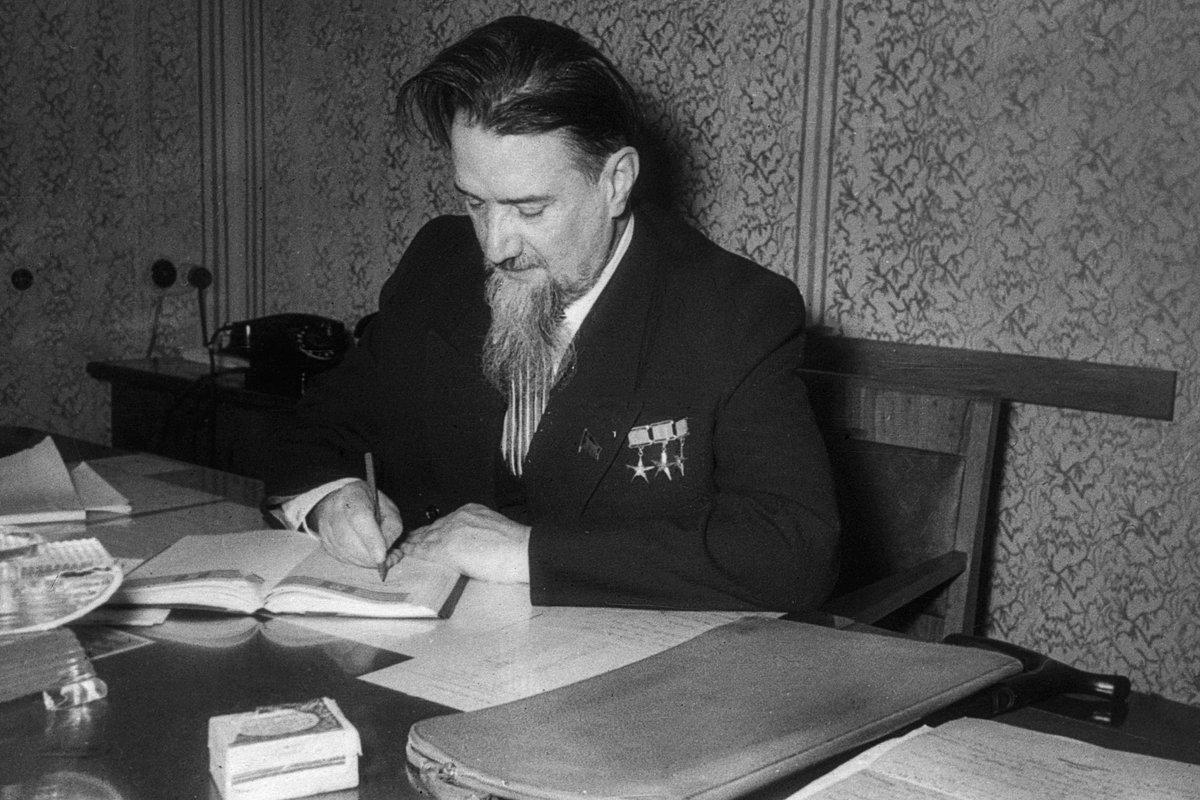 Igor Kourtchatov, directeur de l'Institut de
l'énergie atomique, après une inspection préalable
au lancement du réacteur nucléaire de recherche,
1960.
Igor Kourtchatov, directeur de l'Institut de
l'énergie atomique, après une inspection préalable
au lancement du réacteur nucléaire de recherche,
1960. Tôt le matin
du 14 septembre 1954, les troupes prirent leurs positions initiales :
les troupes « ouest » étaient sur
la défensive, positionnées à 10-12 kilomètres
du centre de l'explosion, tandis que les troupes « est »,
en progression, se trouvaient à cinq kilomètres
de là, de l'autre côté de la rivière.
Pour des raisons de sécurité, leurs unités
de tête furent retirées de la première tranchée
et stationnées dans des abris.
Tôt le matin
du 14 septembre 1954, les troupes prirent leurs positions initiales :
les troupes « ouest » étaient sur
la défensive, positionnées à 10-12 kilomètres
du centre de l'explosion, tandis que les troupes « est »,
en progression, se trouvaient à cinq kilomètres
de là, de l'autre côté de la rivière.
Pour des raisons de sécurité, leurs unités
de tête furent retirées de la première tranchée
et stationnées dans des abris. [juste]
après l'explosion nucléaire.
[juste]
après l'explosion nucléaire. Un
bombardier Tu-4 exposé au Musée de Monino, 1970.
Un
bombardier Tu-4 exposé au Musée de Monino, 1970.
 Le
terrain d'entraînement militaire de Totsky. Image tirée
du documentaire « Irradiation ».
Le
terrain d'entraînement militaire de Totsky. Image tirée
du documentaire « Irradiation ». Valery Astafyev.
Image tirée du documentaire « Irradiation ».
Valery Astafyev.
Image tirée du documentaire « Irradiation ».


 Zoya
Volochenkova. Image tirée du documentaire « Irradiation
».
Zoya
Volochenkova. Image tirée du documentaire « Irradiation
».  Viktor
Boev. Image du documentaire « Irradiation ».
Viktor
Boev. Image du documentaire « Irradiation ». Tamara Popova dans son laboratoire dans les années
1990.
Tamara Popova dans son laboratoire dans les années
1990. Valery
Frolovich Astafyev, témoin de l'explosion nucléaire
de Totsk. (Photo : Stoyan Vasev pour
TD)
Valery
Frolovich Astafyev, témoin de l'explosion nucléaire
de Totsk. (Photo : Stoyan Vasev pour
TD) Totskoïe-2,
site d'essais de Totskoïe. La croix en pneus est un repère
pour les pilotes de bombardiers. (Photo : Youri Pirogov)
Totskoïe-2,
site d'essais de Totskoïe. La croix en pneus est un repère
pour les pilotes de bombardiers. (Photo : Youri Pirogov) Panneau
commémoratif sur le site de l'explosion. (Photo : Youri
Pirogov)
Panneau
commémoratif sur le site de l'explosion. (Photo : Youri
Pirogov) Valery
Frolovich Astafyev (Photo : Stoyan Vasev).
Valery
Frolovich Astafyev (Photo : Stoyan Vasev). [...] Ce qui s'est
passé le 14 septembre 1954 dans la région
d'Orenbourg est resté secret pendant de nombreuses années.
À 9 h 33, l'explosion de l'une des bombes
nucléaires les plus puissantes de son époque a retenti
au-dessus de la steppe. Les troupes « orientales »
se sont alors lancées à l'attaque, passant devant
des forêts incendiées par le feu atomique et des
villages rasés. Des avions, frappant des cibles au sol,
ont traversé le nuage en forme de champignon. À
dix kilomètres de l'épicentre de l'explosion, dans
la poussière radioactive et le sable en fusion, les «
Occidentaux » tinrent bon. Plus d'obus et de bombes furent
tirés ce jour-là que lors de l'assaut sur Berlin.
[...] Ce qui s'est
passé le 14 septembre 1954 dans la région
d'Orenbourg est resté secret pendant de nombreuses années.
À 9 h 33, l'explosion de l'une des bombes
nucléaires les plus puissantes de son époque a retenti
au-dessus de la steppe. Les troupes « orientales »
se sont alors lancées à l'attaque, passant devant
des forêts incendiées par le feu atomique et des
villages rasés. Des avions, frappant des cibles au sol,
ont traversé le nuage en forme de champignon. À
dix kilomètres de l'épicentre de l'explosion, dans
la poussière radioactive et le sable en fusion, les «
Occidentaux » tinrent bon. Plus d'obus et de bombes furent
tirés ce jour-là que lors de l'assaut sur Berlin.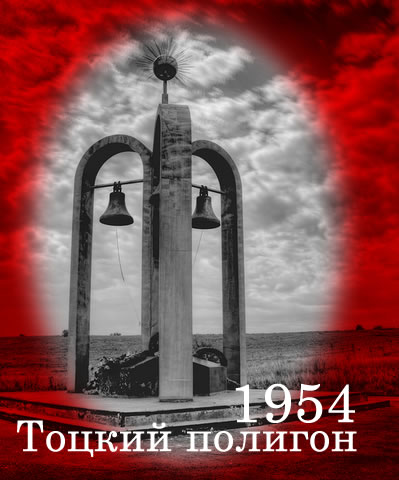 Au bureau d'état
civil de Sorochinsky, nous avons compilé un échantillon
de diagnostics de personnes décédées au cours
des 50 dernières années. Depuis 1952, 3 209
personnes sont décédées d'un cancer dans
les villages voisins. Immédiatement après l'explosion,
il n'y a eu que deux décès. Ensuite, il y a eu deux
pics : le premier 5 à 7 ans après l'explosion,
le second au début des années 1990.
Au bureau d'état
civil de Sorochinsky, nous avons compilé un échantillon
de diagnostics de personnes décédées au cours
des 50 dernières années. Depuis 1952, 3 209
personnes sont décédées d'un cancer dans
les villages voisins. Immédiatement après l'explosion,
il n'y a eu que deux décès. Ensuite, il y a eu deux
pics : le premier 5 à 7 ans après l'explosion,
le second au début des années 1990. Leonid Pogrebny rêve encore des exercices
au centre d'entraînement de Totsky.
Leonid Pogrebny rêve encore des exercices
au centre d'entraînement de Totsky.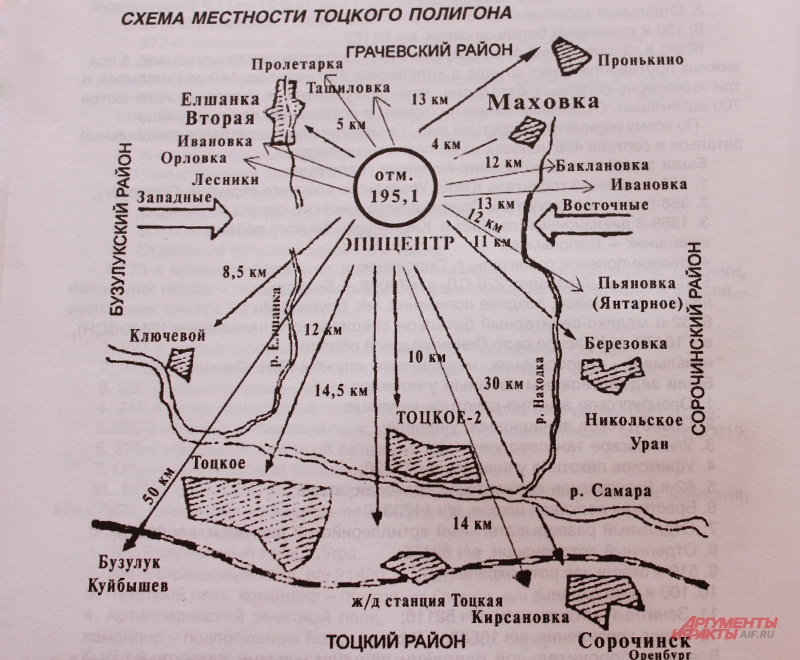 L'explosion
s'est produite à proximité des villages. Schéma
tiré du livre.
L'explosion
s'est produite à proximité des villages. Schéma
tiré du livre. L'herbe a repoussé
sur le lieu de l'explosion, et un mémorial avec des cloches
a été érigé.
L'herbe a repoussé
sur le lieu de l'explosion, et un mémorial avec des cloches
a été érigé. Voici
l'uniforme remis aux participants à l'expérience
nucléaire.
Voici
l'uniforme remis aux participants à l'expérience
nucléaire. 





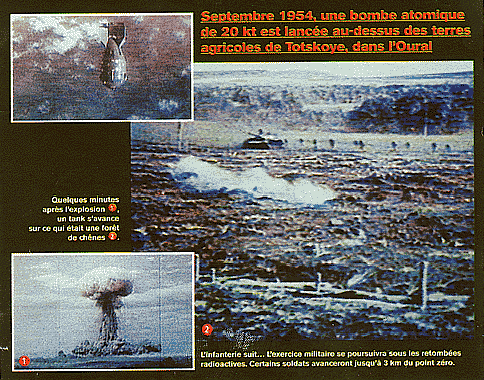 L'essais réalisé
à Totsk, aux confins du sud de l'Oural, était d'un
genre spécifique. M. Donald J. Bradley (op. cit. page 154)
en donne la description suivante : « Le 14 septembre
1954, à l'occasion d'exercices militaires courants* près
de Totsk dans la région d'Orenburg, un engin nucléaire
de 40 kilotonnes explosa a une altitude de 350 m. Environ 40 000
soldats furent exposés dans cet exercice faisant partie
d'une expérience pour étudier les effets des armes
nucléaires (Los Angeles Times, 2 - 192 - septembre
1992 ; Minatom et MOD 1996). Deux zones de contamination résultèrent
de l'explosion : la zone épicentrale de l'explosion de
20 km de rayon et une 'trajectoire' de contamination de 210 km
de long dans la direction nord-est. Ces zones comprenaient 57
villages d'une population totale de 39 000 personnes. De récentes
études de santé humaine ont montré un taux
plus élevé de mortalité par cancer pour ce
groupe de populations que pour celui de la population rurale de
la région d'Orenburg (Boev et coll., octobre 1996). Peu
de temps après l'explosion, des exercices militaires furent
dirigés à cet endroit à environ 10 km de
Totsk. L'explosion détruisit également des forêts
dans un rayon de 1 à 1,5 km. (Spaseniye, juillet 1992). »
L'essais réalisé
à Totsk, aux confins du sud de l'Oural, était d'un
genre spécifique. M. Donald J. Bradley (op. cit. page 154)
en donne la description suivante : « Le 14 septembre
1954, à l'occasion d'exercices militaires courants* près
de Totsk dans la région d'Orenburg, un engin nucléaire
de 40 kilotonnes explosa a une altitude de 350 m. Environ 40 000
soldats furent exposés dans cet exercice faisant partie
d'une expérience pour étudier les effets des armes
nucléaires (Los Angeles Times, 2 - 192 - septembre
1992 ; Minatom et MOD 1996). Deux zones de contamination résultèrent
de l'explosion : la zone épicentrale de l'explosion de
20 km de rayon et une 'trajectoire' de contamination de 210 km
de long dans la direction nord-est. Ces zones comprenaient 57
villages d'une population totale de 39 000 personnes. De récentes
études de santé humaine ont montré un taux
plus élevé de mortalité par cancer pour ce
groupe de populations que pour celui de la population rurale de
la région d'Orenburg (Boev et coll., octobre 1996). Peu
de temps après l'explosion, des exercices militaires furent
dirigés à cet endroit à environ 10 km de
Totsk. L'explosion détruisit également des forêts
dans un rayon de 1 à 1,5 km. (Spaseniye, juillet 1992). »